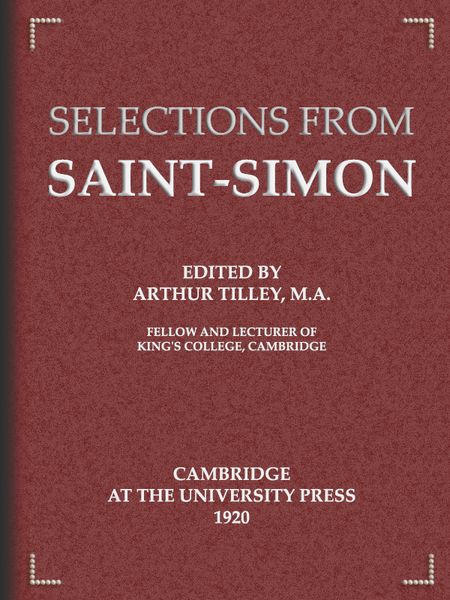
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please check with an FP administrator before proceeding.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. If the book is under copyright in your country, do not download or redistribute this file.
Title: Selections from Saint-Simon
Date of first publication: 1920
Author: Arthur Tilley (1851-1942)
Date first posted: Sep. 16, 2018
Date last updated: Sep. 16, 2018
Faded Page eBook #20180927
This eBook was produced by: Claudine Corbasson, Al Haines, Hans Pieterse & the online Distributed Proofreaders Canada team at http://www.pgdpcanada.net
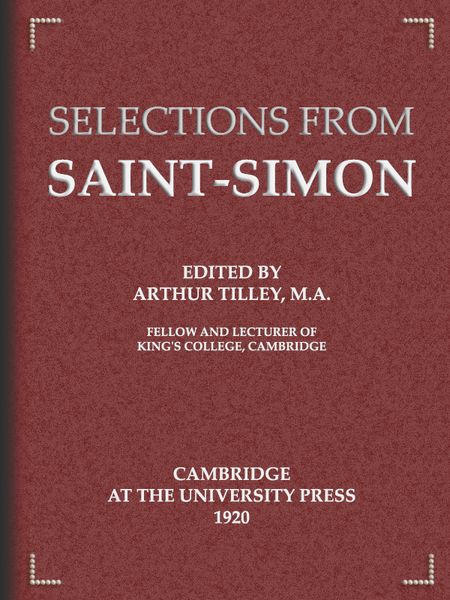
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
C. F. CLAY, Manager
LONDON: FETTER LANE, E.C. 4
NEW YORK: G. P. PUTNAM’S SONS
| BOMBAY CALCUTTA MADRAS |
MACMILLAN AND CO., Ltd. |
TORONTO: J. M. DENT AND SONS, Ltd.
TOKYO: MARUZEN-KABUSHIKI-KAISHA
ALL RIGHTS RESERVED
EDITED BY
ARTHUR TILLEY, M.A.
FELLOW AND LECTURER OF
KING’S COLLEGE, CAMBRIDGE
CAMBRIDGE
AT THE UNIVERSITY PRESS
1920
It is not every lover of French literature who has the leisure or the courage to read the whole of Saint-Simon’s Mémoires, the text of which fills eighteen and a half volumes of the edition of MM. Chéruel and Ad. Régnier fils. Nor is it all of equal interest. I thought, therefore, that a selection might prove acceptable to the busy or faint-hearted reader, and perhaps even whet his appetite for the work itself. In making the selection I have practically confined myself to the first two-thirds of the Mémoires, that is to say, to the reign of Louis XIV, and I have chosen the passages with a view to illustrating that reign during the period of its declining splendour. In the first four chapters we have the Roi-Soleil and Mme de Maintenon presented to us in their daily life. There follows the account of the review at Compiègne, which gives us some measure of Louis’s boundless extravagance, and the greater part of the famous chapters on the death of Monseigneur, surely one of the greatest things in literature. Lastly there are thirteen portraits, including such masterpieces as Conti, Cardinal d’Estrées, Fénelon, the Duke and Duchess of Burgundy, and the Duke of Orléans. In my notes I have confined myself to the modest task of illustrating Saint-Simon from himself, and of supplying such other biographical details vi as seemed necessary. No one can annotate Saint-Simon without being indebted to M. de Boislisle’s masterly edition now in progress, but for my purpose the full and careful index of MM. Chéruel and Régnier has been of even greater service. The index to vols. I.-XXVIII. of M. de Boislisle’s edition appeared after my work was practically finished.
| PAGE | ||||
| INTRODUCTION | ix | |||
| I. | LOUIS XIV | 1 | ||
| II. | MME DE MAINTENON | 42 | ||
| III. | THE DAILY LIFE OF LOUIS XIV | 69 | ||
| IV. | MADAME AND MME DE MAINTENON | 90 | ||
| V. | THE REVIEW AT COMPIÈGNE | 93 | ||
| VI. | THE DEATH OF MONSEIGNEUR | 106 | ||
| VII. | PORTRAITS: | |||
| 1. | Achille de Harlay | 140 | ||
| 2. | Mme de Castries | 142 | ||
| 3. | Le Nostre | 143 | ||
| 4. | Vendôme | 144 | ||
| 5. | Vauban | 146 | ||
| 6. | D’Antin | 152 | ||
| 7. | Le Prince de Conti | 157 | ||
| 8. | Le Duc et la Duchesse de Bourgogne | 160 | ||
| 9. | Cardinal d’Estrées | 172 | ||
| 10. | Beauvillier | 177 | ||
| 11. | Fénelon | 180 | ||
| 12. | Villeroy | 189 | ||
| 13. | Le Duc d’Orléans | 191 | ||
| VIII. | THE ABBÉ DUBOIS AND THE SEE OF CAMBRAI | 210 | ||
| APPENDIX A. The Councils and the Secretaries of State | 215 | |||
| APPENDIX B. Extracts from Vauban, Projet d’une dîme royale | 217 | |||
| Index of Persons mentioned in the Notes | 219 | |||
| Plan of the Château de Versailles | 66 | |||
“People who are old enough to write memoirs have usually lost their memory.” This epigrammatic remark with which a recent writer, not old enough to have lost his memory, opens his reminiscences, has considerable truth in it. Historians now recognise that “memoirs do not supply the certainty of history,” for if the writers have dim memories, they have also lively imaginations. Saint-Simon, the prince of memoir-writers, did not, it is true, begin to transcribe his memoirs till he was well past sixty, but from the age of twenty he had collected materials and made systematic notes. His memoirs were not merely the pastime of his old age but the serious business of his whole life. The result is that he has left us a picture of the Court of Versailles at the close of the seventeenth century and the beginning of the eighteenth which is unsurpassed in interest. This interest is above all things human. The men and women who fill his canvas are vividly alive. With a few powerful and incisive strokes he first sketches their lineaments and then with merciless penetration proceeds to lay bare their souls. But his memoirs are also coloured by his own alert and energetic personality. They not only portray his age, but they reveal himself; to judge of the fidelity of the picture, we must know something of the man.
Saint-Simon came of an ancient stock, being descended in the direct male line from Matthieu de Rouvroy, surnamed Le Borgne, who fought at Crécy and Poitiers, and Marguerite de Saint-Simon. His immediate ancestors, a branch of the family which dropped the name of Rouvroy for that of Saint-Simon, if not exactly illustrious, followed their monarchs loyally in war and administered their estates successfully in peace. His father, Claude de Saint-Simon, x who was born in 1607, chiefly owing to his address in the hunting field rose into high favour with Louis XIII, who created him a duc et pair in 1636. But he fell into disgrace soon afterwards and was ordered by Richelieu to retire from the Court to the fortress of Blaye on the Gironde, of which he was governor. His vacillating attitude on the outbreak of the Fronde made him acceptable neither to Mazarin nor to the rebellious princes, and he did not return to Paris till after the troubles were over. In 1672 he married as his second wife Charlotte de l’Aubespine, by whom he had an only son, born on January 16, 1675, and christened Louis after his royal godfather. At the age of seven, the young Vidame de Chartres, according to the custom of many noble families, was put under the charge of a governor, but his character and opinions were largely moulded by his father and mother. The latter, a highly virtuous woman of method and good sense, applied herself assiduously to the development of his mind and body. From his father he imbibed a profound antipathy for Mazarin, the families of Lorraine, Bouillon, and Rohan, and all Secretaries of State.
In December, 1691, when he was nearly seventeen, he was formally presented to the King, and enrolled as a cadet in the regiment of the Grey Musketeers. In this capacity he took part in the siege of Namur, which is the first event recorded in his memoirs. In 1693, having been given the command of a company of cavalry, he fought at Neerwinden, and at the end of the campaign bought the colonelcy of a regiment. Shortly before this he had succeeded his father as governor of Blaye and Senlis. He was only nineteen, when he gave a signal proof of his energy and of the importance which he attached to matters of precedence, by helping to organise a resistance to the claim of the Maréchal de Luxembourg to take precedence of all ducs et pairs except the Duc d’Uzès. The Dukes lost their case, largely, Saint-Simon alleges, owing to the partiality of the First President of the Parlement, Achille de Harlay.
xi In the following year (1695) he married Gabrielle de Durfort, the eldest daughter of the Maréchal-Duc de Lorges, a nephew of Turenne. She was a blonde with a fine complexion and figure, and being a modest and excellent woman made him an admirable wife. He on his side was a devoted husband, and he always speaks of her in his Memoirs with the greatest affection and esteem.
After the Peace of Ryswick (1697) his regiment was disbanded, and, on the outbreak of the War of the Spanish Succession, five years later, failing to receive a nomination as Brigadier, he retired from the service on the plea of ill-health. “Voilà encore un homme qui nous quitte,” said the King, and he looked coldly on Saint-Simon in consequence. It was characteristic of the little Duke’s overweening sense of his own importance that before taking this step he held a solemn consultation with six distinguished friends, the Chancellor Pontchartrain, and five Dukes, Lorges, Durfort-Duras, Choiseul, Beauvillier, and La Rochefoucauld, of whom the first three were Marshals of France.
The loss to the army was not irremediable, and the gain to literature was immense. Henceforth Saint-Simon could devote himself with singleness of purpose to the real business of his life. It was in July, 1694, in the camp of Germersheim on the Old Rhine, that “he began to write his memoirs,” by which expression we must understand, not that he began to write a continuous narrative, but that from this time he systematised his observations and inquiries and made careful notes of the results. We learn from a letter to his friend, M. de Rancé, the famous reformer of La Trappe, that his original intention was to relate in detail all personal matters and merely to touch superficially on general events. But he soon abandoned this idea and in his account of the years immediately succeeding his retirement from the army there is little mention of himself.
His chief friends and allies at this period were all men considerably older than himself—the two inseparables, xii the Duc de Beauvillier and the Duc de Chevreuse, who had both married daughters of Colbert, the Maréchal de Boufflers, the Chancellor Pontchartrain, and Chamillart, the Secretary of State for War. It was through the good offices of Chamillart and Maréchal, the King’s surgeon, that “he became reconciled,” as he characteristically expresses it, with Louis XIV. But he had his enemies as well as his friends, and chief among them were the members of the coterie which, as so often happens towards the end of a long reign, the common hope of favours to come had attracted round the heir to the throne. An important member of this “Cabale de Meudon,” as Saint-Simon calls it, was the Duc de Vendôme, and when in 1708 Louis XIV made the mistake of associating his grandson, the Duc de Bourgogne, with him in the command of the army of Flanders, and dissensions arose between the two commanders, the Cabal warmly espoused Vendôme’s cause. Their unscrupulous intrigues against the Duc de Bourgogne roused the wrath of Saint-Simon, who as the ally of M. de Beauvillier, the young Prince’s former governor, was well disposed in his favour. Throughout the years 1708 and 1709 he threw himself into the contest with his accustomed vigour, and in the following year he helped to achieve a notable victory over the hated Cabal in another field, that of the marriage of the Duc de Berry, Monseigneur’s youngest son. The candidate of Monseigneur’s party was Mlle de Bourbon, while the Duchesse de Bourgogne, well served by Saint-Simon and his friends, favoured the daughter of the Duc d’Orléans. Saint-Simon’s organisation of the “Cabale de Mademoiselle” was a masterpiece of skilful intrigue, and he conducted the campaign with a passionate energy which is faithfully reflected in his narrative. When, however, the coarse and depraved character of the new Duchess revealed itself he bitterly regretted his success.
But the marriage had one beneficial, if unlooked for, result. The Duchesse de Saint-Simon, greatly against her inclination and that of her husband, was appointed xiii lady-in-waiting to the new Duchess, and had assigned to her a set of apartments at Versailles, consisting of an antechamber and five rooms, each with a dark little cabinet opening out of it. In one of these Saint-Simon established himself with his books and his bureau de travail. It was an unrivalled post of observation, which his friends christened appropriately “his workshop.” Meanwhile his intimacy with Beauvillier and Chevreuse brought him into relations with the Duc de Bourgogne, and the only thorn in his felicity was the Cabale de Meudon, which he believed to be bent on his destruction. But from this he was delivered by the Dauphin’s death from small-pox in April, 1711. The next ten months were the happiest of his whole life at Court. His relations with the new Dauphin became more intimate, and in numerous private conversations he discussed with him projects of political reform. Then in 1712 the French Marcellus, the star of noble hopes and aspirations, followed his father to the grave. The blow hit Saint-Simon almost as hard as it did Fénelon. “The sense of my personal loss, the immeasurably greater loss of France, and above all the vanished figure of that incomparable Dauphin pierced my heart and paralysed my faculties.”
Two years later he refers in melancholy accents to his changed position. Chevreuse, Beauvillier, and Boufflers were dead, Pontchartrain had retired from office, Chamillart was in disgrace. The one link left to him with the Court was the Duc d’Orléans, who by the death of the Duc de Berry in May, 1714, was marked out as the future regent of the kingdom. In spite of his unpopularity Saint-Simon, who had for some years now been on friendly terms with him, drew to him more closely. He reprobated his licentious and scandalous life, but he defended him against the false accusations of his enemies, and effectively countermined the intrigues of the party that was plotting against him in favour of the Duc du Maine.
On Louis XIV’s death it was partly owing to Saint-Simon’s vehement and energetic insistence that Orléans xiv roused himself from his habitual indolence and persuaded the Parlement to set aside the testament of the late King, which, while it conferred on him the Regency, had put the real power in the hands of the Duc du Maine. Saint-Simon was made a member of the Council of Regency, and the introduction of departmental Councils, in place of the Secretaries of State, was more or less in accord with his own proposals.
The new form of administration, however, was not a success and after a trial of two years was abandoned. Nor did Saint-Simon himself shew any political capacity. He was wanting in tact and adaptability, and worse than this he frittered away on futile questions of precedence and etiquette the time and energy that might have been given to really important matters. Such influence as he had with the Regent came to an end with the rise to power of Dubois, who gladly furthered his request to be sent on a special mission to Spain (1721).
On the death of the Regent (1722) he left the Court and lived for some time with his family in a house which he rented in the Rue Saint-Dominique. But after the marriage of his two sons he resided for at least half the year at his château of La Ferté-Vidame, about 30 miles north-west of Chartres. The château itself, which, as we know from engravings, had the air of a feudal fortress, and in every room of which hung a portrait of Louis XIII, no longer exists. But the park, enclosed by a wall of nearly nine miles, and the forest beyond have preserved their original character.
Here Saint-Simon began and completed the definitive version of his Memoirs, and here in 1743, to his overwhelming grief, he lost his wife, his faithful companion of nearly fifty years. Other misfortunes followed; his two sons preceded him to the grave, and he was driven by his debts to make over the whole of his property to his creditors. He died at Paris in 1755 at the age of eighty. The lives of his father and himself cover between them nearly a century and a half.
xv Saint-Simon, as we see him in Rigaud’s portrait, was small and delicate—a typical old man’s child—with an extremely alert and eager face. It has been observed that he is seldom mentioned in contemporary memoirs, but these are not numerous for the latter part of the reign of Louis XIV, while three of the chief memoir-writers of the Regency, when Saint-Simon was most prominent, Barbier, Buvat, and Marais, did not belong to Court circles. When he is mentioned it is in no complimentary terms. D’Argenson attacks him for advocating severe measures against the Duc du Maine after the conspiracy of Cellamare. “Mark,” he says, "the odious and bloodthirsty character (anthropophage) of this little saint without genius." But then Saint-Simon in his on the whole highly favourable portrait of D’Argenson’s father, the celebrated head of the Paris police, had said that his character was supple, and that his terrifying appearance resembled that of the three judges of Hades.
It was inevitable that Saint-Simon’s irascibility, intractability, and aristocratic pretensions should arouse considerable enmity, and in the songs and satires of the day he is attacked under the name of boudrillon (bout d’homme) and petit furibond. Mme de Maintenon declared that he was “glorieux, frondeur et plein de vues,” and we have an interesting commentary on this remark in his report of a conversation which took place between the Duchesse de Bourgogne and his wife. The Duchess told her that he had many powerful enemies and that the King had conceived a strong prejudice against him. His intelligence, she said, and his knowledge and capacity for ideas were recognised as far above the ordinary, but everybody was afraid of him, and they could not endure his arrogance and his outspoken criticisms on persons and institutions.
These criticisms would have been more valuable if they had been less concerned with futilities, and less biased by aristocratic prejudices. But Saint-Simon was at heart a true patriot, and was keenly alive to the evils which were sapping the forces of his country. He agreed with xvi reformers like Fénelon and Chevreuse and the Abbé de Saint-Pierre in regarding the absolutism of the King as the chief source of danger, and he shared their dislike of the Controller-General and the four Secretaries of State as the agents of this absolutism. He strongly reprobated the King’s love of war and glory, and the boundless extravagance, which he not only practised himself but encouraged in others. Like La Bruyère and Fénelon, Saint-Simon saw with a compassionate eye the wide-spread misery by which all this glory and magnificence was purchased. He has drawn a moving picture of the terrible winter of 1708-1709, when famine stalked through the land and crushing taxation on the top of high prices “completed the devastation of France.”
Mme de Maintenon further complained that he was “plein de vues,” by which she doubtless meant much the same thing as Louis XIV, when he called Fénelon chimerical. For in Saint-Simon’s schemes for reform, as in Fénelon’s, there was a strong Utopian element, which did not sufficiently take into account the hard facts of political life and the shortcomings of human nature. They both looked back too fondly on the past, they both exaggerated the value of the nobles and the Estates General—Saint-Simon laying more stress on the former, Fénelon on the latter—as checks to absolutism. That there should be a certain similarity between their ideas is only to be expected, for though they were not personally acquainted, they had a common link in the Duc de Bourgogne, and it was just at the time that Saint-Simon was having frequent conferences with the latter that his two great friends, the Duc de Beauvillier and the Duc de Chevreuse, held long conversations on affairs of state with Fénelon at Chaulnes (November, 1711). From the conferences of Saint-Simon and the Duc de Bourgogne sprang the Projets de gouvernement, the manuscript of which was found among Saint-Simon’s papers, and which is undoubtedly from his pen. The conversations at Chaulnes were summarised in the series of short maxims, known as the Tables de Chaulnes, xvii which represent Fénelon’s nearest approach to practical politics.
However deserving of consideration Saint-Simon’s views may have been, his insistence on them in season and out of season cannot have helped to commend them or to make him popular at Court. In his old age he is said to have been a delightful talker, but at Versailles he must have sometimes proved an intolerable bore. “Il faut tenir votre langue,” said Louis XIV to him when he accepted the appointment for his wife. One wonders at the patience with which the Duke of Orleans endured his moral lectures and political disquisitions. But the Duke was too indolent to escape them, and while he must have derived considerable amusement from the peculiarities of his friend’s character he evidently appreciated his transparent honesty. For with all his faults and prejudices, his vanity, his hate, and his vindictiveness, Saint-Simon was essentially honest. It is true that in his intercourse with some men, as for instance Père Tellier, the Duc de Noailles, and Cardinal Dubois, he did not act up to the character which he claims for himself of “droit, franc, libre, naturel, et beaucoup trop simple,” but if his curiosity and thirst for information led him sometimes to assume a friendliness which he did not feel, or if in the slippery days of the Regency he had to meet duplicity with duplicity, he was honest at heart, and he had no lack of moral courage.
He carried this sincerity into his religion. D’Argenson may sneer at him as a petit dévot, but his piety was at any rate perfectly genuine. It was the fruit, partly of a careful religious education, and partly of the influence of the Abbé de Rancé. For the monastery of La Trappe was only fifteen miles from La Ferté-Vidame and Saint-Simon often visited it as a child in company with his father. When he came to man’s estate he regarded his father’s friend with that deep and whole-hearted admiration which was one of the finer traits of his character. Every year during the Abbé’s life-time—he died in 1700—Saint-Simon went into xviii retreat at the monastery during Passion-week, and he often consulted the Abbé on matters of conscience. From the Abbé he learnt to look with disfavour on Jansenism, but, as he came to judge more for himself, he was impressed by the noble lives of “Les Messieurs de Port-Royal,” and he declared that recent centuries had produced nothing more saintly, more pure, more learned, more practical, and more elevated, than that famous society. With the Jesuits he was on good terms all his life, and his portrait of Père La Chaise is kindly and appreciative. But in his later volumes he often speaks of them in a hostile spirit, and though he was outwardly on good terms with Père Tellier he cordially disliked him, and his portrait of him is one of the most unflattering in his gallery. In questions of ecclesiastical policy he was, as might be expected from one who was a patriot before he was a Churchman and who did not pretend to theological learning, a convinced Gallican. It was as such, and not as an upholder of Jansenism, that he was strongly opposed to the bull Unigenitus.
We have seen that Saint-Simon began to make notes for his Memoirs in July, 1694. Probably these took more or less the form of a diary and consisted of personal impressions, information that he had picked up from various sources, and so forth. Then in 1729 his friend the Duc de Luynes procured for him the journal which the Duke’s grandfather, the Marquis de Dangeau, had kept with extraordinary regularity and accuracy from 1684 down to his death in 1720. Philippe de Courcillon, Marquis de Dangeau, had come to the Court of Louis XIV with no particular advantages of birth, or wealth, or interest. But by his readiness to oblige, his adaptability, and his honesty he made himself indispensable. Among his accomplishments was that of writing vers de société with great facility, which procured his election to the Académie française at the age of thirty. But his chief passport to favour and fortune was his skill and success, coupled with perfect probity, in all kinds of card-games. This is Mme de xix Sévigné’s account of a game of reversi at Versailles in 1676, in which the King, the Queen, Mme de Montespan, Mme de Soubise, Dangeau, and others took part:
Je voyais jouer Dangeau; et j’admirais combien nous sommes sots auprès de lui. Il ne songe qu’à son affaire, et gagne où les autres perdent; il ne néglige rien, il profite de tout, il n’est point distrait: en un mot, sa bonne conduite défie la fortune; aussi les deux cent mille francs en dix jours, les cent mille écus en un mois, tout cela se met sur le livre de sa recette.
Dangeau’s memoirs are little more than a Court journal, in which he seldom allows himself a comment. But the regularity with which it is noted up day by day, the accuracy of its information, and the multitude of small details in which it abounds, make it a useful and valuable authority, as Sainte-Beuve has shewn in the five causeries which he devoted to it[1]. A couple of citations from the year 1688, complete for the day to which they refer, will give an idea of its character:
Lundi, 26 [janvier] à Versailles. Le roi alla tirer; Monseigneur courut le loup; le soir, il y eut appartement.—Le roi dit qu’il vouloit recommencer à Marly de courre le cerf à cheval. Depuis sa maladie il ne l’avoit couru qu’en calèche. On dit que M. de Noirmoustier, qui est aveugle, va épouser la veuve de feu M. de Brémont qui est fort riche.
Lundi, 1er mars, à Versailles. Le roi dîna à son petit couvert, et alla tirer. Monseigneur courut le loup, qui le mena fort loin d’ici; il n’arriva qu’à onze heures du soir.—Il y eut comédie.—Après souper M. le Duc donna bal en masque chez lui, où Monseigneur demeura jusqu’à la fin, malgré la fatigue de la journée; les officiers de la garde prétendent qu’il a fait plus de quarante lieues aujourd’hui.
It is but fair to add that the average entry for the day is rather longer than this, and not so wholly devoid of interest. Saint-Simon is superb in his contempt:
La bassesse d’un humble courtisan, le culte du maître et de tout ce qui est ou sent la faveur, la prodigalité des plus fades et des plus misérables louanges, l’encens éternel et suffoquant jusque des actions du Roi les plus indifférentes, la terreur et la fadeur suprême qui ne l’abandonnent nulle part pour ne blesser personne, excuser fort, xx principalement dans les généraux et les autres personnes du goût du Roi, de Mme de Maintenon, des ministres, toutes ces choses éclatent dans toutes les pages, dont il est rare que chaque journée en remplisse plus d’une, et dégoûtent merveilleusement.
But Saint-Simon recognised that this commonplace and uncritical Journal, with its accurate chronology and its orderly arrangement, could be of great service to anyone who wished to write true memoirs[2]. Accordingly he had a copy made of the work and during the years 1729-1738 busied himself with adding notes. Some of these were of considerable length, such as the original draft of the tableau or long digression on the character of Louis XIV and his reign, and an elaborate portrait of Louvois, which was not inserted in the Memoirs. About the year 1739 he began to arrange his materials which consisted of the Journal with the notes, other notes which he had accumulated during the last forty-five years, portraits, detailed descriptions, and various essays on the history and genealogy of certain families. He was now able to begin writing out his Memoirs in full. In 1740 he was dealing with the events of 1701. In 1741 or 1742 he had reached the year 1709. By September, 1745, he had come to the end of the reign of Louis XIV, and the tableau in its final form was written between that date and March, 1746. The whole work, which ends with the death of the Regent, was completed in 1751.
On Saint-Simon’s death his Memoirs with his other papers were claimed by his creditors, but the Government took possession of them, and they were read in manuscript by various persons, including Mme du Deffand, who recognised their remarkable merit. Extracts were printed by the Abbé de Voisnenon, and incomplete editions appeared in 1788, 1791, and 1818. But it was not till 1829-1830 that the first authentic and complete edition was published in 21 volumes by General de Saint-Simon. xxi It was, however, badly edited and in 1856-1858, the manuscript having been sold by the General to MM. Hachette for 100,000 francs, Chéruel published a new edition in 20 volumes. This was followed by another edition under the same editorship, with the assistance of Ad. Régnier fils (23 vols. 1873-1886). Neither of these editions was furnished with notes, and before the later one was completed M. de Boislisle had begun to edit for the same firm a noble annotated edition, which is now in progress. The first volume appeared in 1879 and it has now reached the thirtieth. The twenty-eighth contains the famous tableau of the reign of Louis XIV, and the twenty-ninth (1918) consists of an index to all the previous volumes.
The materials which Saint-Simon had accumulated for his great design were derived from many sources, written and oral. His written sources included, besides the Journal of Dangeau, numerous memoirs and histories which were his favourite reading, the great genealogical work of Père Anselme, published in 1674, the Grand Dictionnaire Historique of Moreri, which appeared in the same year, and the work of the German genealogist Imhof, Excellentium in Gallia Familiarum Genealogiae (1687), all of which no doubt had a place in his own library of 6000 volumes.
His oral sources are fairly well known to us, for he generally indicates the quarter from which he derives his information. First in importance were the three ministers, Pontchartrain, Chamillart, and Beauvillier, with all of whom he was very intimate. But both Beauvillier and Chevreuse knew how to be reticent with their young friend when occasion required, and he says that they gave him much less information than either Pontchartrain or the Maréchal de Boufflers. Another useful liaison—to use his favourite term—was that with the Duc and Duchesse de Villeroy, both of whom were great friends of Mme de Caylus, Mme de Maintenon’s cousin. The Duc was a son of the Maréchal de Villeroy and the Duchesse was a daughter of Louvois. Mme de Levis, a daughter of the xxii Duc de Chevreuse, was also of some service, for she was intimate with Mme de Maintenon. The young Duchesse de Lorges, Mme de Saint-Simon’s sister-in-law, was a daughter of Chamillart, and her sister was married to that ardent courtier, the Duc de La Feuillade. Saint-Simon tells us that he generally ended his day with a visit to these ladies, from whom he often learnt something. More suspicious sources of information were the Maréchale de Rochefort, bedchamber-woman to the Dauphine, and friend in succession to all the royal favourites-in-chief; her daughter, Mme de Blansac; and the celebrated Lauzun who married another sister-in-law of Saint-Simon. A Gascon by birth and a farceur by temperament, he evidently enjoyed pulling his brother-in-law’s leg, and the long chapter which Saint-Simon devotes to him just before the close of the Memoirs, though full of amusing and interesting matter, must not be accepted as gospel truth.
One of the most curious figures at the Court was Mme de La Chausseraye, at one time lady-in-waiting to Madame. Thanks to her esprit and her talent for intrigue, she acquired great influence with various ministers and became very rich, losing large sums at cards, but recouping herself by the good things which the King and the Controller-General put in her way. The King was much diverted by her amusing conversation, and she declared that she had won and kept his favour by the sole method of hiding her intelligence and leaving him with a sense of his intellectual superiority. When it is added that she had also great credit with the royal valets, it may be imagined how useful she was to Saint-Simon, and how eagerly he cultivated her society. "J’étois sur elle sur un pied d’amitié et de recherche[3]." One can also imagine his feelings when many years after her death he learnt from her confessor that she had written “very curious” memoirs, but that by his advice she had committed them to the flames.
xxiii Saint-Simon’s curiosity was unbounded and he left no channel of information untapped. "Je me suis toujours instruit journellement de toutes choses par des canaux purs, directs et certains, et de toutes choses grandes et petites[4]." And among his more lowly channels were the royal valets. For, as he says, “le hasard apprend souvent par les valets les choses qu’on croit bien cachées.” He was on excellent terms with Bontemps, the King’s chief valet, who died in 1701 at the age of eighty, a man of high character, thoroughly honest and disinterested, and with Bloin, who was in the King’s service at the time of his death. Another serviceable informant, in a somewhat higher position, was Georges Maréchal, who was appointed first royal surgeon in 1703, “l’honneur et la probité même.”
Whenever any chance occasion offered of obtaining special information Saint-Simon pounced upon it with eager avidity. He describes, for instance, how he travelled from Fontainebleau to Paris with the Marquis de Louville, head of the French household of the King of Spain, and how he put so many questions to him that the poor man arrived sans voix et ne pouvant plus parler. Later he records a conversation with the Princesse des Ursins, who had also just returned from Spain. It lasted eight hours, “which seemed to him eight minutes.”
In the concluding chapter of his Memoirs he claims for them accuracy and veracity. He says that the greater part is based on his own personal experience, and that the rest comes to him at first hand from the actors in the events that he narrates. “I give their names, which, as well as my intimacy with them, are beyond all suspicion. When my information comes from a less sure source I call attention to it, and when I am ignorant, I am not ashamed to avow it.”
This claim is made in all good faith, and as far as the sources of information go it is not far from the truth. xxiv But when one goes on to inquire how Saint-Simon has dealt with his sources, the result is not quite so satisfactory. For he suffers from the three failings which are the chief sources of error in a historian. Firstly, he is careless—chiefly, indeed, about figures and dates, but he sometimes copies Dangeau incorrectly. Secondly, he is uncritical. Though he does not retail mere gossip, he readily believes current stories. The ministers, the court-ladies, the valets from whom he obtained his information may have told him what they believed to be the truth, but Saint-Simon did not cross-examine them or otherwise control their statements. Moreover, some of his witnesses are evidently untrustworthy, whether from self-interest, or whether, like Lauzun, they were given to drawing upon their own invention. Thus Saint-Simon’s account of some of the events narrated in his Memoirs has been disproved by modern criticism. The death, for instance, of Monsieur’s first wife, Henrietta of England, was certainly due to natural causes, and not, as Saint-Simon says, to poison.
The third and chief disturbing element which must be taken into account in judging of Saint-Simon’s veracity is prejudice—and that no mere ordinary prejudice, but rather a bundle of prejudices, all intensified to the height of passion. As we have seen, his father had instilled into him the dislike of certain families and of all Secretaries of State. It was probably too his father who implanted in him that excessive estimate of his importance as a duc et pair from which sprang his contempt for the whole bourgeoisie, including the noblesse de robe, and his prejudice against the monarch who chose his ministers almost exclusively from that class. It was the same aristocratic prejudice which inspired his hatred of “the widow Scarron,” and his dislike of Villars, whom as the great-grandson of a greffier he could not forgive for being made a Duke. Some, however, of his prejudices were due to nobler motives. It was Vendôme’s sloth and debauchery that blinded him to that commander’s high qualities in the field. It was his righteous indignation at the “double xxv adultery” of Louis XIV and Mme de Montespan that filled him with hatred against their bastards. It was the scandal of the official recognition of the royal harem that still further prejudiced him against the King.
But there were also less worthy prejudices, inspired by more personal feelings. The malignant portrait of Achille de Harlay is partly a reprisal for that magistrate’s supposed partiality in the matter of Luxembourg’s dispute with his fellow dukes and peers. The estimate of the grand Dauphin might have been less contemptuous but for Saint-Simon’s enmity with that cabale de Meudon of which the Dauphin was the centre. Other portraits coloured by the passion of a strong antipathy are those of Père Tellier, the Cardinal de Bouillon, the Duc de Noailles, and the Maréchal de Villars. Blackest of all is the famous portrait of Cardinal Dubois. But though it shews evident signs of personal resentment and class prejudice, and though it has been alleged on the Cardinal’s behalf that an honest woman like Madame and a saint like Fénelon gave him their friendly esteem[5], Saint-Simon’s reading of his character may be mainly due to a deeper insight and a more searching analysis.
But Saint-Simon was a good lover as well as a good hater, and many of his portraits are coloured by the promptings of warm affection. His estimate of the Duc de Bourgogne is, as Sainte-Beuve has pointed out, more favourable than Fénelon’s. His finished picture of Cardinal d’Estrées and his slighter sketch of Cardinal Janson are admirable examples of kindly portraiture. To the Maréchal de Boufflers and to the Chancellor Pontchartrain and his wife he pays noble tributes of admiring friendship. His praise of Catinat, that able commander and disinterested patriot, reads like a page of Plutarch. Memorable too are the portraits of the two Dukes, Beauvillier and Chevreuse, for whom he reserved his deepest affection. He is not blind to their limitations or their failings, but he praises them with the sympathetic comprehension of one xxvi who, honest and high-minded himself, can appreciate these qualities to the full when they are displayed in the persons of his friends. The portrait of the Duc de Montfort, the son of his friend the Duc de Chevreuse, is a masterpiece of admiring sympathy[6].
To these two classes of favourable and unfavourable portraits, the former softened by affection, the latter exaggerated by hate, must be added a large number of portraits in which good and bad are intermingled, and which bear throughout the stamp of an impartial estimate. One of the finest of these is the Prince de Conti; less elaborate but hardly less skilful is the Cardinal de Rohan. But the palm for this class of portrait must be awarded to that of the Duke of Orleans. As one of the protagonists in Saint-Simon’s drama he is naturally a prominent figure and the general impression that we get of his character is deepened by numerous touches. But just before the close of Louis XIV’s reign he is presented in a long and leisurely digression, which forms one of the great chapters in Saint-Simon’s narrative. At the other end of the scale to this full-length and elaborately drawn portrait are the little miniatures of minor personages with which the work is interspersed. Among the most notable are Mme de Castries, the Duchesse de Gesvres, M. du Guet, Le Haquais, Toussaint Rose, one of the King’s secretaries, and Bontemps, his chief valet.
But whether the portraits are finished works of art or mere sketches, whether they are inspired by hatred or by admiration, whether they are partial or impartial, they all alike have this virtue that they are intensely alive. We know the originals both in their outward semblance and in their inmost being. While Racine is concerned only with souls, while La Bruyère’s main interest is in habits and manners as an index to character, Saint-Simon, who began his survey of humanity just before his two older contemporaries finished theirs, gives us body and soul alike. In this he resembles Balzac, but he has this advantage xxvii over the great novelist that dealing with real men and women, and not with the creatures of his imagination, he is never tempted to make the outward appearance match the inner character. Nor, as superficial judges are apt to do in real life, does he hastily infer the character from the outward appearance. He deals with both on their merits; he first calls up before us the outward man, and then he gives us his character from an independent study of his idiosyncrasies and actions. “The features of the portrait,” to borrow Montaigne’s phrase, “may go astray,” but we have before us a living man, drawn by a supreme artist. Thus the whole work, if not like Balzac’s, a complete comédie humaine, may be fitly called the Comédie de Versailles.
For Saint-Simon does not merely give us living men and women, he shews them to us in action, he reproduces their movements, their gestures, their tricks of speech. There is nothing more wonderful in the whole of French literature than his account of the spectacle de Versailles after the death of Monseigneur. It is not in the literal sense a drama, for it lacks a plot to give it unity, but it is a superb dramatic tableau, glowing with life and throbbing with a passionate intensity.
The best commentary on this comedy is La Bruyère’s chapter On the Court, the essence of which is distilled in the following passage:
Il y a un pays où les joies sont visibles, mais fausses; et les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empressement pour les spectacles, que les éclats et les applaudissements aux théâtres de Molière et d’Arlequin, les repas, la chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de craintes et d’espérances, de passions si vives et des affaires si sérieuses?
When La Bruyère printed this remarque in the first edition of Les Caractères (1688), the Court of Louis XIV, partly under the influence of Mme de Maintenon and partly as the result of the King’s serious illness in 1686, had begun to wear that aspect of seriousness and gloom xxviii which overshadowed it during the remaining years of the reign. The conversion of the King to the regular observance of Catholic practices, and the general atmosphere of piety which this conversion diffused shewed itself in various ways, and amongst others in the repression of pleasures to which with advancing years he was becoming less inclined. In the very year 1694 in which Saint-Simon began to make notes for his Memoirs Bossuet attacked the stage in his well-known Maximes et Réflexions sur la Comédie. In 1696 the police made a sudden descent on the Hôtel de Bourgogne and summarily suppressed the Italian actors. From this time for many years the only theatre in Paris was the Comédie Française.
Versailles became more and more serious and gloomy. “La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique,” says La Bruyère in the remarque which follows that quoted above. A far worse feature was the inevitable growth of hypocrisy. “Un (faux) dévot est celui qui, sous un roi athée, serait athée.” A good story in illustration of this hypocrisy is told by Saint-Simon. On Thursday and Sunday evenings during the winter it was the King’s habit to attend the service of benediction in the chapel at Versailles, which in consequence was always filled with the ladies of the Court. But, if it became known that the King was not going to attend, the chapel was nearly empty. One evening M. de Brissac, major of the body-guard, an honest man who hated shams, came into the chapel just before the service and announced that His Majesty was not coming, whereupon all the ladies except three or four quietly withdrew, and when the King arrived he was much surprised to find the chapel empty. On Brissac’s telling him after the service what had happened, he laughed heartily, but the ladies, says Saint-Simon, would gladly have strangled Brissac. This anecdote well illustrates the hypocrisy of the age. Beneath the outward veneer of piety free thought and immorality reigned unchecked. Memoirs, letters, and sermons all confirm the truth of Saint-Simon’s picture. In his funeral oration on the xxix Prince de Conti, who died in 1707, Massillon speaks of “un siècle, où la religion est devenue le jouet, ou de la débauche, ou d’une fausse science.” In a well-known letter written by Mme de Maintenon to the Princesse des Ursins in the same year she says, “Je vous avoue, Madame, que les femmes de ce temps-ci me sont insupportables: leur habillement insensé et immodeste, leur tabac, leur vin, leur gourmandise, leur grossièreté, leur paresse, tout cela est si opposé à mon goût, et, ce me semble, à la raison, que je ne puis le souffrir.” There was no worse specimen of her sex than the Duchesse de Berry, whose marriage Saint-Simon had done so much to promote, and of whom he says in his portrait of her, drawn at the close of Louis XIV’s reign, that "except for avarice, she was a model of all the vices[7]."
The men were naturally no better than the women, and at the hôtel in the Temple of the Grand Prior of Vendôme he and his brother, the Duc de Vendôme, especially during the years between the Peace of Ryswick (1697) and the outbreak of the War of the Spanish Succession (1701), gave cynical displays of drunkenness and debauchery.
A less vicious characteristic of the society of Versailles, but one greatly at variance with the refinement which we associate with the age of Louis XIV, was the love of brutal and even cruel horse-play. We read in Saint-Simon of a poor old woman named Mme Panache, whose pockets the princes and princesses used to fill with roast and stewed meat, till the sauce ran down her petticoats. Or they would fillip her face and laugh at her fury, at not being able to tell who had struck her—for she could not see beyond the end of her nose. Another butt was the Princesse d’Harcourt, ugly, dirty, greedy, malicious, dishonest. She never missed a religious service, and was a constant communicant, generally after having played at cards—and openly cheated—till four in the morning. She certainly did not deserve much consideration, but her xxx character hardly justified the Duchess of Burgundy and her ladies in making their way into her bedroom and pelting her with snowballs for half-an-hour[8].
Practical joking, even when it was more or less friendly, often took a brutal or disgusting form. Louis XIV himself, that model of dignity and high-breeding, used to amuse himself with putting hair into the butter and tarts destined for Mlle de Montpensier and Mme de Thianges (the sister of Mme de Montespan), both of whom were very particular about their food. The Duc de Bourbon, La Bruyère’s pupil, and his Duchess especially distinguished themselves in this unpleasant fashion. The Duchess once flung a glass of water in the face of Santeul, the distinguished Latin poet, who was their habitual guest at Chantilly, and the Duke nearly killed him by emptying his snuff-box into his glass of champagne. On a par with these elementary notions of social merriment was the complete want of privacy and the lack of even ordinary decency. It is not too much to say that the standard of comfort at the Court of Versailles in the days of the grand monarque was lower than that of an English labourer at the present day.
The lack of privacy which strikes the modern reader of Saint-Simon presumably did not trouble his contemporaries, to whom it would have seemed only natural. Certainly it did not trouble Louis XIV, who suffered from it more than anybody, but who seems to have delighted in the perpetual presence of his courtiers, as giving him ample opportunity of observing their goings in and goings out. It was part of the espionnage which was one of the worst features of the ancien régime, and which shewed itself in more unpleasant forms, such as the strict police supervision exercised by that most capable of chiefs, Marc-René d’Argenson, and the habitual opening of letters, whatever the rank of the writers. An even more unpleasant sign of despotic government was the practice of granting lettres de cachet on the unsupported statement of the applicant.
xxxi Another feature of the reign which marks the semi-oriental character of the rule of Louis XIV was the cult—for it cannot be called less—of the monarch. “Qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa vie de le voir et d’en être vu, comprendra un peu comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des Saints.” So writes La Bruyère, and his commentator cites apt passages from the letters of Mme de Sévigné and her cousin Bussy-Rabutin, of the Maréchal de Villeroy and the Duc de Richelieu, to illustrate his remark. It was, indeed, literally true of such typical courtiers as Dangeau and D’Antin and La Rochefoucauld, the son of the author of the Maxims, who sometimes, says Saint-Simon, went for ten years without spending a night away from the Court, and in over forty years did not sleep twenty times at Paris. “Jamais valet ne le fut de personne avec tant d’assiduité et de bassesse, il faut lâcher le mot, avec tant d’esclavage.” As La Bruyère says without any hesitation, “Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un courtisan plus assidu?” Nor must we forget that prince of flatterers, the Cardinal de Polignac, of whom Saint-Simon tells us that once, when it was beginning to rain at Marly and the King made a civil remark about his fine coat, he replied, “It is nothing, Sire; the rain at Marly does not wet one.” There were plenty of courtiers at Versailles who were ready to say with the fox in La Fontaine’s fable,
What wonder if the Roi-Soleil, surrounded by so many adoring satellites, came almost to believe in his own divinity?
In this worship of the King Saint-Simon was very far from taking part, but on the other hand he entered with zest into all the futilities of precedence and etiquette which formed the most serious business of the Court. The xxxii right to wear one’s hat, or, in the case of a woman, to be seated in the royal presence (called le droit du tabouret), the right to be kissed by royalty, the right to a chair with arms, or merely to a folding-chair—all these were privileges which were claimed and contested with the utmost keenness, and which figure largely in the pages of our chronicler. It is with the utmost gravity that he relates the visit of the Elector of Cologne, Prince Clement of Bavaria, brother-in-law of Monseigneur, to Versailles in 1706; how the King, “standing and uncovered, received him with all the grace imaginable”; how he was presented to the Duchess of Burgundy, who received him standing, but did not kiss him, “because in the King’s presence she kisses nobody”; how he was next conducted to the bedroom of Madame, who kissed him and had a long conversation with him in German; and how finally he visited in her bed the Duchess of Orleans, who also kissed him. “Il ne s’assit nulle part.”
A good instance of the passionate tenacity with which Saint-Simon took part in controversies on the most trivial questions of etiquette is what he calls l’affaire de la quête, to which he devotes no less than ten pages. On certain great festivals of the Church, when the King attended mass or vespers, it was the practice for the Queen, or, after her death, the Dauphine, to appoint one of the court-ladies to take round the bag. But the Lorraine princesses, who, according to Saint-Simon, the life-long enemy of their house, were always trying to usurp the privileges of princesses of the blood, quietly avoided this duty. Hence a long and bitter altercation, largely fomented by Saint-Simon, which resulted in the little Duke, on the advice of his friend Chamillart, obtaining an audience with the King, at which, according to his own account, he put the matter before him with great boldness and complete success. Saint-Simon apologises for the length of his narrative, but says with perfect truth that it is from the circumstantial account of such affairs that we get a knowledge of the Court and especially of the King, "so difficult xxxiii to reach, so formidable to his intimates, so full of his despotism,... and yet capable of understanding reason when it was put forcibly before him, provided only the speaker flattered his love of despotism and seasoned his remarks with the most profound respect[9]."
Other questions of privilege loom even larger in Saint-Simon’s narrative. The "monstrueuse usurpation du bonnet or the claim of Messieurs du Parlement" to address the ducs et pairs without uncovering fills two whole chapters[10], while the famous account of the lit de justice of August 26, 1718, which records the triumph of the dukes and peers over two of the chief objects of Saint-Simon’s detestation, the Parlement and the Duc du Maine, occupies from first to last more than half a volume[11]. The narrative has not the same interest as that of the death of Monseigneur, but the passage in which Saint-Simon literally gloats over his triumph is one of the most remarkable in his whole memoirs.
Ce fut là où je savourai avec tous les délices qu’on ne peut exprimer le spectacle de ces fiers légistes, qui osent nous refuser le salut, prosternés à genoux, et rendre à nos pieds un hommage au trône, tandis qu’assis et couverts, sur les hauts sièges du côté du même trône, ces situations et ces postures, si grandement disproportionnées, plaident seules avec tout le perçant de l’évidence la cause de ceux qui, véritablement et d’effet, sont laterales Regis contre ce vas electum du tiers état. Mes yeux fichés, collés sur ces bourgeois superbes, parcouroient tout ce grand banc à genoux ou debout, et les amples replis de ces fourrures ondoyantes à chaque génuflexion longue et redoublée, qui ne finissoit que par le commandement du Roi par la bouche du garde des sceaux, vil petit gris qui voudroit contrefaire l’hermine en peinture, et ces têtes découvertes et humiliés à la hauteur de nos pieds....
Moi cependant je me mourois de joie. J’en étois à craindre la défaillance; mon cœur dilaté à l’excès, ne trouvoit plus d’espace à s’étendre. La violence que je me faisois pour ne rien laisser échapper étoit infinie, et néanmoins ce tourment étoit délicieux.
At the point of laying down his pen Saint-Simon asks indulgence for his style in favour of the truth and exactitude xxxiv which are “the law and the soul” of his memoirs. We have seen that in the matter of truth and exactitude the Memoirs leave something to be desired, but the style needs no apology. The negligences, the repetitions, the occasional obscurity arising from the length of the sentences, to which Saint-Simon pleads guilty, are nothing compared with the general impression of individuality and life. Je ne fus jamais un sujet académique. There is certainly nothing academic about Saint-Simon’s style. It is the style of a man who does not stop to consult a dictionary as to the propriety of his words or the correctness of his constructions, but who is content to use the current language of his day. It is the style of a man who writes under the stress of strong emotion and vivid imagination. We seem to see the pen quivering in the writer’s fingers as he urges it across the paper in a vain endeavour to keep pace with the rapidity of his thought. There are passages, as for instance, the one just cited, which literally vibrate with passion, and the wonder is that while the passion of the orator or the pamphleteer or the satirist is but a transient outburst, that of Saint-Simon, writing, as he often does, years after the event, still glows at a white heat. Moreover, the more violent his passion the better he writes. Nowhere is his style more vivid than when he is recounting the affaire du bonnet. He is equally vigorous and impressive in his attack on Villars at the time of his appointment to the command in Flanders in 1710[12], and in that on Père Tellier in connexion with the bull Unigenitus[13]. His favourite words to express eagerness—pétiller, sécher, griller—are all suggestive of the extreme nervous tension under which he habitually wrote.
Further, it is the style of one who observes closely, and visualises clearly. Some of his portraits stand out as if bitten into metal by the burin of an engraver. A good example of the lively force of his writing is the account of his conversation with the Duc de Beauvillier about the xxxv Duc de Bourgogne and Vendôme. Though the sentence in which he contrasts the characters of the two commanders runs to nearly five hundred and fifty words, it is not in the least involved. It reads like the outpouring of a brilliant talker to whom intense hate has given a lucidity and a power of just expression which is little short of miraculous. The vividness and the colour which help to make Saint-Simon’s style so arresting are greatly helped by his use of homely but pregnant similes, as when he speaks of Mme de Maintenon as seeing the world par le trou d’une bouteille, or describes Mme de Castries as une espèce de biscuit manqué. Nor does he shrink from coining a word, if necessary, though doubtless some of his words, which appear unusual to the modern reader, were current in the conversation of his day.
It must not be imagined that the interest of the Memoirs is always sustained at the same high level. The minor squabbles about etiquette and precedence, the whisperings of contemporary gossip have not the same relish for the modern reader as they had for Saint-Simon. There are certain genealogical chapters, notably the long one on the Rohan family, which will deter all but the stoutest genealogist. But when these deductions have been made the residue is of unsurpassing interest. “With Shakespeare and Saint-Simon,” says Taine, “Balzac is the greatest storehouse of human documents that we possess,” and the claim which he makes on behalf of Saint-Simon is not exaggerated.
Mémoires, ed. A. Chéruel, 20 vols. 1856-1858; ed. A. Chéruel and Ad. Régnier fils, 22 vols. 1873-1881; ed. A. de Boislisle, 1879-1919, vols. I.-XXX.—vol. XXIX. consists of an index to all the preceding volumes (Grands Écrivains de la France).
Écrits inédits, ed. P. Faugère, 8 vols. 1880-1893.
A selection from the Mémoires has been made by C. de Lanneau under the title of Scènes et portraits, 2 vols. 1876; 1914. There is another, under the title of La Cour de Louis XIV, in the Collection Nelson.
There are two English abridged translations, one by Bayle St John, 4 vols. 1857 (and New York, 1902), the other, with notes, by Francis Arkwright, 6 vols. 1915-1918.
A. Chéruel, Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV, 1865; Notice sur la vie et les mémoires du Duc de Saint-Simon, 1876.
Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, III (slight) and XV; Nouveaux Lundis, X.
Taine, Essais de critique et d’histoire.
G. Boissier, Saint-Simon, 1892 (Les grands écrivains français).
É. Faguet, Dix-septième siècle.
A. Le Breton, La “Comédie Humaine” de Saint-Simon, 1914.
C. W. Collins, Saint-Simon, Edinburgh, 1880.
E. Cannan, The Duke of Saint-Simon, Oxford, 1886 (Lothian Prize Essay).
Ce fut un prince à qui on ne peut refuser beaucoup de bon, même de grand, en qui on ne peut méconnoître plus de petit et de mauvais, duquel il n’est pas possible de discerner ce qui étoit de lui ou emprunté, et dans l’un et dans l’autre rien de plus rare que des écrivains qui en aient été bien informés, rien de plus difficile à rencontrer que des gens qui l’aient connu par eux-mêmes et par expérience et capables d’en écrire, en même temps assez maîtres d’eux-mêmes pour en parler sans haine ou sans flatterie, de n’en rien dire que dicté par la vérité nue en bien et en mal. Pour la première partie on peut ici compter sur elle; pour l’autre on tâchera d’y atteindre en suspendant de bonne foi toute passion.
Il ne faut point parler ici de ses premières années. Roi presque en naissant, étouffé par la politique d’une mère qui vouloit gouverner, plus encore par le vif intérêt d’un pernicieux ministre, qui hasarda mille fois l’État pour son unique grandeur, et asservi sous ce joug tant que vécut ce premier ministre, c’est autant de retranché sur le règne de ce monarque. Toutefois il pointoit sous ce joug. Il sentit l’amour, il comprenoit l’oisiveté comme l’ennemie de la gloire; il avoit essayé de foibles parties de main vers l’un et vers l’autre; il eut assez de sentiment pour se croire délivré à la mort de Mazarin, s’il n’eut pas assez de force pour se délivrer plus tôt. C’est même un des 2 beaux endroits de sa vie, et dont le fruit a été du moins de prendre cette maxime, que rien n’a pu ébranler depuis, d’abhorrer tout premier ministre, et non moins tout ecclésiastique dans son conseil. Il en prit dès lors une autre, mais qu’il ne put soutenir avec la même fermeté, parce qu’il ne s’aperçut presque pas dans l’effet qu’elle lui échappa sans cesse: ce fut de gouverner par lui-même, qui fut la chose dont il se piqua le plus, dont on le loua et le flatta davantage, et qu’il exécuta le moins.
Né avec un esprit au-dessous du médiocre[15], mais un esprit capable de se former, de se limer, de se raffiner, d’emprunter d’autrui sans imitation et sans gêne, il profita infiniment d’avoir toute sa vie vécu avec les personnes du monde qui toutes en avoient le plus, et des plus différentes sortes, en hommes et en femmes de tout âge, de tout genre et de tous personnages.
S’il faut parler ainsi d’un roi de vingt-trois ans, sa première entrée dans le monde fut heureuse en esprits distingués de toute espèce. Ses ministres au dedans et au dehors étoient alors les plus forts de l’Europe, ses généraux les plus grands, leurs seconds les meilleurs, et qui sont devenus des capitaines en leur école, et leurs noms aux uns et aux autres ont passé comme tels à la postérité d’un consentement unanime. Les mouvements dont l’État avoit été si furieusement agité au dedans et au dehors, depuis la mort de Louis XIII, avoient formé quantité d’hommes qui composoient une cour d’habiles et d’illustres personnages et de courtisans raffinés.
La maison de la comtesse de Soissons[16], qui, comme surintendante de la maison de la Reine, logeoit à Paris aux Tuileries, où étoit la cour, qui y régnoit par un reste de la splendeur du feu cardinal Mazarin, son oncle, et plus encore par son esprit et son adresse, en étoit devenue le centre, mais fort choisi. C’étoit où se rendoit tous les 3 jours ce qu’il y avoit de plus distingué en hommes et en femmes, qui rendoit cette maison le centre de la galanterie de la cour, et des intrigues et des menées de l’ambition, parmi lesquelles la parenté influoit beaucoup, autant comptée, prisée et respectée lors, qu’elle est maintenant oubliée. Ce fut dans cet important et brillant tourbillon où le Roi se jeta d’abord, et où il prit cet air de politesse et de galanterie qu’il a toujours su conserver toute sa vie, qu’il a si bien su allier avec la décence et la majesté. On peut dire qu’il étoit fait pour elle, et qu’au milieu de tous les autres hommes, sa taille, son port, les grâces, la beauté, et la grande mine qui succéda à la beauté, jusqu’au son de sa voix et à l’adresse et la grâce naturelle et majestueuse de toute sa personne, le faisoient distinguer jusqu’à sa mort comme le roi des abeilles, et que, s’il ne fût né que particulier, il auroit eu également le talent des fêtes, des plaisirs, de la galanterie, et de faire les plus grands désordres d’amour. Heureux s’il n’eût eu que des maîtresses semblables à Mme de la Vallière, arrachée à elle-même par ses propres yeux, honteuse de l’être, encore plus des fruits de son amour, reconnus et élevés malgré elle, modeste, désintéressée, douce, bonne au dernier point, combattant sans cesse contre elle-même, victorieuse enfin de son désordre par les plus cruels effets de l’amour et de la jalousie, qui furent tout à la fois son tourment et sa ressource, qu’elle sut embrasser assez au milieu de ses douleurs pour s’arracher enfin, et se consacrer à la plus dure et la plus sainte pénitence! Il faut donc avouer que le Roi fut plus à plaindre que blâmable de se livrer à l’amour, et qu’il mérite louange d’avoir su s’en arracher par intervalles en faveur de la gloire.
Les intrigues et les aventures que, tout roi qu’il étoit, il essuya dans ce tourbillon de la comtesse de Soissons, lui firent des impressions qui devinrent funestes, pour avoir été plus fortes que lui. L’esprit, la noblesse de sentiments, se sentir, se respecter, avoir le cœur haut, être instruit, tout cela lui devint suspect, et bientôt haïssable. Plus il avança en âge, plus il se confirma dans 4 cette aversion. Il la poussa jusque dans ses généraux et dans ses ministres, laquelle dans eux ne fut contre-balancée que par le besoin, comme on le verra dans la suite. Il vouloit régner par lui-même. Sa jalousie là-dessus alla sans cesse jusqu’à la foiblesse. Il régna en effet dans le petit; dans le grand il ne put y atteindre, et jusque dans le petit il fut souvent gouverné. Son premier saisissement des rênes de l’empire fut marqué au coin d’une extrême dureté et d’une extrême duperie. Fouquet[17] fut le malheureux sur qui éclata la première; Colbert fut le ministre de l’autre, en saisissant seul toute l’autorité des finances, et lui faisant accroire qu’elle passoit toute entre ses mains, par les signatures dont il l’accabla à la place de celles que faisoit le surintendant, dont Colbert supprima la charge, à laquelle il ne pouvoit aspirer.
La préséance solennellement cédée par l’Espagne, et la satisfaction entière qu’elle fit de l’insulte faite à cette occasion par le baron de Vatteville au comte depuis maréchal d’Estrades, ambassadeurs des deux couronnes à Londres[18], et l’éclatante raison tirée de l’insulte faite au duc de Crequy, ambassadeur de France, par le gouverneur de Rome, par les parents du Pape et par les Corses de sa garde, furent les prémices de ce règne par soi-même[19].
5 Bientôt après, la mort du roi d’Espagne fit saisir à ce jeune prince avide de gloire une occasion de guerre, dont les renonciations si récentes, et si soigneusement stipulées dans le contrat de mariage de la Reine, ne purent le détourner. Il marcha en Flandres; ses conquêtes y furent rapides; le passage du Rhin fut signalé; la triple alliance de l’Angleterre, la Suède et la Hollande ne fit que l’animer. Il alla prendre en plein hiver toute la Franche-Comté, qui lui servit, à la paix d’Aix-la-Chapelle, à conserver des conquêtes de Flandres en rendant la Franche-Comté[20].
Tout étoit florissant dans l’État, tout y étoit riche. Colbert avoit mis les finances, la marine, le commerce, les manufactures, les lettres même, au plus haut point; et ce siècle, semblable à celui d’Auguste, produisoit à l’envi des hommes illustres en tout genre, jusqu’à ceux mêmes qui ne sont bons que pour les plaisirs.
Le Tellier et Louvois son fils, qui avoient le département de la guerre, frémissoient des succès et du crédit de Colbert, et n’eurent pas de peine à mettre en tête au Roi une guerre nouvelle, dont les succès causèrent une telle frayeur à l’Europe que la France ne l’en a pu remettre, et que, après y avoir pensé succomber longtemps depuis, elle en sentira longtemps le poids et les malheurs. Telle fut la véritable cause de cette fameuse guerre de Hollande à laquelle le Roi se laissa pousser, et que son amour pour Mme de Montespan rendit si funeste à son État et à sa gloire. Tout conquis, tout pris, et Amsterdam prête à lui envoyer ses clefs, le Roi cède à son impatience, quitte l’armée, vole à Versailles, et détruit en un instant tout le succès de ses armes. Il répara cette flétrissure par une seconde conquête de la Franche-Comté, en personne, qui pour cette fois est demeurée à la France.
En 1676, le Roi retourna en Flandres, prit Condé; et Monsieur Bouchain. Les armées du Roi et du prince d’Orange s’approchèrent si près et si subitement qu’elles 6 se trouvèrent en présence, et sans séparation, auprès de la cense d’Heurtebise[21]. Il fut donc question de décider si on donneroit bataille, et de prendre son parti sur-le-champ. Monsieur n’avoit pas encore joint de Bouchain, mais le Roi étoit sans cela supérieur à l’armée ennemie. Les maréchaux de Schomberg[22], Humières[23], la Feuillade[24], Lorges, etc., s’assemblèrent à cheval autour du Roi, avec quelques-uns des plus distingués d’entre les officiers généraux et des principaux courtisans, pour tenir une espèce de conseil de guerre. Toute l’armée crioit au combat, et tous ces Messieurs voyoient bien ce qu’il y avoit à faire; mais la personne du Roi les embarrassoit, et bien plus Louvois, qui connoissoit son maître, et qui cabaloit depuis deux heures que l’on commençoit d’apercevoir où les choses en pourroient venir. Louvois, pour intimider la compagnie, parla le premier, en rapporteur, pour dissuader la bataille. Le maréchal d’Humières, son ami intime et avec grande dépendance, et le maréchal de Schomberg, qui le ménageoit fort, furent de son avis. Le maréchal de la Feuillade, hors de mesure avec Louvois, mais favori qui ne connoissoit pas moins bien de quel avis il falloit être, après quelques propos douteux, conclut comme eux. M. de Lorges[25], inflexible pour la vérité, touché de la gloire du Roi, sensible au bien de l’État, mal avec Louvois comme le neveu favori de M. de Turenne tué l’année précédente, et qui venoit d’être fait maréchal 7 de France malgré ce ministre, et capitaine des gardes du corps, opina de toutes ses forces pour la bataille, et il en déduisit tellement les raisons, que Louvois même et les maréchaux demeurèrent sans repartie. Le peu de ceux de moindre grade qui parlèrent après osèrent encore moins déplaire à Louvois; mais ne pouvant affoiblir les raisons de M. le maréchal de Lorges, ils ne firent que balbutier. Le Roi, qui écoutoit tout, prit encore les avis, ou plutôt simplement les voix, sans faire répéter ce qui avoit été dit par chacun, puis, avec un petit mot de regret de se voir retenu par de si bonnes raisons, et du sacrifice qu’il faisoit de ses desirs à ce qui étoit de l’avantage de l’État, tourna bride, et il ne fut plus question de bataille.
Le lendemain, et c’est de M. le maréchal de Lorges que je le tiens, qui étoit la vérité même, et à qui je l’ai ouï raconter plus d’une fois et jamais sans dépit, le lendemain, dis-je, il eut occasion d’envoyer un trompette aux ennemis qui se retiroient. Ils le gardèrent un jour ou deux en leur armée. Le prince d’Orange le voulut voir, et le questionna fort sur ce qui avoit empêché le Roi de l’attaquer, se trouvant le plus fort, les deux armées en vue si fort l’une de l’autre, et en rase campagne, sans quoi que ce soit entre-deux. Après l’avoir fait causer devant tout le monde, il lui dit avec un sourire malin, pour montrer qu’il étoit tôt averti, et pour faire dépit au Roi, qu’il ne manquât pas de dire au maréchal de Lorges qu’il avoit grand’raison d’avoir voulu, et si opiniâtrément soutenu la bataille; que jamais lui ne l’avoit manqué si belle, ni été si aise que de s’être vu hors de portée de la recevoir; qu’il étoit battu sans ressource et sans le pouvoir éviter s’il avoit été attaqué, dont il se mit en peu de mots à déduire les raisons. Le trompette, tout glorieux d’avoir eu avec le prince d’Orange un si long et si curieux entretien, le débita non-seulement à M. le maréchal de Lorges, mais au Roi, qui à la chaude le voulut voir, et de là aux maréchaux, aux généraux et à qui le voulut entendre, et augmenta ainsi le dépit de l’armée et en fit un grand à Louvois. Cette faute, et ce genre de faute, ne fit que trop 8 d’impression sur les troupes, et partout excita de cruelles railleries parmi le monde et dans les cours étrangères. Le Roi ne demeura guère à l’armée depuis, quoique on ne fût qu’au mois de mai. Il s’en revint trouver sa maîtresse.
L’année suivante, il retourna en Flandres, il prit Cambray, et Monsieur fit cependant le siège de Saint-Omer. Il fut au-devant du prince d’Orange qui venoit secourir la place, lui donna bataille près de Cassel[26] et remporta une victoire complète, prit tout de suite Saint-Omer, puis alla rejoindre le Roi. Ce contraste fut si sensible au monarque que jamais depuis il ne donna d’armée à commander à Monsieur. Tout l’extérieur fut parfaitement gardé; mais dès ce moment la résolution fut prise, et toujours depuis bien tenue.
L’année d’après le Roi fit en personne le siège de Gand[27], dont le projet et l’exécution fut le chef-d’œuvre de Louvois. La paix de Nimègue[28] mit fin cette année à la guerre avec la Hollande, l’Espagne, etc.; et au commencement de l’année suivante, avec l’Empereur et l’Empire. L’Amérique, l’Afrique, l’Archipel, la Sicile ressentirent vivement la puissance de la France; et en 1684 Luxembourg fut le prix des retardements des Espagnols à satisfaire à toutes les conditions de la paix. Gênes bombardée se vit forcée à venir demander la paix par son doge en personne accompagné de quatre sénateurs, au commencement de l’année suivante. Depuis, jusqu’en 1688, le temps se passa dans le cabinet, moins en fêtes qu’en dévotion et en contrainte. Ici finit l’apogée de ce règne, et ce comble de gloire et de prospérité. Les grands capitaines, les grands ministres au dedans et au dehors n’étoient plus; mais il en restoit les élèves. Nous en allons voir le second âge, qui ne répondra guère au premier, mais qui en tout fut encore plus différent du dernier.
9 La guerre de 1688 eut une étrange origine, dont l’anecdote, également certaine et curieuse, est si propre à caractériser le Roi et Louvois son ministre qu’elle doit tenir place ici[29]. Louvois, à la mort de Colbert, avoit eu sa surintendance des bâtiments. Le petit Trianon de porcelaine, fait autrefois pour Mme de Montespan, ennuyoit le Roi, qui vouloit partout des palais. Il s’amusoit fort à ses bâtiments. Il avoit aussi le compas dans l’œil pour la justesse, les proportions, la symétrie, mais le goût n’y répondoit pas, comme on le verra ailleurs. Ce château ne faisoit presque que sortir de terre, lorsque le Roi s’aperçut d’un défaut à une croisée qui s’achevoit de former, dans la longueur du rez-de-chaussée. Louvois, qui naturellement étoit brutal, et de plus gâté jusqu’à souffrir difficilement d’être repris par son maître, disputa fort et ferme, et maintint que la croisée étoit bien. Le Roi tourna le dos, et s’alla promener ailleurs dans le bâtiment.
Le lendemain il trouve le Nostre[30], bon architecte, mais fameux par le goût des jardins, qu’il a commencé à introduire en France, et dont il a porté la perfection au plus haut point. Le Roi lui demanda s’il avoit été à Trianon. Il répondit que non. Le Roi lui expliqua ce qui l’avoit choqué, et lui dit d’y aller. Le lendemain même question, même réponse; le jour d’après autant. Le Roi vit bien qu’il n’osoit s’exposer à trouver qu’il eût tort, ou à blâmer Louvois. Il se fâcha, et lui ordonna de se trouver le lendemain à Trianon lorsqu’il y iroit, et où il feroit trouver Louvois aussi. Il n’y eut plus moyen de reculer.
Le Roi les trouva le lendemain tous deux à Trianon. Il y fut d’abord question de la fenêtre. Louvois disputa; le Nôtre ne disoit mot. Enfin le Roi lui ordonna d’aligner, de mesurer, et de dire après ce qu’il auroit trouvé. Tandis qu’il y travailloit, Louvois, en furie de cette vérification, grondoit tout haut, et soutenoit avec aigreur que cette 10 fenêtre étoit en tout pareille aux autres. Le Roi se taisoit et attendoit, mais il souffroit. Quand tout fut bien examiné, il demanda au Nôtre ce qui en étoit; et le Nôtre à balbutier. Le Roi se mit en colère, et lui commanda de parler net. Alors le Nôtre avoua que le Roi avoit raison, et dit ce qu’il avoit trouvé de défaut. Il n’eut pas plus tôt achevé que le Roi, se tournant à Louvois, lui dit qu’on ne pouvoit tenir à ses opiniâtretés, que sans la sienne à lui, on auroit bâti de travers, et qu’il auroit fallu tout abattre aussitôt que le bâtiment auroit été achevé: en un mot, il lui lava fortement la tête.
Louvois, outré de la sortie, et de ce que courtisans, ouvriers et valets en avoient été témoins, arrive chez lui furieux. Il y trouva Saint-Pouange, Villacerf, le chevalier de Nogent, les deux Tilladets, quelques autres féaux intimes, qui furent bien alarmés de le voir en cet état. “C’en est fait, leur dit-il; je suis perdu avec le Roi, à la façon dont il vient de me traiter pour une fenêtre. Je n’ai de ressource qu’une guerre qui le détourne de ses bâtiments et qui me rende nécessaire, et par...! il l’aura.” En effet, peu de mois après il tint parole, et malgré le Roi et les autres puissances, il la rendit générale. Elle ruina la France au dedans, ne l’étendit point au dehors, malgré la prospérité de ses armes, et produisit au contraire des événements honteux.
Celui de tous qui porta le plus à plomb sur le Roi fut sa dernière campagne, qui ne dura pas un mois. Il avoit en Flandres deux armées formidables, supérieures du double au moins à celle de l’ennemi, qui n’en avoit qu’une. Le prince d’Orange étoit campé à l’abbaye de Parc, le Roi n’en étoit qu’à une lieue, et M. de Luxembourg avec l’autre armée à une demi-lieue de celle du Roi, et rien entre les trois armées. Le prince d’Orange se trouvoit tellement enfermé qu’il s’estimoit sans ressource dans les retranchements qu’il fit relever à la hâte autour de son camp, et si perdu qu’il le manda à Vaudemont[31], son ami 11 intime, à Bruxelles, par quatre ou cinq fois, et qu’il ne voyoit nulle sorte d’espérance de pouvoir échapper ni sauver son armée. Rien ne la séparait de celle du Roi que ces mauvais retranchements, et rien de plus aisé ni de plus sûr que de le forcer avec l’une des deux armées, et de poursuivre la victoire avec l’autre toute fraîche, et qui toutes deux étoient complètes, indépendamment l’une de l’autre, en équipages de vivres et d’artillerie à profusion.
On étoit aux premiers jours de juin, et que ne promettoit pas une telle victoire au commencement d’une campagne! Aussi l’étonnement fut-il extrême et général dans toutes les trois armées lorsqu’on y apprit que le Roi se retiroit, et faisoit deux gros détachements de presque toute l’armée qu’il commandoit en personne: un pour l’Italie, l’autre pour l’Allemagne sous Monseigneur. M. de Luxembourg, qu’il manda le matin de la veille de son départ pour lui apprendre ces nouvelles dispositions, se jeta à genoux, et tint les siens longtemps embrassés pour l’en détourner, et pour lui remontrer la facilité, la certitude et la grandeur du succès en attaquant le prince d’Orange. Il ne réussit qu’à importuner d’autant plus sensiblement qu’il n’y eut pas un mot à lui opposer. Ce fut une consternation dans les deux armées qui ne se peut représenter. On a vu que j’y étois. Jusqu’aux courtisans, si aises d’ordinaire de retourner chez eux, ne purent contenir leur douleur. Elle éclata partout aussi librement que la surprise, et à l’une et à l’autre succédèrent de fâcheux raisonnements.
Le Roi partit le lendemain pour aller rejoindre Mme de Maintenon et les dames, et retourner avec elles à Versailles[32], pour ne plus revoir la frontière ni d’armées que pour le plaisir et en temps de paix.
La victoire de Neerwinden[33], que M. de Luxembourg remporta six semaines après sur le prince d’Orange, que la nature, prodigieusement aidée de l’art en une seule 12 nuit avoit furieusement retranché, renouvela d’autant plus les douleurs et les discours, qu’il s’en falloit tout que le poste de l’abbaye de Parc ressemblât à celui de Neerwinden, presque tout que nous eussions les mêmes forces, et plus que tout que, faute de vivres et d’équipages suffisants d’artillerie, cette victoire pût être poursuivie.
Pour achever ceci tout à la fois, on sut que le prince d’Orange, averti du départ du Roi, avoit mandé à Vaudemont qu’il en avoit l’avis d’une main toujours bien avertie, et qui ne lui en avoit jamais donné de faux, mais que pour celui-là il ne pouvoit y ajouter foi, ni se livrer à l’espérance, et par un second courrier, que l’avis étoit vrai, que le Roi partoit, que c’étoit à son esprit de vertige et d’aveuglement qu’il devoit uniquement une si inespérée délivrance. Le rare est que Vaudemont, établi longtemps depuis en notre cour, l’a souvent conté à ses amis, même à ses compagnies, et jusque dans le salon de Marly.
La paix qui suivit cette guerre, et après laquelle le Roi et l’État aux abois soupiroient depuis longtemps, fut honteuse. Il fallut en passer par où M. de Savoie[34] voulut, pour le détacher de ses alliés, et reconnoître enfin le prince d’Orange pour roi d’Angleterre, après une si longue suite d’efforts, de haine et de mépris personnels, et recevoir encore Portland[35], son ambassadeur, comme une espèce de divinité. Notre précipitation nous coûta Luxembourg, et l’ignorance militaire de nos plénipotentiaires, qui ne fut point éclairée du cabinet, donna aux ennemis de grands avantages pour former leur frontière. Telle fut la paix de Ryswick conclue en septembre 1697.
Le repos des armes ne fut guère que de trois ans, et on sentit cependant toute la douleur des restitutions de pays et de places que nous avions conquis, avec le poids de 13 tout ce que la guerre avoit coûté. Ici se termine le second âge de ce règne.
Le troisième s’ouvrit par un comble de gloire et de prospérité inouïe. Le temps en fut momentané. Il enivra et prépara d’étranges malheurs, dont l’issue a été une espèce de miracle. D’autres sortes de malheurs accompagnèrent et conduisirent le Roi au tombeau, heureux s’il n’eût survécu que de peu de mois l’avénement de son petit-fils à la totalité de la monarchie d’Espagne, dont il fut d’abord en possession sans coup férir. Cette dernière époque est encore si proche de ce temps qu’il n’y a pas lieu de s’y étendre. Mais ce peu qui a été retracé du règne du feu Roi étoit nécessaire pour mieux faire entendre ce qu’on va dire de sa personne, en se souvenant toutefois de ce qui s’en trouve épars dans ces Mémoires, et ne se dégoûtant pas s’il s’y en trouve de redites, nécessaires pour mieux rassembler et former un tout.
Il faut encore le dire. L’esprit du Roi étoit au-dessous du médiocre, mais très capable de se former. Il aima la gloire, il voulut l’ordre et la règle. Il étoit né sage, modéré, secret, maître de ses mouvements et de sa langue; le croira-t-on? il étoit né bon et juste, et Dieu lui en avoit donné assez pour être un bon roi, et peut-être même un assez grand roi. Tout le mal lui vint d’ailleurs. Sa première éducation fut tellement abandonnée, que personne n’osoit approcher de son appartement. On lui a souvent ouï parler de ces temps avec amertume, jusque-là qu’il racontoit qu’on le trouva un soir tombé dans le bassin du jardin du Palais-Royal à Paris, où la cour demeuroit alors.
Dans la suite, sa dépendance fut extrême. A peine lui apprit-on à lire et à écrire, et il demeura tellement ignorant que les choses le plus connues d’histoire, d’événements, de fortunes, de conduites, de naissance, de lois, il n’en sut jamais un mot[36]. Il tomba, par ce défaut 14 et quelquefois en public, dans les absurdités les plus grossières.
M. de la Feuillade plaignant exprès devant lui le marquis de Renel, qui fut tué depuis lieutenant général et mestre de camp général de la cavalerie, de n’avoir pas été chevalier de l’ordre en 1661, le Roi passa, puis dit avec mécontentement qu’il falloit aussi se rendre justice. Renel étoit Clermont Gallerande ou d’Amboise, et le Roi, qui depuis n’a été rien moins que délicat là-dessus, le croyoit un homme de fortune. De cette même maison étoit Montglat, maître de sa garde-robe, qu’il traitoit bien et qu’il fit chevalier de l’ordre en 1661, qui a laissé de très bons Mémoires[37]. Montglat avoit épousé la fille du fils du chancelier de Cheverny. Leur fils unique porta toute sa vie le nom de Cheverny[38], dont il avoit la terre[39]. Il passa sa vie à la cour, et j’en ai parlé quelquefois, ou dans les emplois étrangers. Ce nom de Cheverny trompa le Roi; il le crut peu de chose; il n’avoit point de charge, et ne put être chevalier de l’ordre. Le hasard détrompa le Roi à la fin de sa vie. Saint-Hérem[40] [qui] avoit passé la sienne grand louvetier, puis gouverneur et capitaine de Fontainebleau, ne put être chevalier de l’ordre. Le Roi, qui le savoit beau-frère de Courtin, conseiller d’État, qu’il connoissoit, le crut par là fort peu de chose. Il étoit Montmorin, et le Roi ne le sut que fort tard par M. de la Rochefoucauld[41]. Encore lui fallut-il expliquer quelles étoient ces maisons, que leur nom ne lui apprenoit pas.
Il sembleroit à cela que le Roi auroit aimé la grande noblesse, et ne lui en vouloit pas égaler d’autres; rien 15 moins. L’éloignement qu’il avoit pris de celle des sentiments, et sa foiblesse pour ses ministres, qui haïssoient et rabaissoient, pour s’élever, tout ce qu’ils n’étoient pas et ne pouvoient pas être, lui avoit donné le même éloignement pour la naissance distinguée. Il la craignoit autant que l’esprit; et si ces deux qualités se trouvoient unies dans un même sujet, et qu’elles lui fussent connues, c’en étoit fait.
Ses ministres, ses généraux, ses maîtresses, ses courtisans s’aperçurent, bientôt après qu’il fut le maître, de son foible plutôt que de son goût pour la gloire. Ils le louèrent à l’envi et le gâtèrent. Les louanges, disons mieux, la flatterie lui plaisoit à tel point, que les plus grossières étoient bien reçues, les plus basses encore mieux savourées. Ce n’étoit que par là qu’on s’approchoit de lui, et ceux qu’il aima n’en furent redevables qu’à heureusement rencontrer, et à ne se jamais lasser en ce genre. C’est ce qui donna tant d’autorité à ses ministres, par les occasions continuelles qu’ils avoient de l’encenser, surtout de lui attribuer toutes choses, et de les avoir apprises de lui. La souplesse, la bassesse, l’air admirant, dépendant, rampant, plus que tout l’air de néant sinon par lui, étoient les uniques voies de lui plaire. Pour peu qu’on s’en écartât on n’y revenoit plus, et c’est ce qui acheva la ruine de Louvois.
Ce poison ne fit que s’étendre. Il parvint jusqu’à un comble incroyable dans un prince qui n’étoit pas dépourvu d’esprit et qui avoit de l’expérience. Lui-même, sans avoir ni voix ni musique[42], chantoit dans ses particuliers les endroits les plus à sa louange des prologues des opéras. On l’y voyoit baigné, et jusqu’à ses soupers publics au grand couvert, où il y avoit quelquefois des violons, il chantonnoit entre ses dents les mêmes louanges quand on jouoit les airs qui étoient faits dessus.
De là ce desir de gloire qui l’arrachoit par intervalles à l’amour; de là cette facilité à Louvois de l’engager en de 16 grandes guerres, tantôt pour culbuter Colbert, tantôt pour se maintenir ou s’accroître, et de lui persuader en même temps qu’il étoit plus grand capitaine qu’aucun de ses généraux, et pour les projets et pour les exécutions, en quoi les généraux l’aidoient eux-mêmes pour plaire au Roi. Je dis les Condé, les Turenne, et à plus forte raison tous ceux qui leur ont succédé. Il s’approprioit tout avec une facilité et une complaisance admirable en lui-même, et se croyoit tel qu’ils le dépeignoient en lui parlant. De là ce goût de revues, qu’il poussa si loin que ses ennemis l’appeloient le roi des revues, ce goût de sièges pour y montrer sa bravoure à bon marché[43], s’y faire retenir à force, étaler sa capacité, sa prévoyance, sa vigilance, ses fatigues, auxquelles son corps robuste et admirablement conformé, étoit merveilleusement propre, sans souffrir de la faim, de la soif, du froid, du chaud, de la pluie, ni d’aucun mauvais temps. Il étoit sensible aussi à entendre admirer, le long des camps, son grand air et sa grande mine, son adresse à cheval et tous ses travaux. C’étoit de ses campagnes et de ses troupes qu’il entretenoit le plus ses maîtresses, quelquefois ses courtisans. Il parloit bien, en bons termes, avec justesse; il faisoit un conte mieux qu’homme du monde, et aussi bien un récit. Ses discours les plus communs n’étoient jamais dépourvus d’une naturelle et sensible majesté.
Son esprit, naturellement porté au petit, se plut en toutes sortes de détails. Il entra sans cesse dans les derniers sur les troupes: habillements, armements, évolutions, exercices, discipline, en un mot, toutes sortes de bas détails. Il ne s’en occupoit pas moins sur ses bâtiments, sa maison civile, ses extraordinaires de bouche; il croyoit toujours apprendre quelque chose à ceux qui en ces genres-là en savoient le plus, qui de leur part recevoient en novices des leçons qu’ils savoient par cœur il y avoit longtemps. Ces pertes de temps, qui paroissoient au Roi avec tout le mérite d’une application continuelle, étoient 17 le triomphe de ses ministres, qui avec un peu d’art et d’expérience à le tourner, faisoient venir comme de lui ce qu’ils vouloient eux-mêmes et qui conduisoient le grand selon leurs vues et trop souvent selon leur intérêt, tandis qu’ils s’applaudissoient de le voir se noyer dans ces détails[44].
La vanité et l’orgueil, qui vont toujours croissant, qu’on nourrissoit et qu’on augmentoit en lui sans cesse, sans même qu’il s’en aperçut, et jusque dans les chaires par les prédicateurs en sa présence, devinrent la base de l’exaltation de ses ministres par-dessus toute autre grandeur. Il se persuadoit par leur adresse que la leur n’étoit que la sienne, qui, au comble en lui, ne se pouvoit plus mesurer, tandis qu’en eux elle l’augmentoit d’une manière sensible, puisqu’ils n’étoient rien par eux-mêmes, et utile en rendant plus respectables les organes de ses commandements qui les faisoient mieux obéir. De là les secrétaires d’État et les ministres successivement à quitter le manteau, puis le rabat, après l’habit noir, ensuite l’uni, le simple, le modeste, enfin à s’habiller comme les gens de qualité; de là à en prendre les manières, puis les avantages, et par échelons admis à manger avec le Roi, et leurs femmes, d’abord sous des prétextes personnels, comme Mme Colbert longtemps avant Mme de Louvois, enfin, des années après elle, toutes à titre de droit des places de leurs maris, manger et entrer dans les carrosses, et n’être en rien différentes des femmes de la première qualité.
De ce degré, Louvois, sous divers prétextes, ôta les honneurs civils et militaires dans les places et dans les provinces à ceux à qui on ne les avoit jamais disputés, et à cesser d’écrire Monseigneur aux mêmes, comme il avoit toujours été pratiqué. Le hasard m’en a conservé trois de M. Colbert, lors contrôleur général, ministre d’État et secrétaire d’État, à mon père à Blaye, dont la suscription et le dedans le traitent de Monseigneur, et que Mgr le duc de Bourgogne, à qui je les montrai, vit avec 18 grand plaisir. M. de Turenne, dans l’éclat où il étoit alors, sauva le rang de prince de l’écriture, c’est-à-dire sa maison, qui l’avoit eu par le cardinal Mazarin, et conséquemment les maisons de Lorraine et de Savoie; car les Rohans ne l’ont jamais pu obtenir, et c’est peut-être la seule chose où ait échoué la beauté de Mme de Soubise. Ils ont été plus heureux depuis. M. de Turenne sauva aussi les maréchaux de France pour les honneurs militaires; ainsi pour sa personne il conserva les deux. Incontinent après, Louvois s’attribua ce qu’il venoit d’ôter à bien plus grands que lui, et le communiqua aux autres secrétaires d’État. Il usurpa les honneurs militaires, que ni les troupes, ni qui que ce soit, n’osa refuser à sa puissance d’élever et de perdre qui bon lui sembloit; et il prétendit que tout ce qui n’étoit point duc ni officier de la couronne, ou ce qui n’avoit point le rang de prince étranger ni de tabouret de grâce[45], lui écrivît Monseigneur, et lui leur répondre dans la souscription: très humble et très affectionné serviteur, tandis que le dernier maître des requêtes, ou conseiller au Parlement, lui écrivoit Monsieur, sans qu’il ait jamais prétendu changer cet usage.
Ce fut d’abord un grand bruit: les gens de la première qualité, les chevaliers de l’ordre, les gouverneurs et les lieutenants généraux des provinces, et, à leur suite, les gens de moindre qualité, et les lieutenants généraux des armées se trouvèrent infiniment offensés d’une nouveauté si surprenante et si étrange. Les ministres avoient su persuader au Roi l’abaissement de tout ce qui étoit élevé, et que leur refuser ce traitement, c’étoit mépriser son autorité et son service, dont ils étoient les organes, parce que d’ailleurs, et par eux-mêmes, ils n’étoient rien. Le Roi, séduit par ce reflet prétendu de grandeur sur lui-même, s’expliqua si durement à cet égard, qu’il ne fut plus question que de ployer sous ce nouveau style, ou de quitter le service, et tomber en même temps, ceux qui quittoient, et ceux qui ne servoient pas même, dans la 19 disgrâce marquée du Roi, et sous la persécution des ministres, dont les occasions se rencontroient à tous moments.
Plusieurs gens distingués qui ne servoient point, et plusieurs gens de guerre du premier mérite et des premiers grades, aimèrent mieux renoncer à tout et perdre leur fortune, et la perdirent en effet, et la plupart pis encore; et dans la suite assez prompte, peu à peu personne ne fit plus aucune difficulté là-dessus.
De là l’autorité personnelle et particulière des ministres montée au comble, jusqu’en ce qui ne regardoit ni les ordres ni le service du Roi, sous l’ombre que c’étoit la sienne; de là ce degré de puissance qu’ils usurpèrent; de là leurs richesses immenses, et les alliances qu’ils firent tous à leur choix.
Quelque ennemis qu’ils fussent les uns des autres, l’intérêt commun les rallioit chaudement sur ces matières, et cette splendeur usurpée sur tout le reste de l’État dura autant que dura le règne de Louis XIV. Il en tiroit vanité, il n’en étoit pas moins jaloux qu’eux; il ne vouloit de grandeur que par émanation de la sienne. Toute autre lui étoit devenue odieuse. Il avoit sur cela des contrariétés qui ne se comprenoient pas, comme si les dignités, les charges, les emplois avec leurs fonctions, leurs distinctions, leurs prérogatives n’émanoient pas de lui comme les places de ministre et les charges de secrétaire d’État[46] qu’il comptoit seules de lui, lesquels pour cela il portoit au faîte, et abattoit tout le reste sous leurs pieds.
Une autre vanité personnelle l’entraîna encore dans cette conduite. Il sentoit bien qu’il pouvoit accabler un seigneur sous le poids de sa disgrâce, mais non pas l’anéantir, ni les siens, au lieu qu’en précipitant un secrétaire d’État de sa place, ou un autre ministre de la même espèce, il le replongeoit lui et tous les siens dans la profondeur du néant d’où cette place l’avoit tiré, sans que les richesses qui lui pourroient rester le pussent relever de ce non-être. C’est là ce qui le faisoit se complaire 20 à faire régner ses ministres sur les plus élevés de ses sujets, sur les princes de son sang en autorité comme sur les autres, et sur tout ce qui n’avoit ni rang ni office de la couronne, en grandeur comme en autorité au-dessus d’eux. C’est aussi ce qui éloigna toujours du ministère tout homme qui pouvoit y ajouter du sien ce que le Roi ne pouvoit ni détruire ni lui conserver, ce qui lui auroit rendu un ministre de cette sorte en quelque façon redoutable et continuellement à charge, dont l’exemple du duc de Beauvillier[47] fut l’exception unique dans tout le cours de son règne, comme il a été remarqué en parlant de ce duc, le seul homme noble qui ait été admis dans son conseil depuis la mort du cardinal Mazarin jusqu’à la sienne, c’est-à-dire pendant cinquante-quatre ans; car, outre ce qu’il y auroit à dire sur le maréchal de Villeroy, le peu de mois qu’il y a été depuis la mort du duc de Beauvillier jusqu’à celle du Roi ne peut pas être compté, et son père n’a jamais entré dans le conseil d’État[48].
De là encore la jalousie si précautionnée des ministres, qui rendit le Roi si difficile à écouter tout autre qu’eux, tandis qu’il s’applaudissoit d’un accès facile, et qu’il croyoit qu’il y alloit de sa grandeur, de la vénération et de la crainte dont il se complaisoit d’accabler les plus grands, de se laisser approcher autrement qu’en passant. Ainsi le grand seigneur comme le plus subalterne de tous états, parloit librement au Roi en allant ou revenant de la messe, en passant d’un appartement à un autre, ou allant monter en carrosse; les plus distingués, même quelques autres, à la porte de son cabinet, mais sans oser l’y suivre. C’est à quoi se bornoit la facilité de son accès. Ainsi on ne pouvoit s’expliquer qu’en deux mots, d’une manière fort incommode, et toujours entendu de plusieurs qui environnoient le Roi, ou, si on étoit plus connu de lui, dans sa perruque, ce qui n’étoit guère plus avantageux. 21 La réponse sûre étoit un "je verrai[49]," utile à la vérité pour s’en donner le temps, mais souvent bien peu satisfaisante, moyennant quoi tout passoit nécessairement par les ministres, sans qu’il pût y avoir jamais d’éclaircissement, ce qui les rendoit les maîtres de tout, et le Roi le vouloit bien, ou ne s’en apercevoit pas.
D’audiences à en espérer dans son cabinet, rien n’étoit plus rare, même pour les affaires du Roi dont on avoit été chargé. Jamais, par exemple, à ceux qu’on envoyoit ou qui revenoient d’emplois étrangers, jamais à pas un officier général, si on en excepte certains cas très singuliers, et encore, mais très rarement, quelqu’un de ceux qui étoient chargés de ces détails de troupes où le Roi se plaisoit tant; de courtes aux généraux d’armées qui partoient, et en présence du secrétaire d’État de la guerre, de plus courtes à leur retour, quelquefois ni en partant, ni en revenant. Jamais de lettres d’eux qui allassent directement au Roi sans passer auparavant par le ministre, si on en excepte quelques occasions infiniment rares et momentanées, et le seul M. de Turenne sur la fin, qui, ouvertement brouillé avec Louvois, et brillant de gloire et de la plus haute considération, adressoit ses dépêches au cardinal de Bouillon[50], qui les remettoit directement au Roi, qui n’en étoient pas moins vues après par le ministre, avec lequel les ordres et les réponses étoient concertés.
La vérité est pourtant que, quelque gâté que fût le Roi sur sa grandeur et sur son autorité, qui avoit étouffé toute autre considération en lui, il y avoit à gagner dans ses audiences, quand on pouvoit tant faire que de les obtenir, et qu’on savoit s’y conduire avec tout le respect qui étoit dû à la royauté et à l’habitude. Outre ce que j’en ai su d’ailleurs, j’en puis parler par expérience. On a vu en leur temps ici que j’ai obtenu, et même usurpé, et forcé le Roi fort en colère contre moi, et toujours sorti 22 lui persuadé et content de moi, et le marquer après et à moi et à d’autres. Je puis donc aussi parler de ces audiences qu’on en avoit quelquefois par ma propre expérience.
Là, quelque prévenu qu’il fût, quelque mécontentement qu’il crût avoir lieu de sentir, il écoutoit avec patience, avec bonté, avec envie de s’éclaircir et de s’instruire; il n’interrompoit que pour y parvenir. On y découvroit un esprit d’équité et de desir de connoître la vérité, et cela quoique en colère quelquefois, et cela jusqu’à la fin de sa vie. Là, tout se pouvoit dire, pourvu, encore une fois, que ce fût avec cet air de respect, de soumission, de dépendance, sans lequel on se seroit encore plus perdu que devant, mais avec lequel aussi, en disant vrai, on interrompoit le Roi à son tour, on lui nioit crûment des faits qu’il rapportoit, on élevoit le ton au-dessus du sien en lui parlant, et tout cela non-seulement sans qu’il le trouvât mauvais, mais se louant après de l’audience qu’il avoit donnée et de celui qui l’avoit eue, se défaisant des préjugés qu’il avoit pris, ou des faussetés qu’on lui avoit imposées, et le marquant après par ses traitements. Aussi les ministres avoient-ils grand soin d’inspirer au Roi l’éloignement d’en donner, à quoi ils réussirent comme dans tout le reste.
C’est ce qui rendoit les charges qui approchoient de la personne du Roi si considérables, et ceux qui les possédoient si considérés, et des ministres mêmes, par la facilité qu’ils avoient tous les jours de parler au Roi, seuls, sans l’effaroucher d’une audience qui étoit toujours sue, et de l’obtenir sûrement, et sans qu’on s’en aperçût, quand ils en avoient besoin. Surtout les grandes entrées, par cette même raison, étoient le comble des grâces, encore plus que de la distinction, et c’est ce qui, dans les grandes récompenses des maréchaux de Boufflers[51] et de 23 Villars[52], les fit mettre de niveau à la pairie et à la survivance de leurs gouvernements à leurs enfants tout jeunes, dans le temps que le Roi n’en donnoit plus à personne.
C’est donc avec grande raison qu’on doit déplorer avec larmes l’horreur d’une éducation uniquement dressée pour étouffer l’esprit et le cœur de ce prince, le poison abominable de la flatterie la plus insigne, qui le déifia dans le sein même du christianisme, et la cruelle politique de ses ministres, qui l’enferma, et qui pour leur grandeur, leur puissance et leur fortune l’enivrèrent de son autorité, de sa grandeur, de sa gloire jusqu’à le corrompre, et à étouffer en lui, sinon toute la bonté, l’équité, le desir de connoître la vérité, que Dieu lui avoit donné, au moins l’émoussèrent presque entièrement, et empêchèrent au moins sans cesse qu’il fit aucun usage de ces vertus, dont son royaume et lui-même furent les victimes.
De ces sources étrangères et pestilentielles lui vint cet orgueil, que ce n’est point trop de dire que, sans la crainte du diable que Dieu lui laissa jusque dans ses plus grands désordres, il se seroit fait adorer et auroit trouvé des adorateurs; témoin entre autres ces monuments si outrés, pour en parler même sobrement, sa statue de la place des Victoires[53], et sa païenne dédicace, où j’étois, où il prit un plaisir si exquis; et de cet orgueil en tout le reste qui le perdit, dont on vient de voir tant d’effets funestes, et dont d’autres plus funestes encore se vont retrouver.
La cour fut un autre manège de la politique du despotisme. On vient de voir celle qui divisa, qui humilia, qui confondit les plus grands, celle qui éleva les ministres 24 au-dessus de tous, en autorité et en puissance par-dessus les princes du sang, en grandeur même par-dessus les gens de la première qualité, après avoir totalement changé leur état. Il faut montrer les progrès en tous genres de la même conduite dressée sur le même point de vue.
Plusieurs choses contribuèrent à tirer pour toujours la cour hors de Paris, et à la tenir sans interruption à la campagne[54]. Les troubles de la minorité, dont cette ville fut le grand théâtre, en avoient imprimé au Roi de l’aversion, et la persuasion encore que son séjour y étoit dangereux, et que la résidence de la cour ailleurs rendroit à Paris les cabales moins aisées par la distance des lieux, quelque peu éloignés qu’ils fussent, et en même temps plus difficiles à cacher par les absences si aisées à remarquer. Il ne pouvoit pardonner à Paris sa sortie fugitive de cette ville la veille des Rois 16[49], ni de l’avoir rendue, malgré lui, témoin de ses larmes, à la première retraite de Mme de la Vallière. L’embarras des maîtresses, et le danger de pousser de grands scandales au milieu d’une capitale si peuplée, et si remplie de tant de différents esprits, n’eut pas peu de part à l’en éloigner. Il s’y trouvoit importuné de la foule du peuple à chaque fois qu’il sortoit, qu’il rentroit, qu’il paroissoit dans les rues; il ne l’étoit pas moins d’une autre sorte de foule de gens de la ville, et qui n’étoit pas pour l’aller chercher assidûment plus loin. Des inquiétudes aussi, qui ne furent pas plus tôt aperçues que les plus familiers de ceux qui étoient commis à sa garde, le vieux Noailles, M. de Lauzun, et quelques subalternes, firent leur cour de leur vigilance, et furent accusés de multiplier exprès de faux avis, qu’ils se faisoient donner pour avoir occasion de se faire valoir et d’avoir plus souvent des particuliers avec le Roi; le goût de la promenade et de la chasse, bien plus commodes à la campagne qu’à Paris, éloigné des forêts et stérile en lieux de promenades; celui des bâtiments qui vint après, et peu à peu toujours croissant, ne lui en permettoit pas l’amusement 25 dans une ville où il n’auroit pu éviter d’y être continuellement en spectacle; enfin l’idée de se rendre plus vénérable en se dérobant aux yeux de la multitude, et à l’habitude d’en être vu tous les jours: toutes ces considérations fixèrent le Roi à Saint-Germain bientôt après la mort de la Reine sa mère[55].
Ce fut là où il commença à attirer le monde par les fêtes et les galanteries, et à faire sentir qu’il vouloit être vu souvent.
L’amour de Mme de la Vallière, qui fut d’abord un mystère, donna lieu à de fréquentes promenades à Versailles, petit château de cartes alors, bâti par Louis XIII ennuyé, et sa suite encore plus, d’y avoir souvent couché dans un méchant cabaret à rouliers et dans un moulin à vent, excédés de ses longues chasses dans la forêt de Saint-Léger et plus loin encore, loin alors de ces temps réservés à son fils où les routes, la vitesse des chiens et le nombre gagé des piqueurs et des chasseurs à cheval a rendu les chasses si aisées et si courtes. Ce monarque ne couchoit jamais ou bien rarement à Versailles qu’une nuit, et par nécessité; le Roi son fils pour être plus en particulier avec sa maîtresse, plaisirs inconnus au Juste, au héros digne fils de saint Louis, qui bâtit ce petit Versailles.
Ces petites parties de Louis XIV y firent naître peu à peu ces bâtiments immenses qu’il y a faits; et leur commodité pour une nombreuse cour, si différente des logements de Saint-Germain, y transporta tout à fait sa demeure peu de temps avant la mort de la Reine. Il y fit des logements infinis, qu’on lui faisoit sa cour de lui demander, au lieu qu’à Saint-Germain, presque tout le monde avoit l’incommodité d’être à la ville, et le peu qui étoit logé au château y étoit étrangement à l’étroit[56].
Les fêtes fréquentes, les promenades particulières à Versailles, les voyages furent des moyens que le Roi 26 saisit pour distinguer et pour mortifier en nommant les personnes qui à chaque fois en devoient être, et pour tenir chacun assidu et attentif à lui plaire. Il sentoit qu’il n’avoit pas à beaucoup près assez de grâces à répandre pour faire un effet continuel. Il en substitua donc aux véritables d’idéales, par la jalousie, les petites préférences qui se trouvoient tous les jours, et pour ainsi dire à tous moments, par son art. Les espérances que ces petites préférences et ces distinctions faisoient naître, et la considération qui s’en tiroit, personne ne fut plus ingénieux que lui à inventer sans cesse ces sortes de choses. Marly, dans la suite, lui fut en cela d’un plus grand usage, et Trianon où tout le monde, à la vérité, pouvoit lui aller faire sa cour, mais où les dames avoient l’honneur de manger avec lui, et où à chaque repas elles étoient choisies; le bougeoir qu’il faisoit tenir tous les soirs à son coucher par un courtisan qu’il vouloit distinguer, et toujours entre les plus qualifiés de ceux qui s’y trouvoient, qu’il nommoit tout haut au sortir de sa prière. Les justaucorps à brevet fut une autre de ces inventions. Il étoit bleu doublé de rouge avec les parements et la veste rouge, brodés d’un dessin magnifique or et un peu d’argent, particulier à ces habits. Il n’y en avoit qu’un nombre, dont le Roi, sa famille, et les princes du sang étoient; mais ceux-ci, comme le reste des courtisans, n’en avoient qu’à mesure qu’il en vaquoit. Les plus distingués de la cour par eux-mêmes ou par la faveur les demandoient au Roi, et c’étoit une grâce que d’en obtenir. Le secrétaire d’État ayant la maison du Roi en son département[57] en expédioit un brevet, et nul d’eux n’étoit à portée d’en avoir. Ils furent imaginés pour ceux, en très petit nombre, qui avoient la liberté de suivre le Roi aux promenades de Saint-Germain à Versailles sans être nommés, et depuis que cela cessa, ces habits ont cessé aussi de donner aucun privilège, excepté celui d’être portés quoique on fût en deuil de cour ou de famille, pourvu que le deuil ne fût pas grand ou qu’il fût sur ses fins, et dans les temps encore où il étoit défendu 27 de porter de l’or et de l’argent. Je ne l’ai jamais vu porter au Roi, à Monseigneur ni à Monsieur, mais très souvent aux trois fils de Monseigneur et à tous les autres princes, et jusqu’à la mort du Roi, dès qu’il en vaquoit un, c’étoit à qui l’auroit entre les gens de la cour les plus considérables, et si un jeune seigneur l’obtenoit c’étoit une grande distinction. Les différentes adresses de cette nature qui se succédèrent les unes aux autres, à mesure que le Roi avança en âge, et que les fêtes changeoient ou diminuoient, et les attentions qu’il marquoit pour avoir toujours une cour nombreuse, on ne finiroit point à les expliquer.
Non-seulement il étoit sensible à la présence continuelle de ce qu’il y avoit de distingué, mais il l’étoit aussi aux étages inférieurs. Il regardoit à droite et à gauche à son lever, à son coucher, à ses repas, en passant dans les appartements, dans ses jardins de Versailles, où seulement les courtisans avoient la liberté de le suivre; il voyoit et remarquoit tout le monde; aucun ne lui échappoit, jusqu’à ceux qui n’espéroient pas même être vus. Il distinguoit très bien en lui-même les absences de ceux qui étoient toujours à la cour, celles des passagers qui y venoient plus ou moins souvent; les causes générales ou particulières de ces absences, il les combinoit, et ne perdoit pas la plus légère occasion d’agir à leur égard en conséquence. C’étoit un démérite aux uns, et à tout ce qu’il y avoit de distingué, de ne faire pas de la cour son séjour ordinaire, aux autres d’y venir rarement, et une disgrâce sûre pour qui n’y venoit jamais, ou comme jamais. Quand il s’agissoit de quelque chose pour eux: “Je ne le connois point,” répondoit-il fièrement. Sur ceux qui se présentoient rarement: “C’est un homme que je ne vois jamais”; et ces arrêts-là étoient irrévocables. C’étoit un autre crime de n’aller point à Fontainebleau, qu’il regardoit comme Versailles, et pour certaines gens de ne demander pas pour Marly, les uns toujours, les autres souvent, quoique sans dessein de les y mener, les uns toujours ni les autres souvent; mais si on étoit sur le pied d’y aller toujours, il falloit une excuse valable pour s’en dispenser, 28 hommes et femmes de même. Surtout il ne pouvoit souffrir les gens qui se plaisoient à Paris. Il supportoit assez aisément ceux qui aimoient leur campagne, encore y falloit-il être mesuré ou avoir pris ses précautions avant d’y aller passer un temps un peu long.
Cela ne se bornoit pas aux personnes en charge, ou familières, ou bien traitées, ni à celles que leur âge ou leur représentation marquoit plus que les autres. La destination seule suffisoit dans les gens habitués à la cour. On a vu sur cela, en son lieu, l’attention qu’eut le Roi à un voyage que je fis à Rouen pour un procès, tout jeune que j’étois, et à m’y faire écrire de sa part par Pontchartrain[58] pour en savoir la raison.
Louis XIV s’étudioit avec grand soin à être bien informé de ce qui se passoit partout, dans les lieux publics, dans les maisons particulières, dans le commerce du monde, dans le secret des familles et des liaisons. Les espions et les rapporteurs étoient infinis. Il en avoit de toute espèce: plusieurs qui ignoroient que leurs délations allassent jusqu’à lui, d’autres qui le savoient, quelques-uns qui lui écrivoient directement en faisant rendre leurs lettres par les voies qu’il leur avoit prescrites, et ces lettres-là n’étoient vues que de lui, et toujours avant toutes autres choses, quelques autres enfin qui lui parloient quelquefois secrètement dans ses cabinets, par les derrières. Ces voies inconnues rompirent le cou à une infinité de gens de tous états, sans qu’ils en aient jamais pu découvrir la cause, souvent très injustement, et le Roi, une fois prévenu, ne revenoit jamais, ou si rarement que rien ne l’étoit davantage[59].
Il avoit encore un défaut bien dangereux pour les autres, et souvent pour lui-même par la privation de bons sujets. C’est que, encore qu’il eût la mémoire excellente 29 et pour reconnoître un homme du commun qu’il avoit vu une fois, au bout de vingt ans, et pour les choses qu’il avoit sues, et qu’il ne confondoit point, il n’étoit pourtant pas possible qu’il se souvînt de tout, au nombre infini de ce qui chaque jour venoit à sa connoissance. S’il lui étoit revenu quelque chose de quelqu’un qu’il eût oublié de la sorte, il lui restoit imprimé qu’il y avoit quelque chose contre lui, et c’en étoit assez pour l’exclure. Il ne cédoit point aux représentations d’un ministre, d’un général, de son confesseur même, suivant l’espèce de chose ou de gens dont il s’agissoit. Il répondoit qu’il ne savoit plus ce qui lui en étoit revenu, mais qu’il étoit plus sûr d’en prendre un autre dont il ne lui fût rien revenu du tout.
Ce fut à sa curiosité que les dangereuses fonctions du lieutenant de police furent redevables de leur établissement[60]. Elles allèrent depuis toujours croissant. Ces officiers ont tous été sous lui plus craints, plus ménagés, aussi considérés que les ministres, jusque par les ministres mêmes, et il n’y avoit personne en France, sans en excepter les princes du sang, qui n’eût intérêt de les ménager, et qui ne le fît. Outre les rapports sérieux qui lui revenoient par eux, il se divertissoit d’en apprendre toutes les galanteries et toutes les sottises de Paris. Pontchartrain, qui avoit Paris et la cour dans son département, lui faisoit tellement sa cour par cette voie indigne, dont son père étoit outré, qu’elle le soutint souvent auprès du Roi, et de l’aveu du Roi même, contre de rudes atteintes auxquelles sans cela il auroit succombé, et on l’a su plus d’une fois par Mme de Maintenon, par Mme la duchesse de Bourgogne, par M. le comte de Toulouse, par les valets intérieurs.
Mais la plus cruelle de toutes les voies par laquelle le Roi fut instruit bien des années avant qu’on s’en fut 30 aperçu, et par laquelle l’ignorance et l’imprudence de beaucoup de gens continua toujours encore de l’instruire, fut celle de l’ouverture des lettres. C’est ce qui donna tant de crédit aux Pajots et aux Rouillés[61], qui en avoient la ferme, qu’on ne put jamais ôter, ni les faire guère augmenter, par cette raison si longtemps inconnue, et qui s’y enrichirent si énormément tous, aux dépens du public et du Roi même.
On ne sauroit comprendre la promptitude et la dextérité de cette exécution. Le Roi voyoit l’extrait de toutes les lettres où il y avoit des articles que les chefs de la poste, puis le ministre qui la gouvernoit, jugeoient devoir aller jusqu’à lui, et les lettres entières quand elles en valoient la peine par leur tissu, ou par la considération de ceux qui étoient en commerce. Par là les gens principaux de la poste, maîtres et commis, furent en état de supposer tout ce qu’il leur plut et à qui il leur plut; et comme peu de chose perdoit sans ressource, ils n’avoient pas besoin de forger ni de suivre une intrigue. Un mot de mépris sur le Roi ou sur le gouvernement, une raillerie, en un mot, un article de lettre spécieux et détaché, noyoit sans ressource, sans perquisition aucune, et ce moyen étoit continuellement entre leurs mains. Aussi à vrai et à faux est-il incroyable combien de gens de toutes les sortes en furent plus ou moins perdus. Le secret étoit impénétrable, et jamais rien ne coûta moins au Roi que de se taire profondément et de dissimuler de même.
Ce dernier talent, il le poussa souvent jusqu’à la fausseté, mais avec cela jamais de mensonge, et il se piquoit de tenir parole. Aussi ne la donnoit-il presque jamais. Pour le secret d’autrui, il le gardoit aussi religieusement que le sien. Il étoit même flatté de certaines confessions et de certaines confidences et même confiances; et il n’y avoit maîtresse, ministre ni favori qui pût y donner atteinte, quand le secret les auroit même regardés.
31 On a su, entre beaucoup d’autres, l’aventure fameuse d’une femme de nom, lequel a toujours été pleinement ignoré et jusqu’au soupçon même, qui séparée de lieu depuis un an d’avec son mari, se trouvant grosse et sur le point de le voir arriver de l’armée, à bout enfin de tous moyens, fit demander en grâce au Roi une audience secrète, dont qui que ce soit ne pût s’apercevoir, pour l’affaire du monde la plus importante. Elle l’obtint. Elle se confia au Roi dans cet extrême besoin, et lui dit que c’étoit comme au plus honnête homme de son royaume. Le Roi lui conseilla de profiter d’une si grande détresse pour vivre plus sagement à l’avenir, et lui promit de retenir sur-le-champ son mari sur la frontière, sous prétexte de son service, tant et si longtemps qu’il ne pût avoir aucun soupçon, et de ne le laisser revenir sous aucun prétexte. En effet, il en donna l’ordre le jour même à Louvois, et lui défendit non-seulement tout congé, mais de souffrir qu’il s’absentât un seul jour du poste qu’il lui assignoit pour y commander tout l’hiver. L’officier, qui étoit distingué, et qui n’avoit rien moins que souhaité, encore moins demandé, d’être employé l’hiver sur la frontière, et Louvois qui y avoit aussi peu pensé, furent également surpris et fâchés. Il n’en fallut pas moins obéir à la lettre et sans demander pourquoi, et le Roi n’en a fait l’histoire que bien des années après, et que lorsqu’il fut bien sûr que les gens que cela regardoit ne se pouvoient plus démêler, comme en effet ils n’ont jamais pu l’être, pas même du soupçon le plus vague ni le plus incertain.
Jamais personne ne donna de meilleure grâce et n’augmenta tant par là le prix de ses bienfaits. Jamais personne ne vendit mieux ses paroles, son souris même, jusqu’à ses regards. Il rendit tout précieux par le choix et la majesté, à quoi la rareté et la brèveté de ses paroles ajoutoit beaucoup. S’il les adressoit à quelqu’un, ou de question, ou de choses indifférentes, toute l’assistance le regardoit; c’étoit une distinction dont on s’entretenoit, et qui rendoit toujours une sorte de considération. Il en 32 étoit de même de toutes les attentions et les distinctions, et des préférences, qu’il donnoit dans leurs proportions. Jamais il ne lui échappa de dire rien de désobligeant à personne, et s’il avoit à reprendre, à réprimander ou à corriger, ce qui étoit fort rare, c’étoit toujours avec un air plus ou moins de bonté, presque jamais avec sécheresse, jamais avec colère, si on excepte l’unique aventure de Courtenvaux, qui a été racontée en son lieu[62], quoique il ne fût pas exempt de colère, quelquefois avec un air de sévérité.
Jamais homme si naturellement poli[63], ni d’une politesse si fort mesurée, si fort par degrés, ni qui distinguât mieux l’âge, le mérite, le rang, et dans ses réponses, quand elles passoient le je verrai, et dans ses manières. Ces étages divers se marquoient exactement dans sa manière de saluer et de recevoir les révérences, lorsqu’on partoit ou qu’on arrivoit. Il étoit admirable à recevoir différemment les saluts à la tête des lignes à l’armée ou aux revues. Mais surtout pour les femmes rien n’étoit pareil. Jamais il n’a passé devant la moindre coiffe sans soulever son chapeau, je dis aux femmes de chambre, et qu’il connoissoit pour telles, comme cela arrivoit souvent à Marly. Aux dames, il ôtoit son chapeau tout à fait, mais de plus ou moins loin; aux gens titrés, à demi, et le tenoit en l’air ou à son oreille quelques instants plus ou moins marqués. Aux seigneurs, mais qui l’étoient, il se contentoit de mettre la main au chapeau. Il l’ôtoit comme aux dames pour les princes du sang. S’il abordoit des dames, il ne se couvrait qu’après les avoir quittées. Tout cela n’étoit que dehors; car dans la maison il n’étoit 33 jamais couvert. Ses révérences, plus ou moins marquées, mais toujours légères, avoient une grâce et une majesté incomparables, jusqu’à sa manière de se soulever à demi à son souper pour chaque dame assise qui arrivoit, non pour aucune autre, ni pour les princes du sang; mais sur les fins cela le fatiguoit, quoique il ne l’ait jamais cessé, et les dames assises évitoient d’entrer à son souper quand il étoit commencé. C’étoit encore avec la même distinction qu’il recevoit le service de Monsieur, de M. le duc d’Orléans, des princes du sang; à ces derniers, il ne faisoit que marquer, à Monseigneur de même, et à Messeigneurs ses fils par familiarité; des grands officiers, avec un air de bonté et d’attention.
Si on lui faisoit attendre quelque chose à son habiller, c’étoit toujours avec patience. Exact aux heures qu’il donnoit pour toute sa journée; une précision nette et courte dans ses ordres. Si dans les vilains temps d’hiver qu’il ne pouvoit aller dehors, qu’il passât chez Mme de Maintenon un quart d’heure plus tôt qu’il n’en avoit donné l’ordre, ce qui ne lui arrivoit guères, et que le capitaine des gardes en quartier ne s’y trouvât pas, il ne manquoit point de lui dire après que c’étoit sa faute à lui d’avoir prévenu l’heure, non celle du capitaine des gardes de l’avoir manqué. Aussi, avec cette règle qui ne manquoit jamais, étoit-il servi avec la dernière exactitude, et elle étoit d’une commodité infinie pour les courtisans[64].
Il traitoit bien ses valets, surtout les intérieurs. C’étoit parmi eux qu’il se sentoit le plus à son aise, et qu’il se communiquoit le plus familièrement, surtout aux principaux. Leur amitié et leur aversion a souvent eu de grands effets. Ils étoient sans cesse à portée de rendre de bons et de mauvais offices; aussi faisoient-ils souvenir de ces puissants affranchis des empereurs romains, à qui le sénat et les grands de l’empire faisoient leur cour, et 34 ployoient sous eux avec bassesse. Ceux-ci, dans tout ce règne, ne furent ni moins comptés ni moins courtisés. Les ministres même les plus puissants les ménageoient ouvertement, et les princes du sang, jusqu’aux bâtards, sans parler de tout ce qui est inférieur, en usoient de même. Les charges des premiers gentilshommes de la chambre furent plus qu’obscurcies par les premiers valets de chambre, et les grandes charges ne se soutinrent que dans la mesure que les valets de leur dépendance ou les petits officiers très subalternes approchoient nécessairement plus ou moins du Roi. L’insolence aussi étoit grande dans la plupart d’eux, et telle qu’il falloit savoir l’éviter, ou la supporter avec patience.
Le Roi les soutenoit tous, et il racontoit quelquefois avec complaisance que, ayant dans sa jeunesse envoyé, pour je ne sais quoi, une lettre au duc de Montbazon[65], gouverneur de Paris, qui étoit en une de ses maisons de campagne près de cette ville, par un de ses valets de pied, il y arriva comme M. de Montbazon alloit se mettre à table, qu’il avoit forcé ce valet de pied de s’y mettre avec lui, et le conduisit, lorsqu’il le renvoya, jusque dans la cour, parce qu’il étoit venu de la part du Roi.
Il ne manquoit guères aussi de demander à ses gentilshommes ordinaires, quand ils revenoient de sa part de faire des compliments de conjouissance ou de condoléances aux gens titrés, hommes et femmes, mais à nuls autres, comment ils avoient été reçus, et il auroit trouvé bien mauvais qu’on ne les eût pas fait asseoir, et conduits fort loin, les hommes au carrosse.
Rien n’étoit pareil à lui aux revues, aux fêtes, et partout où un air de galanterie pouvoit avoir lieu par la présence des dames. On l’a déjà dit, il l’avoit puisée à la cour de la Reine sa mère, et chez la comtesse de Soissons; la compagnie de ses maîtresses l’y avoit accoutumé de plus en plus; mais toujours majestueuse, quoique quelquefois avec de la gaieté, et jamais devant le monde rien de 35 déplacé ni d’hasardé; mais jusqu’au moindre geste, son marcher, son port, toute sa contenance, tout mesuré, tout décent, noble, grand, majestueux, et toutefois très naturel, à quoi l’habitude et l’avantage incomparable et unique de toute sa figure donnoit une grande facilité. Aussi, dans les choses sérieuses, les audiences d’ambassadeurs, les cérémonies, jamais homme n’a tant imposé; et il falloit commencer par s’accoutumer à le voir, si en le haranguant on ne vouloit s’exposer à demeurer court. Ses réponses en ces occasions étoient toujours courtes, justes, pleines, et très rarement sans quelque chose d’obligeant, quelquefois même de flatteur, quand le discours le méritoit. Le respect aussi qu’apportoit sa présence, en quelque lieu qu’il fût, imposoit un silence, et jusqu’à une sorte de frayeur.
Il aimoit fort l’air et les exercices, tant qu’il en put faire. Il avoit excellé à la danse, au mail, à la paume. Il étoit encore admirable à cheval à son âge. Il aimoit à voir faire toutes ces choses avec grâce et adresse. S’en bien ou mal acquitter devant lui étoit mérite ou démérite. Il disoit que, de ces choses qui n’étoient point nécessaires, il ne s’en falloit pas mêler si on ne les faisoit pas bien. Il aimoit fort à tirer, et il n’y avoit point de si bon tireur que lui, ni avec tant de grâces. Il vouloit des chiennes couchantes excellentes; il en avoit toujours sept ou huit dans ses cabinets, et se plaisoit à leur donner lui-même à manger pour s’en faire connoître. Il aimoit fort aussi à courre le cerf, mais en calèche, depuis qu’il s’étoit cassé le bras en courant à Fontainebleau, aussitôt après la mort de la Reine. Il étoit seul dans une manière de soufflet[66], tiré par quatre petits chevaux, à cinq ou six relais, et il menoit lui-même à toute bride, avec une adresse et une justesse que n’avoient pas les meilleurs cochers, et toujours la même grâce à tout ce qu’il faisoit. Ses postillons étoient des enfants depuis neuf ou dix ans jusqu’à quinze, et il les dirigeoit.
Il aima en tout la splendeur, la magnificence, la 36 profusion. Ce goût il le tourna en maxime par politique, et l’inspira en tout à sa cour. C’étoit lui plaire que de s’y jeter en tables, en habits, en équipages, en bâtiments, en jeu. C’étoient des occasions pour qu’il parlât aux gens. Le fond étoit qu’il tendoit et parvint par là à épuiser tout le monde en mettant le luxe en honneur, et pour certaines parties en nécessité, et réduisit ainsi peu à peu tout le monde à dépendre entièrement de ses bienfaits pour subsister. Il y trouvoit encore la satisfaction de son orgueil par une cour superbe en tout, et par une plus grande confusion qui anéantissoit de plus en plus les distinctions naturelles.
C’est une plaie qui, une fois introduite, est devenue le cancer intérieur qui ronge tous les particuliers—parce que de la cour il s’est promptement communiqué à Paris et dans les provinces et les armées, où les gens en quelque place ne sont comptés qu’à proportion de leur table et de leur magnificence, depuis cette malheureuse introduction—qui ronge tous les particuliers, qui force ceux d’un état à pouvoir voler, à ne s’y pas épargner pour la plupart, dans la nécessité de soutenir leur dépense; et que la confusion des états, que l’orgueil, que jusqu’à la bienséance entretiennent, qui par la folie du gros va toujours en augmentant, dont les suites sont infinies, et ne vont à rien moins qu’à la ruine et au renversement général.
Rien jusqu’à lui n’a jamais approché du nombre et de la magnificence de ses équipages de chasses et de toutes ses autres sortes d’équipages. Ses bâtiments, qui les pourroit nombrer? En même temps, qui n’en déplorera pas l’orgueil, le caprice, le mauvais goût? Il abandonna Saint-Germain, et ne fit jamais à Paris ni ornement ni commodité, que le pont Royal, par pure nécessité, en quoi, avec son incomparable étendue, elle est si inférieure à tant de villes dans toutes les parties de l’Europe.
Lorsqu’on fit la place de Vendôme, elle étoit carrée. M. de Louvois en vit les quatre parements bâtis. Son dessein étoit d’y placer la Bibliothèque du Roi, les Médailles, le Balancier, toutes les académies, et le Grand Conseil, qui 37 tient ses séances encore dans une maison qu’il loue. Le premier soin du Roi, le jour de la mort de Louvois, fut d’arrêter ce travail, et de donner ses ordres pour faire couper à pans les angles de la place, en la diminuant d’autant, de n’y placer rien de ce qui y étoit destiné, et de n’y faire que des maisons, ainsi qu’on la voit.
Saint-Germain, lieu unique pour rassembler les merveilles de la vue, l’immense plein pied d’une forêt toute joignante, unique encore par la beauté de ses arbres, de son terrain, de sa situation, l’avantage et la facilité des eaux de source sur cette élévation, les agréments admirables des jardins, des hauteurs et des terrasses, qui les unes sur les autres se pouvoient si aisément conduire dans toute l’étendue qu’on auroit voulu, les charmes et les commodités de la Seine, enfin une ville toute faite, et que sa position entretenoit par elle-même, il l’abandonna pour Versailles[67], le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable mouvant ou marécage, sans air par conséquent, qui n’y peut être bon.
Il se plut à tyranniser la nature, à la dompter à force d’art et de trésors. Il y bâtit tout l’un après l’autre, sans dessein général; le beau et le vilain furent cousus ensemble, le vaste et l’étranglé. Son appartement et celui de la Reine y ont les dernières incommodités, avec les vues de cabinets et de tout ce qui est derrière les plus obscures, les plus enfermées, les plus puantes. Les jardins, dont la magnificence étonne, mais dont le plus léger usage rebute, sont d’aussi mauvais goût. On n’y est conduit dans la fraîcheur de l’ombre que par une vaste zone torride, au bout de laquelle il n’y a plus, où que ce soit, qu’à monter et à descendre; et avec la colline, qui est fort courte, se terminent les jardins. La recoupe y brûle les pieds; mais sans cette recoupe on y enfoncerait ici dans les sables, et là dans la plus noire fange. La violence qui y a été faite partout à la nature repousse et dégoûte malgré soi. L’abondance des eaux forcées et ramassées 38 de toutes parts les rend vertes, épaisses, bourbeuses; elles répandent une humidité malsaine et sensible, une odeur qui l’est encore plus. Leurs effets, qu’il faut pourtant beaucoup ménager, sont incomparables; mais de ce tout, il résulte qu’on admire et qu’on fuit. Du côté de la cour, l’étranglé suffoque, et ces vastes ailes s’enfuient sans tenir à rien. Du côté des jardins, on jouit de la beauté du tout ensemble; mais on croit voir un palais qui a été brûlé, où le dernier étage et les toits manquent encore. La chapelle qui l’écrase, parce que Mansart[68] vouloit engager le Roi à élever le tout d’un étage, a de partout la triste représentation d’un immense catafalque. La main-d’œuvre y est exquise en tous genres, l’ordonnance nulle; tout y a été fait pour la tribune, parce que le Roi n’alloit guères en bas, et celles des côtés sont inaccessibles, par l’unique défilé qui conduit à chacune. On ne finiroit point sur les défauts monstrueux d’un palais si immense et si immensément cher, avec ses accompagnements, qui le sont encore davantage: orangerie, potagers, chenils, grande et petite écuries pareilles, commun prodigieux; enfin une ville entière où il n’y avoit qu’un très misérable cabaret, un moulin à vent, et ce petit château de carte que Louis XIII y avoit fait pour n’y plus coucher sur la paille, qui n’étoit que la contenance étroite et basse autour de la cour de Marbre, qui en faisoit la cour, et dont le bâtiment du fond n’avoit que deux courtes et petites ailes. Mon père l’a vu, et y a couché maintes fois. Encore ce Versailles de Louis XIV, ce chef-d’œuvre si ruineux et de si mauvais goût, et où les changements entiers des bassins et de bosquets ont enterré tant d’or qui ne peut paroître, n’a-t-il pu être achevé.
Parmi tant de salons entassés l’un sur l’autre, il n’y a ni salle de comédie, ni salle à banquets, ni de bal; et devant et derrière il reste beaucoup à faire. Les parcs et les avenues, tous en plants, ne peuvent venir. En gibier, il faut y en jeter sans cesse; en rigoles de quatre et cinq lieues de cours, elles sont sans nombre; en murailles enfin, 39 qui par leur immense contour enferment comme une petite province du plus triste et du plus vilain pays du monde.
Trianon, dans ce même parc, et à la porte de Versailles, d’abord maison de porcelaine à aller faire des collations, agrandie après pour y pouvoir coucher, enfin palais de marbre, de jaspe et de porphyre, avec des jardins délicieux; la Ménagerie vis-à-vis, de l’autre côté de la croisée du canal de Versailles, toute de riens exquis, et garnie de toutes sortes d’espèces de bêtes à deux et à quatre pieds les plus rares; enfin Clagny[69], bâti pour Mme de Montespan en son propre, passé au duc du Maine, au bout de Versailles, château superbe avec ses eaux, ses jardins, son parc; des aqueducs dignes des Romains de tous les côtés; l’Asie ni l’antiquité n’offrent rien de si vaste, de si multiplié, de si travaillé, de si superbe, de si rempli de monuments les plus rares de tous les siècles, en marbres les plus exquis de toutes les sortes, en bronzes, en peintures, en sculptures, ni de si achevé des derniers.
Mais l’eau manquoit quoi qu’on pût faire, et ces merveilles de l’art en fontaines tarissoient, comme elles font encore à tous moments, malgré la prévoyance de ces mers de réservoirs qui avoient coûté tant de millions à établir et à conduire sur le sable mouvant et sur la fange. Qui l’auroit cru? ce défaut devint la ruine de l’infanterie. Mme de Maintenon régnoit; on parlera d’elle à son tour. M. de Louvois alors étoit bien avec elle; on jouissoit de la paix. Il imagina de détourner la rivière d’Eure entre Chartres et Maintenon, et de la faire venir toute entière à Versailles. Qui pourra dire l’or et les hommes que la tentative obstinée en coûta pendant plusieurs années, jusque-là qu’il fut défendu, sous les plus grandes peines, dans le camp qu’on y avoit établi, et qu’on y tint très longtemps, d’y parler des malades, surtout des morts, que le rude travail et plus encore l’exhalaison de tant de terres remuées tuoient[70]? Combien d’autres furent des années à se rétablir de cette contagion! combien n’en 40 ont pu reprendre leur santé pendant le reste de leur vie! Et toutefois, non-seulement les officiers particuliers, mais les colonels, les brigadiers, et ce qu’on y employa d’officiers généraux, n’avoient pas, quels qu’ils fussent, la liberté de s’en absenter un quart d’heure, ni de manquer eux-mêmes un quart d’heure de service sur les travaux. La guerre enfin les interrompit en 1688, sans qu’ils aient été repris depuis; il n’en est resté que d’informes monuments, qui éterniseront cette cruelle folie[71].
A la fin, le Roi, lassé du beau et de la foule, se persuada qu’il vouloit quelquefois du petit et de la solitude. Il chercha autour de Versailles de quoi satisfaire ce nouveau goût. Il visita plusieurs endroits; il parcourut les coteaux qui découvrent Saint-Germain et cette vaste plaine qui est au bas, où la Seine serpente et arrose tant de gros lieux et de richesses en quittant Paris. On le pressa de s’arrêter à Lucienne, où Cavoye eut depuis une maison dont la vue est enchantée; mais il répondit que cette heureuse situation le ruineroit, et que, comme il vouloit un rien, il vouloit aussi une situation qui ne lui permît pas de songer à y rien faire.
Il trouva derrière Lucienne un vallon étroit, profond, à bords escarpés, inaccessible par ses marécages, sans aucune vue, enfermé de collines de toutes parts, extrêmement à l’étroit, avec un méchant village sur le penchant d’une de ces collines qui s’appeloit Marly. Cette clôture sans vue, ni moyen d’en avoir, fit tout son mérite; l’étroit du vallon où on ne se pouvoit étendre y en ajouta beaucoup. Il crut choisir un ministre, un favori, un général d’armée. Ce fut un grand travail que dessécher ce cloaque de tous les environs que y jetoient toutes leurs voiries, et d’y rapporter des terres. L’ermitage fut fait. Ce n’étoit que pour y coucher trois nuits, du mercredi au samedi, deux ou trois fois l’année, avec une douzaine au plus de courtisans en charges les plus indispensables.
Peu à peu l’ermitage fut augmenté; d’accroissement en accroissement, les collines taillées pour faire place et y bâtir, et celle du bout largement emportée pour donner 41 au moins une échappée de vue fort imparfaite. Enfin, en bâtiments, en jardins, en eaux, en aqueducs, en ce qu’est si connu et si curieux sous le nom de machine de Marly[72], en parcs, en forêt ornée et renfermée, en statues, en meubles précieux, Marly est devenu ce qu’on le voit encore, tout dépouillé qu’il est depuis la mort du Roi: en forêts toutes venues et touffues qu’on y a apportées en grands arbres de Compiègne, et de bien plus loin sans cesse, dont plus des trois quarts mouroient, et qu’on remplaçoit aussitôt; en vastes espaces de bois épais et d’allées obscures, subitement changées en immenses pièces d’eau où on se promenoit en gondoles, puis remises en forêts à n’y pas voir le jour dès le moment qu’on les plantoit, je parle de ce que j’ai vu en six semaines; en bassins changés cent fois; en cascades de même à figures successives et toutes différentes; en séjours de carpes ornés de dorures et de peintures les plus exquises, à peine achevées, rechangées et rétablies autrement par les mêmes maîtres, et cela une infinité de fois; cette prodigieuse machine, dont on vient de parler, avec ses immenses aqueducs, ses conduites et ses réservoirs monstrueux uniquement consacrée à Marly sans plus porter d’eau à Versailles; c’est peu de dire que Versailles tel qu’on l’a vu n’a pas coûté Marly.
Que si on y ajoute les dépenses de ces continuels voyages, qui devinrent enfin au moins égaux aux séjours de Versailles, souvent presque aussi nombreux, et tout à la fin de la vie du Roi le séjour le plus ordinaire, on ne dira point trop sur Marly seul en comptant par milliards.
Telle fut la fortune d’un repaire de serpents et de charognes, de crapauds et de grenouilles, uniquement choisi pour n’y pouvoir dépenser. Tel fut le mauvais goût du Roi en toutes choses, et ce plaisir superbe de forcer la nature, que ni la guerre la plus pesante, ni la dévotion ne put émousser.
Saint-Simon’s account of Mme de Maintenon (XII. cc. vi-viii) is strongly coloured by prejudice, but this hardly at all affects that part of it which relates to her daily life and habits. To arrive at a fair estimate we should study her in her correspondence, of which there is an excellent selection by A. Geffroy, Mme de Maintenon d’après sa correspondance, 2 vols. 1887. See especially II. 43-52 for her entretien with Mme Glapion in 1705, in which she gives a detailed account of her daily round. Further light on her character may be obtained from the memoirs of Mme de Caylus, her niece à la mode de Bretagne (Souvenirs et correspondance, ed. E. Raunié, 1889), and of Mlle d’Aumale, a demoiselle of Saint-Cyr (D’Haussonville and Hanotaux, Souvenirs sur Mme de Maintenon, I. 1901).
Françoise d’Aubigné was born November 27, 1635, in the prison of Niort, where her father Constant d’Aubigné, the unworthy son of the stout Huguenot leader and distinguished writer Agrippa d’Aubigné, was incarcerated. She was baptised as a Catholic, but she was brought up in the Protestant faith by her aunt the Marquise de Villette, the favourite daughter of Agrippa d’Aubigné. In 1645, her father having been released on the death of Richelieu three years previously, she went with her parents to the Island of Martinique, and nearly died on the voyage. On her father’s death she returned to France with her mother (1647) and was again intrusted to the care of Mme de Villette. But by order of Anne of Austria she was handed over to her godmother, Mme de Neuillant, who tried in vain to convert her to Catholicism. She was then sent to an Ursuline Convent at Paris, where, harshness and persecution having failed, she finally yielded to gentler methods. She now rejoined her mother and shared her poverty till her death in 1650. In 1652 Mme de Neuillant arranged for her a marriage with the poet Scarron, who was forty-two and a helpless cripple. He died in 1660, leaving debts which more than swallowed up his small estate, and all that his widow had to live on was a pension of 2000 livres bestowed on her by the Queen-Mother. As Scarron’s wife she had played hostess to many people of wit and fashion, and with these she kept up her relations. Especially she frequented the salons of Mme d’Albret and Mme de Richelieu, 43 where she made friends with Mme de Montespan, a relative of Mme d’Albret. This led to her accepting the post of governess to the children whom that haughty favourite had borne to Louis XIV. In 1674, with her own savings and with 200,000 livres given her by the King for her services, she bought the estate of Maintenon, which was made a Marquisate in the following year. Her influence over Louis began in January, 1680, when she was appointed second Bedchamber-woman to the Dauphine. In 1683 the Queen Marie Thérèse died of a sudden illness, and in the following year—probably in January, but the exact date is not known—Mme de Maintenon was married in secret to Louis XIV.
Ce grand pas fait de l’expulsion sans retour de Mme de Montespan, Mme de Maintenon prit un nouvel éclat. Ayant manqué pour la seconde fois la déclaration de son mariage, elle comprit qu’il n’y avoit plus à y revenir, et eut assez de force sur elle-même pour couler doucement par-dessus, et ne se pas creuser une disgrâce pour n’avoir pas été déclarée reine. Le Roi, qui se sentit affranchi, lui sut un gré de cette conduite qui redoubla pour elle son affection, sa considération, sa confiance. Elle eût peut-être succombé sous le poids de l’éclat de ce qu’elle avoit voulu paroître, elle s’établit de plus en plus par la confirmation de sa transparente énigme.
Mais il ne faut pas s’imaginer que, pour en user et s’y soutenir, elle n’eût besoin d’aucune adresse. Son règne, au contraire, ne fut qu’un continuel manège, et celui du Roi une perpétuelle duperie. Elle ne voyoit personne chez elle en visite, et n’en rendoit jamais aucune. Cela n’avoit que fort peu d’exceptions. Elle alloit voir la reine d’Angleterre et la recevoit chez elle, quelquefois chez Mme de Montchevreuil[74], sa plus intime amie, qui alloit très ordinairement chez elle. Depuis sa mort elle alla voir quelquefois M. de Montchevreuil, mais rarement, 44 qui entroit chez elle toutes les fois qu’il vouloit, mais des instants. Le duc de Richelieu[75] eut toute sa vie le même privilège. Elle alloit quelquefois encore chez Mme de Caylus[76], sa bonne nièce, qui étoit souvent chez elle. Si, en deux ans une fois, elle alloit chez la duchesse du Lude[77], ou quelque femme aussi marquée, entre trois ou quatre au plus, c’étoit une distinction et une nouvelle, quoique il ne s’agît que d’une simple visite. Mme d’Heudicourt[78], son ancienne amie, alloit aussi chez elle à peu près quand elle vouloit, et sur les fins le maréchal de Villeroy[79], quelquefois Harcourt[80], jamais d’autres. On a vu, lors du brillant voyage de Mme des Ursins[81], qu’elle alloit aussi 45 très souvent chez elle en particulier à Marly; et Mme de Maintenon la fut voir une fois. Jamais elle n’alloit chez aucune princesse du sang, même chez Madame. Aucune d’elles aussi n’alloit chez elle, à moins que ce ne fût par audiences, ce qui étoit extrêmement rare et qui faisoit nouvelle. Mais si elle avoit à parler aux filles du Roi, ce qui n’arrivoit pas souvent, et presque jamais que pour leur laver la tête, elle les envoyoit chercher. Elles y arrivoient tremblantes, et en sortoient en pleurs. Pour le duc du Maine, les portes tombèrent toujours devant lui en quelque lieu qu’il fût; et depuis le mariage du duc de Noailles[82], il la voyoit aussi quand il vouloit, son père avec ménagement, sa mère fort à lèche-doigt[83]; le Roi et elle la craignoient et ne l’aimoient point.
Le cardinal de Noailles[84], jusqu’à l’affaire de la constitution, la voyoit réglément en particulier le jour qu’il avoit son audience du Roi, une fois la semaine; et après, le cardinal de Bissy[85] à peu près tant qu’il voulut, et le 46 cardinal de Rohan[86] avec mesure. Son frère[87], tant qu’il vécut, la désola. Il entroit chez elle à toute heure, lui tenoit des propos de l’autre monde, et lui faisoit souvent des sorties. De crédit avec elle, pas le moins du monde. Sa belle-sœur ne parut jamais à la cour ni dans le monde; Mme de Maintenon la traitoit bien par pitié, sans que cela allât au plus petit crédit; mais elle dînoit quelquefois avec elle, et ne la laissoit venir à Versailles que le moins qu’elle pouvoit, peut-être deux ou trois fois l’an au plus, et coucher une nuit. Godet[88], évêque de Chartres, et Aubigny[89], archevêque de Rouen, elle ne les voyoit qu’à Saint-Cyr.
Ses audiences étoient pour le moins aussi difficiles à obtenir que celles du Roi; et le peu qu’elle en accordoit, presque toutes à Saint-Cyr, où on alloit la trouver au jour et heure donnée. On l’attendoit à Versailles à sortir de chez elle ou à y rentrer, quand on avoit un mot à lui dire, gens de peu et même pauvres gens, et personnes considérables. On n’avoit là qu’un instant, et c’étoit à qui le saisiroit. Les maréchaux de Villeroy, Harcourt, souvent Tessé[90], quelquefois dans les derniers temps M. de 47 Vaudemont[91], lui ont parlé de la sorte, et si c’étoit en rentrant chez elle, ils ne la suivoient pas au delà de son antichambre, où elle coupoit très court et les laissoit. Bien d’autres lui ont parlé de la sorte. Moi jamais en pas un lieu, que ce que j’ai rapporté. Un très petit nombre de dames, à qui le Roi étoit accoutumé et qui étoient de ses particuliers, la voyoient quelquefois aux heures où le Roi n’étoit pas, et rarement quelques-unes dînoient avec elle.
Ses matinées, qu’elle commençoit de fort bonne heure, étoient remplies par des audiences obscures de charité ou de gouvernement spirituel; quelquefois par quelques ministres, très rarement par quelques généraux d’armée; encore ces derniers, quand ils avoient un rapport particulier à elle, comme les maréchaux de Villars, de Villeroy, d’Harcourt et quelquefois Tessé. Assez souvent, dès huit heures du matin et plus tôt, elle alloit chez quelque ministre. Rarement elle dînoit chez eux, avec leurs femmes et une compagnie fort trayée. C’étoient là les grandes faveurs, et une nouvelle, mais qui ne menoient à rien qu’à de l’envie et à quelque considération. M. de Beauvillier[92] fut des premiers et des plus longtemps favorisés de ces dîners[93], et fréquents, comme on l’a remarqué ailleurs, jusqu’à ce que Godet, évêque de Chartres, en renversa les escabelles, et arrêta tout court les progrès de Fénelon, qui s’étoit fait leur docteur. Les ministres chargés de la guerre, surtout des finances, furent toujours ceux à qui Mme de Maintenon avoit le plus affaire, et qu’elle cultiva. Rarement, et plus que rarement, alla-t-elle chez les autres, mais pour affaires, et souvent d’État, et dès le matin, sans jamais dîner chez ces derniers.
L’ordinaire, dès qu’elle étoit levée, c’étoit de s’en aller 48 à Saint-Cyr[94], et d’y dîner dans son appartement seule, ou avec quelque favorite de la maison, d’y donner des audiences le moins qu’elle pouvoit, d’y régenter au dedans, d’y gouverner l’Église au dehors, d’y lire et d’y répondre des lettres, d’y gouverner des monastères de Filles de toutes parts, d’y recevoir des avis et des lettres d’espionnages, et de revenir à peu près justement au temps que le Roi passoit chez elle. Devenue plus vieille et plus infirme, en arrivant entre sept et huit heures du matin à Saint-Cyr, elle s’y mettoit au lit pour se reposer, ou faire quelque remède.
A Fontainebleau, elle avoit une maison à la ville, où elle alloit souvent pour y faire les mêmes choses qu’à Saint-Cyr. A Marly, elle s’étoit fait accommoder un petit appartement qui avoit une fenêtre dans la chapelle. Elle en faisoit souvent le même usage que de Saint-Cyr; mais cela s’appeloit le Repos, et ce Repos étoit inaccessible, sans exception que de Mme la duchesse de Bourgogne.
A Marly, à Trianon, à Fontainebleau, le Roi alloit chez elle les matins des jours qu’il n’y avoit point de conseil, et qu’elle n’étoit pas à Saint-Cyr; à Fontainebleau, depuis sa messe jusqu’au dîner, quand le dîner n’étoit pas quelquefois au sortir de la messe pour aller courre le cerf; et il y étoit une heure et demie, et quelquefois davantage. A Trianon et à Marly, la visite duroit beaucoup moins, parce que, en sortant de chez elle, il s’alloit promener dans ses jardins. Ces visites étoient presque toujours tête à tête, sans préjudice de celles de toutes les après-dînées, qui étoient rarement tête à tête que fort peu de temps, parce que les ministres y venoient chacun à son tour travailler avec le Roi. Le vendredi, qu’il arrivoit souvent qu’il n’y en avoit point, c’étoient les dames familières avec qui il jouoit, ou une musique; ce qui se doubla et tripla de jours tout à la fin de sa vie.
Vers les neuf heures du soir, deux femmes de chambre 49 venoient déshabiller Mme de Maintenon. Aussitôt après, son maître d’hôtel et un valet de chambre apportoient son couvert, un potage et quelque chose de léger. Dès qu’elle avoit achevé de souper, ses femmes la mettoient dans son lit, et tout cela en présence du Roi et du ministre, qui n’en discontinuoit pas son travail, et qui n’en parloit pas plus bas, ou, s’il n’y en avoit point, des dames familières. Tout cela gagnoit dix heures, que le Roi alloit souper, et en même temps on tiroit les rideaux de Mme de Maintenon.
Dans les voyages, c’étoit la même chose. Elle partoit de bonne heure avec quelque favorite, comme Mme de Montchevreuil toujours tant qu’elle vécut, Mme d’Heudicourt, Mme de Dangeau[95], Mme de Caylus. Un carrosse du Roi la menoit, toujours affecté pour elle, même pour aller de Versailles, etc., à Saint-Cyr; et des Épinais, écuyer de la petite écurie, la mettoit dans le carrosse, et l’accompagnoit à cheval; c’étoit sa tâche de tous les jours. Dans les voyages, le carrosse de Mme de Maintenon menoit ses femmes de chambre, et suivoit celui du Roi où elle étoit. Elle s’arrangeoit de façon que le Roi, en arrivant, la trouvoit toute établie lorsqu’il passoit chez elle. Partie autorité, partie invention de seconde dame d’atour de la Dauphine de Bavière[96], son carrosse et sa chaise, avec ses porteurs ayant sa livrée, entroient partout comme ceux des gens titrés.
Reine en particulier à l’extérieur pour le ton, le siège, et la place en présence du Roi, de Monseigneur, de Monsieur, de la cour d’Angleterre et de qui que ce fût, elle étoit très simple particulière au dehors, et toujours aux dernières places. J’en ai vu les fins aux dîners du Roi à 50 Marly, mangeant avec lui et les dames, et à Fontainebleau en grand habit chez la reine d’Angleterre, comme je l’ai remarqué ailleurs, cédant absolument sa place, et se reculant partout pour les femmes titrées, même pour des femmes de qualité distinguée, ne se laissant jamais forcer par les titrées, mais par celles de qualité ordinaire avec un air de peine et de civilité, et par tous ces endroits polie, affable, parlante, comme une personne qui ne prétend rien et qui ne montre rien, mais qui imposoit fort, à ne considérer que ce qui étoit autour d’elle.
Toujours très bien mise, noblement, proprement, de bon goût, mais très modestement et plus vieillement alors que son âge. Depuis qu’elle ne parut plus en public, on ne voyoit que coiffes et écharpe noire quand par hasard on l’apercevoit.
Elle n’alloit jamais chez le Roi qu’il ne fût malade, ou que les matins des jours qu’il avoit pris médecine, et à peu près de même chez Mme la duchesse de Bourgogne, jamais ailleurs pour aucun devoir.
Chez elle, avec le Roi, ils étoient chacun dans leur fauteuil, une table devant chacun d’eux, aux deux coins de la cheminée, elle du côté du lit, le Roi le dos à la muraille du côté de la porte de l’antichambre, et deux tabourets devant sa table, un pour le ministre qui venoit travailler, l’autre pour son sac. Les jours de travail, ils n’étoient seuls ensemble que fort peu de temps avant que le ministre entrât, et moins encore fort souvent après qu’il étoit sorti. Le Roi venoit au lit de Mme de Maintenon, où il se tenoit debout fort peu, lui donnoit le bonsoir, et s’en alloit se mettre à table. Telle étoit la mécanique de chez Mme de Maintenon[97]. On a vu sur Mme la duchesse de Bourgogne ce qui l’y regardoit, tant qu’elle a vécu.
Pendant le travail, Mme de Maintenon lisoit ou travailloit en tapisserie. Elle entendoit tout ce qui se passoit entre le Roi et le ministre, qui parloient tout haut. Rarement elle y mêloit son mot, plus rarement ce mot étoit de 51 quelque conséquence. Souvent le Roi lui demandoit son avis; alors elle répondoit avec de grandes mesures[98]. Jamais, ou comme jamais, elle ne paroissoit affectionner rien, et moins encore s’intéresser pour personne; mais elle étoit d’accord avec le ministre, qui n’osoit en particulier ne pas convenir de ce qu’elle vouloit, ni encore moins broncher en sa présence. Dès qu’il s’agissoit donc de quelque grâce ou de quelque emploi, la chose étoit arrêtée entre eux avant le travail où la décision s’en devoit faire, et c’est ce qui la retardoit quelquefois, sans que le Roi ni personne en sût la cause.
Elle mandoit au ministre qu’elle vouloit lui parler auparavant. Il n’osoit mettre la chose sur le tapis qu’il n’eût reçu ses ordres, et que la mécanique roulante des jours et des temps leur eût donné le loisir de s’entendre. Cela fait, le ministre proposoit et montroit une liste. Si de hasard le Roi s’arrêtoit à celui que Mme de Maintenon vouloit, le ministre s’en tenoit là, et faisoit en sorte de n’aller pas plus loin. Si le Roi s’arrêtoit à quelque autre, le ministre proposoit de voir ceux qui étoient aussi à portée, laissoit après dire le Roi, et en profitoit pour exclure. Rarement proposoit-il expressément celui à qui il en vouloit venir, mais toujours plusieurs, qu’il tâchoit de balancer également pour embarrasser le Roi sur le choix. Alors le Roi lui demandoit son avis, il parcourait encore les raisons de quelques-uns, et appuyoit enfin sur celui qu’il vouloit. Le Roi presque toujours balançoit, et demandoit à Mme de Maintenon ce qu’il lui en sembloit. Elle sourioit, faisoit l’incapable, disoit quelquefois un mot de quelque autre, puis revenoit, si elle ne s’y étoit pas tenue d’abord, sur celui que le ministre avoit appuyé, et déterminoit; tellement que les trois quarts des grâces et 52 des choix, et les trois quarts encore du quatrième quart de ce qui passoit par le travail des ministres chez elle, c’étoit elle qui en disposoit. Quelquefois aussi, quand elle n’affectionnoit personne, c’étoit le ministre même, avec son agrément et son concours, sans que le Roi en eût aucun soupçon. Il croyoit disposer de tout et seul, tandis qu’il ne disposoit, en effet, que de la plus petite partie, et toujours encore par quelque hasard, excepté des occasions rares de quelqu’un qu’il s’étoit mis dans la fantaisie, ou si quelqu’un qu’il vouloit favoriser lui avoit parlé pour quelqu’un.
En affaires, si Mme de Maintenon les vouloit faire réussir, manquer, ou tourner d’une autre façon, ce qui étoit beaucoup moins ordinaire que ce qui regardoit les emplois et les grâces, c’étoit la même intelligence entre elle et le ministre, et le même manège à peu près. Par ce détail, on voit que cette femme habile faisoit presque tout ce qu’elle vouloit, mais non pas tout, ni quand et comme elle vouloit.
Il y avoit une autre ruse si le Roi s’opiniâtroit: c’étoit alors d’éviter la décision en brouillant et allongeant la matière, en en substituant une autre comme venant à propos de celle-là, et qui la détournât, ou en proposant quelque éclaircissement à prendre. On laissoit ainsi émousser les premières idées, et on revenoit une autre fois à la charge avec la même adresse, qui très souvent réussissoit. C’étoit encore presque la même chose pour charger ou diminuer les fautes, faire valoir les lettres et les services, ou y glisser légèrement, et préparer ainsi la perte ou la fortune.
C’est là ce qui rendoit ce travail chez Mme de Maintenon si important pour les particuliers, et c’est ce qui rendoit les ministres si nécessaires à Mme de Maintenon à avoir dans sa dépendance. C’est aussi ce qui les aida puissamment à s’élever à tout, et à augmenter sans cesse leur crédit et leur pouvoir, et pour eux et pour les leurs, parce que Mme de Maintenon leur faisoit litière de toutes ces choses pour se les attacher entièrement.
53 Quand ils étoient près de venir travailler, ou qu’ils sortoient de chez elle, elle prenoit son temps de sonder le Roi sur eux, de les excuser ou de les vanter, de les plaindre de leur grand travail, d’en exalter le mérite, et s’il s’agissoit de quelque chose pour eux, d’en préparer les voies, quelquefois d’en rompre la glace, sous prétexte de leur modestie et du service du Roi, qui demandoit qu’ils fussent excités à le soulager et à faire de bien en mieux. Ainsi c’étoit entre eux un cercle de besoins et de services réciproques, dont le Roi ne se doutoit pas le moins du monde. Aussi les ménagements entre eux étoient-ils infinis et continuels.
Mais, si Mme de Maintenon ne pouvoit rien, ou presque rien, sans eux, de ce qui passoit par eux, eux aussi ne pouvoient se maintenir sans elle, beaucoup moins malgré elle. Dès qu’elle se voyoit à bout de les pouvoir ramener à son point quand ils s’en étoient écartés, ou qu’ils étoient tombés en disgrâce auprès d’elle, leur perte étoit jurée; elle ne les manquoit pas. Il lui falloit du temps, des couleurs, des souplesses, quelquefois beaucoup, comme lorsqu’elle perdit Chamillart[99]. Louvois y avoit succombé avant lui. Pontchartrain[100] ne s’en sauva qu’à l’aide de son esprit, qui plaisoit au Roi, et des épines des finances pendant la guerre, et du sens et de l’adresse de sa femme demeurée longtemps bien avec Mme de Maintenon, depuis même qu’il y fut mal, enfin par la porte dorée de la chancellerie, qui s’ouvrit bien à propos pour lui. Le duc de Beauvillier y pensa faire naufrage par deux fois à longue distance l’une de l’autre, et n’en auroit pas échappé sans deux espèces de miracles, comme on l’a vu ici en son temps.
54 Si les ministres, et les plus accrédités, en étoient là avec Mme de Maintenon, on peut juger de ce qu’elle pouvoit à l’égard de toutes les autres sortes de personnes bien moins à portée de se défendre, et même de s’apercevoir. Bien des gens eurent donc le cou rompu sans en avoir pu imaginer la cause, et se donnèrent bien des sortes de mouvements pour la découvrir, et pour y remédier, et très inutilement.
Le court et rare travail des généraux d’armée se passoit ordinairement les soirs en sa présence et du secrétaire d’État de la guerre. Par celui de Pontchartrain, rempli du rapport des espionnages et des histoires de toute espèce de Paris et de la cour, elle étoit à portée de faire beaucoup de bien et de mal. Torcy[101] ne travailloit point chez elle, et ne la voyoit comme jamais. Aussi ne l’aimoit-elle point, et moins encore sa femme, dont le nom d’Arnauld gâtoit tout leur mérite. Torcy avoit les postes; c’étoit par lui que le secret en passoit au Roi tête à tête, et le Roi souvent en portoit des morceaux à lire à Mme de Maintenon; mais cela n’avoit point de suite; elle n’en savoit que par lambeaux, selon ce que le Roi s’avisoit de lui en dire ou de lui en porter.
Toutes les affaires étrangères passoient au conseil d’État, ou si c’étoit quelque chose de pressé, Torcy le portoit sur-le-champ au Roi, ainsi à des heures rompues, et point de travail réglé et particulier avec lui. Mme de Maintenon eût fort desiré ce genre de travail réglé chez elle, pour avoir la même influence sur les affaires d’État, et sur ceux qui s’en mêloient, comme elle l’avoit sur les autres parties. Mais Torcy sut bien sagement se préserver de ce dangereux piége. Il s’en défendit toujours, en disant modestement qu’il n’avoit point d’affaires pour entretenir ce travail. Ce n’étoit pas que le Roi ne lui dît tout 55 là-dessus; mais elle sentoit toute la différence d’assister à un travail réglé où elle agissoit avec loisir, adresse et mesures prises, ou d’être obligée de prendre son parti entre le Roi et elle sur ce qu’il lui apprenoit de cette matière, et de n’avoir d’autre ressource qu’en elle-même, et d’aller de front avec lui, si elle vouloit une chose plutôt qu’une autre, nuire aux gens à découvert, ou les servir de même.
Le Roi y étoit même fort en garde. Il lui est arrivé plusieurs fois que, lorsqu’on ne s’y prenoit pas avec assez de tour et de délicatesse, et qu’il apercevoit que le ministre ou le général d’armée favorisoit un parent ou un protégé de Mme de Maintenon, il tenoit ferme contre, pour cela même; puis disoit, partie fâché, partie se moquant d’eux: “Un tel a bien fait sa cour; car il n’a pas tenu à lui de bien servir un tel, parce qu’il est parent ou protégé de Mme de Maintenon.” Et ces coups de caveçon la rendoient très timide et très mesurée, quand il étoit question de se montrer au Roi à découvert sur quelque chose ou sur quelqu’un. Aussi répondoit-elle toujours à quiconque s’adressoit à elle, même pour les moindres choses, qu’elle ne se mêloit de rien; et si bien rarement elle s’ouvroit davantage et que la chose regardât le département d’un ministre sur lequel elle comptât, elle renvoyoit à lui et promettoit de lui en parler; mais encore une fois, rien n’étoit plus rare. On ne laissoit pas cependant d’aller à elle, pour, par ce devoir, ne l’avoir pas contraire, et par l’espérance aussi que, nonobstant cette réponse banale, elle feroit peut-être ce qu’on desiroit, comme cela arrivoit quelquefois.
Il y avoit peut-être cinq ou six personnes au plus de tous états, desquels la plupart étoient de ces amis de son ancien temps, à qui elle répondoit plus franchement, quoique toujours foiblement et mesurément, et pour qui en effet elle agissoit au mieux qu’il lui étoit possible; ce néanmoins réussissant très ordinairement pour eux, elle n’y réussissoit pas toujours.
Ce fut par le desir extrême de se mêler des affaires étrangères, comme elle se mêloit de toutes les autres, et l’impossibilité d’en attirer le travail chez elle, qu’elle prit 56 le parti, qu’on a détaillé en son temps, de tous les manèges par lesquels elle rendit la princesse des Ursins maîtresse de tout en Espagne, et l’y maintint jusqu’à la paix d’Utrecht, aux dépens de Torcy et des ambassadeurs de France en Espagne, c’est-à-dire, comme on l’a vu, aux dépens de l’Espagne et de la France, parce que Mme des Ursins eut l’adresse de lui faire tout passer par les mains, et de lui persuader qu’elle ne gouvernoit la cour et l’État en Espagne que sous ses ordres et par ses volontés. Revenons un moment à ces coups de caveçon du Roi dont on vient de parler.
Le Tellier, dans des temps bien antérieurs, et longtemps avant d’être chancelier de France, connoissoit bien le Roi là-dessus. Un de ses meilleurs amis, car il en avoit parce qu’il savoit en avoir, l’avoit prié de quelque chose qu’il desiroit fort et qui devoit être proposé dans le travail particulier de ce ministre avec le Roi. Le Tellier l’assura qu’il y feroit tout son possible. Son ami ne goûta point sa réponse, et lui dit franchement que dans la place et le crédit où il étoit, ce n’étoit pas de celles-là qu’il lui falloit donner. "Vous ne connoissez pas le terrain, lui répliqua le Tellier. De vingt affaires que nous portons ainsi au Roi, nous sommes sûrs qu’il en passera dix-neuf à notre gré; nous le sommes également que la vingtième sera décidée au contraire. Laquelle des vingt sera décidée contre notre avis et notre desir, c’est ce que nous ignorons toujours, et très souvent c’est celle où nous nous intéressons le plus. Le Roi se réserve cette bisque[102] pour nous faire sentir qu’il est le maître et qu’il gouverne; et si par hasard il se présente quelque chose sur quoi il s’opiniâtre, et qui soit assez importante pour que nous nous opiniâtrions aussi, ou pour la chose même, ou pour l’envie que nous avons qu’elle réussisse comme nous le desirons, c’est très souvent alors, dans le rare que cela arrive, une sortie sûre; mais, à la vérité, la sortie essuyée et l’affaire manquée, le Roi, content d’avoir montré que nous ne pouvons rien et peiné de nous avoir fâchés, devient après souple et 57 flexible, en sorte que c’est alors le temps où nous faisons tout ce que nous voulons."
C’est, en effet, comme le Roi se conduisit avec ses ministres toute sa vie, toujours parfaitement gouverné par eux, même par les plus jeunes et les plus médiocres, même par les moins accrédités et considérés et toujours en garde pour ne l’être point, et toujours persuadé qu’il réussissoit pleinement à ne le point être.
Il avoit la même conduite avec Mme de Maintenon, à qui de fois à autre il faisoit des sorties terribles, et dont il s’applaudissoit. Quelquefois elle se mettoit à pleurer devant lui, et elle étoit plusieurs jours sur de véritables épines. Quand elle eut mis Fagon[103] auprès du Roi, au lieu de d’Aquin, qu’elle fit chasser, parce qu’il étoit de la main de Mme de Montespan, et pour avoir un homme tout à elle et de beaucoup d’esprit, qu’elle s’étoit attaché dans les voyages aux eaux où il avoit suivi le duc du Maine, et un homme dont elle pût tirer un continuel parti dans cette place intime de premier médecin, qu’elle voyoit tous les matins, elle faisoit la malade quand il lui arrivoit de ces scènes, et c’étoit d’ordinaire par où elle les faisoit finir avec le plus d’avantage.
Ce n’est pas que cet artifice, ni même la réalité la plus effective, eût aucun pouvoir d’ailleurs de contraindre le Roi en quoi que ce pût être. C’étoit un homme uniquement personnel, et qui ne comptoit tous les autres, quels qu’ils fussent, que par rapport à soi. Sa dureté là-dessus étoit extrême. Dans les temps les plus vifs de sa vie pour ses maîtresses, leurs incommodités les plus opposées aux voyages et au grand habit de cour, car les dames les plus privilégiées ne paroissoient jamais autrement dans les carrosses ni en aucun lieu de cour, avant que Marly eût adouci cette étiquette, rien, dis-je, ne les en pouvoit 58 dispenser. Grosses, malades, moins de six semaines après leurs couches, dans d’autres temps fâcheux, il falloit être en grand habit, parées et serrées dans leurs corps, aller en Flandres, et plus loin encore, danser, veiller, être des fêtes, manger, être gaies et de bonne compagnie, changer de lieu, ne paroître craindre, ni être incommodées du chaud, du froid, de l’air, de la poussière, et tout cela précisément aux jours et aux heures marquées, sans déranger rien d’une minute.
Ses filles, il les a traitées toutes pareillement. On a vu en son temps qu’il n’eut pas plus de ménagement pour Mme la duchesse de Berry, ni même pour Mme la duchesse de Bourgogne, quoi que Fagon, Mme de Maintenon, etc., pussent dire et faire, quoique il aimât Mme la duchesse de Bourgogne aussi tendrement qu’il en étoit capable, qui toutes les deux s’en blessèrent, et ce qu’il en dit avec soulagement, quoique il n’y eût point encore d’enfants.
Il voyageoit toujours son carrosse plein de femmes: ses maîtresses, après ses bâtardes, ses belles-filles, quelquefois Madame, et des dames quand il y avoit place. Ce n’étoit que pour les rendez-vous de chasse, les voyages de Fontainebleau, de Chantilly, de Compiègne, et les vrais voyages, que cela étoit ainsi. Pour aller tirer, se promener, ou pour aller coucher à Marly ou à Meudon, il alloit seul dans une calèche. Il se défioit des conversations que ses grands officiers auroient pu tenir devant lui dans son carrosse; et on prétendoit que le vieux Charost, qui prenoit volontiers ces temps-là pour dire bien des choses, lui avoit fait prendre ce parti, il y avoit plus de quarante ans. Il convenoit aussi aux ministres, qui sans cela auroient eu de quoi être inquiets tous les jours, et à la clôture exacte qu’en leur faveur lui-même s’étoit prescrite, et à laquelle il fut si exactement fidèle. Pour les femmes, ou maîtresses d’abord, ou filles ensuite, et le peu de dames qui pouvoient y trouver place, outre que cela ne se pouvoit empêcher, les occasions en étoient restreintes à une grande rareté, et le babil fort peu à craindre.
59 Dans ce carrosse, lors des voyages, il y avoit toujours beaucoup de toutes sortes de choses à manger: viandes, pâtisseries, fruits. On n’avoit pas sitôt fait un quart de lieue que le Roi demandoit si on ne vouloit pas manger. Lui jamais ne goûtoit à rien entre ses repas, non pas même à aucun fruit, mais il s’amusoit à voir manger, et manger à crever. Il falloit avoir faim, être gaies, et manger avec appétit et de bonne grâce, autrement il ne le trouvoit pas bon, et le montroit même aigrement: on faisoit la mignonne, on vouloit faire la délicate, être du bel air; et cela n’empêchoit pas que les mêmes dames ou princesses qui soupoient avec d’autres à sa table le même jour, ne fussent obligées, sous les mêmes peines, d’y faire aussi bonne contenance que si elles n’avoient mangé de la journée. Avec cela, d’aucuns besoins il n’en falloit point parler, outre que pour des femmes ils auraient été très embarrassants avec les détachements de la maison du Roi, et les gardes du corps devant et derrière le carrosse, et les officiers et les écuyers aux portières, qui faisoient une poussière qui dévorait tout ce qui étoit dans le carrosse. Le Roi, qui aimoit l’air, en vouloit toutes les glaces baissées, et auroit trouvé fort mauvais que quelque dame eût tiré le rideau contre le soleil, le vent ou le froid. Il ne falloit seulement pas s’en apercevoir, ni d’aucune autre sorte d’incommodité, et alloit toujours extrêmement vite, avec des relais le plus ordinairement. Se trouver mal étoit un démérite à n’y plus revenir.
Mme de Maintenon, qui craignoit fort l’air et bien d’autres incommodités, ne put gagner là-dessus aucun privilège. Tout ce qu’elle obtint, sous prétexte de modestie et d’autres raisons, fut de voyager à part, de la manière que je l’ai rapporté; mais en quelque état qu’elle fût, il falloit marcher, et suivre à point nommé, et se trouver arrivée et rangée avant que le Roi entrât chez elle. Elle fit bien des voyages à Marly, dans un état à ne pas faire marcher une servante; elle en fit un à Fontainebleau qu’on ne savoit pas véritablement si elle ne mourrait pas en chemin. En quelque état qu’elle fût, le Roi alloit chez 60 elle à son heure ordinaire, et y faisoit ce qu’il avoit projeté; tout au plus elle étoit dans son lit. Plusieurs fois, y suant la fièvre à grosses gouttes, le Roi, qui, comme on l’a dit, aimoit l’air, et qui craignoit le chaud dans les chambres, s’étonnoit en arrivant de trouver tout fermé, et faisoit ouvrir les fenêtres, et n’en rabattoit rien, quoique il la vît dans cet état, et jusqu’à dix heures qu’il s’en alloit souper, et sans considération pour la fraîcheur de la nuit. S’il devoit y avoir musique, la fièvre, le mal de tête n’empêchoit rien, et cent bougies dans les yeux. Ainsi le Roi alloit toujours son train, sans lui demander jamais si elle n’en étoit point incommodée.
Les gens de Mme de Maintenon, car tout en est curieux, étoient en très petit nombre, peu répandus, modestes, respectueux, humbles, silencieux, et ne s’en firent jamais accroire. C’étoit l’air de la maison, et ils n’y seroient pas demeurés sans cela. Ils y faisoient avec le temps une fortune modérée, suivant leur état, et qui ne pouvoit donner d’envie ni occasion de parler; tous demeuroient dans une obscurité plus ou moins aisée. Ses femmes passoient leur vie enfermées chez elle. Non-seulement elle ne vouloit point qu’elles sortissent, mais elle les empêchoit de recevoir personne, et la fortune qu’elle leur faisoit étoit courte et rare. Le Roi les connoissoit toutes et tous; il étoit familier avec eux, et y causoit souvent, lorsqu’il passoit quelquefois chez elle avant qu’elle y fût rentrée.
Il n’y avoit d’un peu distingué que cette ancienne servante du temps qu’après la mort de Scarron elle étoit à la charité de Saint-Eustache, logée dans cette montée où cette servante faisoit sa chambre et son petit pot-au-feu dans la même chambre. Nanon de ce temps-là, et que Mme de Maintenon a toujours appelée ainsi, qui d’abord avoit été son unique domestique, et qui l’avoit constamment suivie et servie dans tous ses divers états, étoit devenue Mlle Balbien, dévote comme elle, et vieille. Elle étoit d’autant plus importante qu’elle avoit toute la confiance domestique de Mme de Maintenon, et l’œil sur ces demoiselles qu’on a vu ailleurs qui se succédoient de 61 Saint-Cyr auprès d’elle, sur ses nièces, et sur Mme la duchesse de Bourgogne même, qui ne l’ignoroit pas, et qui habilement, sans la gâter, en avoit fait sa bonne amie. Elle se coiffoit et s’habilloit comme sa maîtresse; elle affectoit d’en tout imiter. A commencer par les enfants légitimes et les bâtards, à continuer par les princes du sang et par les ministres, il n’y avoit celui ni celle qui ne la ménageât, et qui ne fût en contrainte, et, le dirai-je, en respect devant elle. S’en servoit qui pouvoit pour de l’argent, quoique au fond elle se mêlât de fort peu de chose. Elle étoit très raisonnablement sotte; et n’étoit méchante que rarement, et encore par bêtise, quoique ce fût une personne toute composée, toute sur le merveilleux, et qui ne se montroit presque jamais. On en a pourtant vu un échantillon à propos de la place qu’eut la duchesse du Lude, que, quatre heures devant, le Roi avoit paru si éloigné de lui donner. Sa protection pour aller à Marly ne lui fut pas infructueuse. Elle avoit l’air doux, humble, empesé, important, et toutefois respectueux.
On l’a dit, Mme de Maintenon étoit particulière en public; hors de ses yeux, reine, quelquefois même sous ses yeux, comme à l’attaque de Compiègne dont il [a] été parlé ici en son temps, et aux promenades de Marly, quand par complaisance elle en faisoit quelqu’une où le Roi vouloit lui montrer quelque chose de nouvellement achevé. Je me trouve, je l’avoue, entre la crainte de quelques redites et celle de ne pas expliquer assez en détail des curiosités que nous regrettons dans toutes les Histoires, et dans presque tous les Mémoires des divers temps. On voudroit y voir les princes, avec leurs maîtresses et leurs ministres, dans leur vie journalière. Outre une curiosité si raisonnable, on en connoîtroit bien mieux les mœurs du temps et le génie des monarques, celui de leurs maîtresses et de leurs ministres, de leurs favoris, de ceux qui les ont le plus approchés, et les adresses qui ont été employées pour les gouverner ou pour arriver aux divers buts qu’on s’est proposés. Si ces choses doivent passer pour curieuses, et même pour instructives dans tous 62 les règnes, à plus forte raison d’un règne aussi long et aussi rempli que l’a été celui de Louis XIV, et d’un personnage unique dans la monarchie depuis qu’elle est connue, qui a, trente-deux ans durant, revêtu ceux de confidente, de maîtresse, d’épouse, de ministre, et de toute-puissante, après avoir été si longuement néant, et comme on dit, avoir si longtemps et si publiquement rôti le balai. C’est ce qui m’enhardit sur l’inconvénient des redites. Tout bien considéré, j’estime qu’il vaut mieux hasarder qu’il m’en échappe quelqu’une que ne pas mettre sous les yeux un tout ensemble si intéressant. Revenons donc un moment sur nos pas.
Reine dans le particulier, Mme de Maintenon n’étoit jamais que dans un fauteuil, et dans le lieu le plus commode de sa chambre, devant le Roi, devant toute la famille royale, même devant la reine d’Angleterre. Elle se levoit tout au plus pour Monseigneur et pour Monsieur, parce qu’ils alloient rarement chez elle; M. le duc d’Orléans, ni aucun prince du sang, jamais que par audiences, et comme jamais; mais Monseigneur, Messeigneurs ses fils, Monsieur et M. le duc de Chartres[104], toujours en partant pour l’armée, et le soir même qu’ils en arrivoient, ou, s’il étoit trop tard, de bonne heure le lendemain. Pour aucun autre fils de France, leurs épouses, ou les bâtardes du Roi, elle ne se levoit point, ni pour personne, sinon un peu pour les personnes ordinaires avec qui elle n’avoit point de familiarité, et qui en obtenoient des audiences; car modeste et polie, elle l’a toujours affecté à ces égards-là.
Presque jamais elle n’appeloit Madame la Dauphine que “mignonne,” même en présence du Roi et des dames familières et des dames du palais, et cela jusqu’à sa mort, et quand elle parloit d’elle ou de Mme la duchesse de Berry, et devant les mêmes, jamais elle ne disoit que “la duchesse de Bourgogne” et “la duchesse de Berry,” ou “la Dauphine,” très rarement “Madame la Dauphine,” et de même "le duc 63 de Bourgogne," “le duc de Berry,” "le Dauphin," presque jamais “Monsieur le Dauphin”: on peut juger des autres.
On a vu comment elle mandoit les princesses, légitimes et bâtardes, comme elle leur lavoit la tête, les transes avec quoi elles venoient à ses ordres, les pleurs avec lesquels elles s’en retournoient, et leurs inquiétudes tant que la disgrâce durait, et qu’il n’y avoit que Mme la duchesse de Bourgogne qui eût pris le dessus avec les grâces nonpareilles et ce soin attentif qu’on en a vu en parlant d’elle. Elle ne l’appeloit jamais que “ma tante.”
Ce qui étonnoit toujours, c’étoient les promenades qu’on vient de dire qu’elle faisoit avec le Roi par excès de complaisance dans les jardins de Marly. Il auroit été cent fois plus librement avec la Reine, et avec moins de galanterie. C’étoit un respect le plus marqué, quoique au milieu de la cour et en présence de tout ce qui s’y vouloit trouver des habitants de Marly. Le Roi s’y croyoit en particulier, parce qu’il étoit à Marly. Leurs voitures alloient joignant à côté l’une de l’autre, car presque jamais elle ne montoit en chariot: le Roi seul dans le sien, elle dans une chaise à porteurs. S’il y avoit à leur suite Madame la Dauphine ou Mme la duchesse de Berry, ou des filles du Roi, elles suivoient ou environnoient à pied, ou si elles montoient en chariot avec des dames, c’étoit pour suivre, et à distance, sans jamais doubler. Souvent le Roi marchoit à pied à côté de la chaise. A tous moments il ôtoit son chapeau et se baissoit pour parler à Mme de Maintenon, ou pour lui répondre si elle lui parloit, ce qu’elle faisoit bien moins souvent que lui, qui avoit toujours quelque chose à lui dire ou à lui faire remarquer. Comme elle craignoit l’air dans les temps même les plus beaux et les plus calmes, elle poussoit à chaque fois la glace de côté de trois doigts, et la refermoit incontinent. Posée à terre à considérer la fontaine nouvelle, c’étoit le même manège. Souvent alors la Dauphine se venoit percher sur un des bâtons de devant, et se mettoit de la conversation, mais la glace de devant demeurait toujours fermée. A la fin de la promenade, le Roi conduisoit Mme 64 de Maintenon jusqu’auprès du château, prenoit congé d’elle, et continuoit sa promenade. C’étoit un spectacle auquel on ne pouvoit s’accoutumer. Ces bagatelles échappent presque toujours aux Mémoires; elles donnent cependant plus que tout l’idée juste de ce que l’on y recherche, qui est le caractère de ce qui a été, qui se présente ainsi naturellement par les faits.
La conduite des belles-petites-filles du Roi et de ses bâtardes, les ordres à y mettre et à y donner, les galanteries et la dévotion, ou la régularité des dames de la cour, les aventures diverses, le maintien des femmes des ministres, et celui des ministres mêmes, les espionnages de toutes les sortes dont la cour étoit pleine, les parties qui se faisoient de ces princesses avec les jeunes dames, ou celles de leur âge, et tout ce qui s’y passoit, les punitions qui alloient quelquefois à être en pénitence, et même chassée; les récompenses, qui étoient la distribution arrêtée tout à fait, ou plus ou moins fréquentes des distinctions, d’être des voyages de Marly, ou des amusements de la Dauphine, toutes ces choses entroient dans les occupations de Mme de Maintenon. Elle en amusoit le Roi, enclin à les prendre sérieusement; elles étoient utiles à entretenir la conversation, à servir ou à nuire, et à prendre de loin des tournants auprès du Roi sur bien des choses qu’elle y savoit habilement faire entrer de droite et de gauche.
On a déjà vu qu’elle répondoit à tout ce qui avoit recours à elle: qu’elle ne se mêloit de rien; et que ce qui l’approchoit de bien près n’avoit pas peu à essuyer de cette prodigieuse inconstance naturelle, qui, sans autre cause, changeoit si souvent ses goûts, ses inclinations, ses volontés. Les remèdes qu’on y cherchoit y étoient des poisons. L’unique parti à prendre étoit de glisser, de se tenir plus réservé, plus à l’écart, comme on se met à couvert de la pluie en se détournant un peu de son chemin. Quelquefois elle se rapprochoit et se rouvroit d’elle-même, comme d’elle-même elle s’étoit fermée et éloignée, sinon il n’y avoit point de ressource à espérer. Ces mutations, qui étoient également en gens et en choses, étoient accablantes 65 pour les ministres, pour les personnes qui se trouvoient en quelque commerce d’affaires avec elle, et pour les femmes dont, en très petit nombre et très rare, elle s’étoit imaginée de vouloir régler la conduite. Ce qui lui plaisoit hier, pas plus loin que cela, étoit un démérite aujourd’hui; ce qu’elle avoit approuvé, même suggéré, elle le blâmoit ensuite, tellement qu’on ne savoit jamais si on étoit digne d’amour ou de haine. C’eût été se perdre de lui montrer en excuse cette variation, qui s’étendoit, sur ces personnes choisies, jusqu’à leur manière de s’habiller et de se coiffer, et personne de tout ce qui à divers titres l’a approchée de près n’a été exempt, plus ou moins, de ces hauts et bas insupportables. La domination et le gouvernement furent les seules choses sur lesquelles elle n’en eut jamais.
66 CHÂTEAU DE VERSAILLES—PART OF THE FIRST STORY
After Blondel
67
| C | Salons. | |
| F | Apartments of Mme de Maintenon. | |
| H | Great Hall of the Guard. | |
| I | Hall of the Queen’s Guard. | |
| J | The Queen’s apartments, later those of the Duchesse de Bourgogne. | |
| L | ||
| M | ||
| K | Vestibule. | |
| N | Salon de la Paix. | |
| O | Great Gallery. | |
| P | Salon de la Guerre. | |
| Q | Salon d’Apollon or du Trône. | |
| R | Chambre du lit, later Salle de Mercure. | |
| S | Ball-room, later Salle de Mars. | |
| T | Billiard-room, later Salle de Diane. | |
| U | Salle, later Salle de Vénus. | |
| V | Salon de l’Abondance. | |
| X | Cabinet of Medals. | |
| Z | Ambassadors’ staircase. | |
| Z1 | Small gallery. | |
| a | Queen’s staircase. | |
| b | Salle used as a passage. | |
| c | Hall of the King’s Guard. | |
| d | Antechamber. | |
| e | Great antechamber, later the Œil de Bœuf. | |
| f | Bedroom of Louis XIV. | |
| g | Cabinet du Roi. | |
| h | Cabinet des Perruques ou des Termes. | |
| i | Billiard-room. | |
| j | Cabinet des Agates. | |
| k | ||
| l | Oval Salon. | |
| 11 | Cour de service. | |
| 12 | Cour de la Reine. | |
| 13 | Cour de marbre. | |
| 14 | Cour des cerfs. | |
L’appartement de Mme de Maintenon étoit de plein pied et faisant face à la salle des gardes du Roi. L’antichambre étoit plutôt un passage, long en travers, étroit jusqu’à une autre antichambre toute pareille de forme, dans laquelle les seuls capitaines des gardes entroient, puis une grande chambre très profonde. Entre la porte par où on y entrait de cette seconde antichambre et la cheminée étoit le fauteuil du Roi, adossé à la muraille, une table devant lui, et un ployant autour pour le ministre qui travailloit. De l’autre côté de la cheminée, une niche de damas rouge et un fauteuil où se tenoit Mme de Maintenon, avec une petite table devant elle; plus loin, son lit dans un enfoncement; vis-à-vis les pieds du lit, une porte et cinq marches à monter; puis un fort grand cabinet, qui donnoit dans la première antichambre de l’appartement de jour de Mgr le duc de Bourgogne, que cette porte enfiloit, et qui est aujourd’hui l’appartement du cardinal Fleury. Cette première antichambre ayant à droite cet appartement, et à gauche ce grand cabinet de Mme de Maintenon, descendoit, comme encore aujourd’hui, par cinq marches dans le salon de marbre contigu au palier du grand 68 degré du bout des deux galeries, haute et basse, dites de Mme la duchesse d’Orléans et des Princes. Tous les soirs, Mme la duchesse de Bourgogne jouoit dans le grand cabinet de Mme de Maintenon avec les dames à qui on avoit donné l’entrée, qui ne laissoit pas d’être assez étendue, et de là entroit tant et si souvent qu’elle vouloit dans la pièce joignante, qui étoit la chambre de Mme de Maintenon, où elle étoit avec le Roi, la cheminée entre eux deux. Monseigneur, après la comédie, montoit dans ce grand cabinet, où le Roi n’entroit point, et Mme de Maintenon presque jamais.
Avant le souper du Roi, les gens de Mme de Maintenon lui apportoient son potage avec son couvert, et quelque autre chose encore. Elle mangeoit, ses femmes et un valet de chambre la servoient, toujours le Roi présent, et presque toujours travaillant avec un ministre. Le souper achevé, qui étoit court, on emportoit la table; les femmes de Mme de Maintenon demeuroient, qui tout de suite la déshabilloient en un moment et la mettoient au lit. Lorsque le Roi étoit averti qu’il étoit servi, il alloit dire un mot à Mme de Maintenon, puis sonnoit une sonnette qui répondoit au grand cabinet. Alors Monseigneur, s’il y étoit, Mgr et Mme la duchesse de Bourgogne, M. le duc de Berry, et les dames qui étoient à elle entroient à la file dans la chambre de Mme de Maintenon, ne faisoient presque que la traverser, précédoient le Roi, qui alloit se mettre à table, suivi de Mme la duchesse de Bourgogne et de ses dames. Celles qui n’étoient point à elle, ou s’en alloient, ou si elles étoient habillées pour aller au souper, car le privilège de ce cabinet étoit d’y faire sa cour à Mme la duchesse de Bourgogne sans l’être, elles faisoient le tour par la grand’salle des gardes, sans entrer dans la chambre de Mme de Maintenon. Nul homme, sans exception que de ces trois princes, n’entroit dans ce grand cabinet[105].
Après avoir exposé avec la vérité et la fidélité la plus exacte tout ce qui est venu à ma connoissance par moi-même, ou par ceux qui ont vu ou manié les choses et les affaires pendant les vingt-deux dernières années[107] de Louis XIV, et l’avoir montré tel qu’il a été, sans aucune passion, quoique je me sois permis les raisonnements résultant naturellement des choses, il ne me reste plus qu’à exposer l’écorce extérieure de la vie de ce monarque, depuis que j’ai continuellement habité à sa cour.
Quelque insipide et peut-être superflu qu’un détail, encore si public, puisse paroître après tout ce qu’on a vu d’intérieur, il s’y trouvera encore des leçons pour les rois qui voudront se faire respecter et qui voudront se respecter eux-mêmes. Ce qui m’y détermine encore, c’est que l’ennuyeux, je dirai plus, le dégoûtant pour un lecteur instruit de ce dehors public, par ceux qui auront pu encore en avoir été témoins, échappe bientôt à la connoissance de la postérité, et que l’expérience nous apprend que nous regrettons de ne trouver personne qui se soit donné une peine pour leur temps si ingrate, mais pour la postérité, curieuse, et qui ne laisse pas de caractériser les princes qui ont fait autant de bruit dans le monde que celui dont il s’agit ici. Quoique il soit difficile de ne pas tomber en quelques redites, je m’en défendrai autant qu’il me sera possible.
Je ne parlerai point de la manière de vivre du Roi quand il s’est trouvé dans ses armées; ses heures y étoient déterminées par ce qui se présentoit à faire, en 70 tenant néanmoins régulièrement ses conseils; je dirai seulement qu’il n’y mangeoit soir et matin qu’avec des gens d’une qualité à pouvoir avoir cet honneur. Quand on y pouvoit prétendre, on le faisoit demander au Roi par le premier gentilhomme de la chambre en service. Il rendoit la réponse, et dès le lendemain, si elle étoit favorable, on se présentoit au Roi lorsqu’il alloit dîner, qui vous disoit: “Monsieur, mettez-vous à table.” Cela fait, c’étoit pour toujours, et on avoit après l’honneur d’y manger quand on vouloit, avec discrétion. Les grades militaires, même d’ancien lieutenant général, ne suffisoient pas. On a vu que M. de Vauban, lieutenant général si distingué depuis tant d’années, y mangea pour la première fois à la fin du siège de Namur, et qu’il fut comblé de cette distinction; comme aussi les colonels de qualité distinguée y étoient admis sans difficulté. Le Roi fit le même honneur à Namur à l’abbé de Grancey[108], qui s’exposoit partout à confesser les blessés et à encourager les troupes. C’est l’unique abbé qui ait eu cet honneur. Tout le clergé en fut toujours exclu, excepté les cardinaux et les évêques-pairs, ou les ecclésiastiques ayant rang de prince étranger. Le cardinal de Coislin[109], avant d’avoir la pourpre, étant évêque d’Orléans, premier aumônier et suivant le Roi en toutes ses campagnes, et l’archevêque de Reims, qui suivoit le Roi comme maître de sa chapelle, y voyoit manger le duc et le chevalier de Coislin, ses frères, sans y avoir jamais prétendu. Nul officier des gardes du corps n’y a mangé non plus, quelque préférence que le Roi eût pour ce corps, que le seul marquis d’Urfé[110] par une distinction unique, je ne sais qui la lui valut en ces temps reculés de moi; et du régiment des gardes, jamais que le seul colonel, ainsi que les capitaines des gardes du corps.
A ces repas tout le monde étoit couvert; c’eût été un 71 manque de respect dont on vous auroit averti sur-le-champ de n’avoir pas son chapeau sur sa tête; Monseigneur même l’avoit: le Roi seul étoit découvert. On se découvroit quand le Roi vous parloit, ou pour parler à lui, et on se contentoit de mettre la main au chapeau pour ceux qui venoient faire leur cour le repas commencé, et qui étoient de qualité à avoir pu se mettre à table. On se découvroit aussi pour parler à Monseigneur et à Monsieur, ou quand ils vous parloient. S’il y avoit des princes du sang, on mettoit seulement la main au chapeau pour leur parler ou s’ils vous parloient. Voilà ce que j’ai vu au siège de Namur, et ce que j’ai su de toute la cour. Les places qui approchoient du Roi se laissoient aussi aux titres, et après aux grades; si on en avoit laissé qui ne s’en remplissent pas, on se rapprochoit. Quoique à l’armée, les maréchaux de France n’y avoient point de préférence sur les ducs, et ceux-ci, et les princes étrangers, ou qui en avoient rang, se plaçoient les uns avec les autres comme ils se rencontroient, sans affectation. Mais duc, prince ou maréchal de France, si le hasard faisoit qu’ils n’eussent pas encore mangé avec le Roi, il falloit s’adresser au premier gentilhomme de la chambre. On juge bien que cela ne faisoit pas de difficulté. Il n’y avoit là-dessus que les princes du sang exceptés. Le Roi seul avoit un fauteuil; Monseigneur même, et tout ce qui étoit à table, avoient des sièges à dos de maroquin noir, qui se pouvoient briser pour les voiturer, qu’on appeloit des perroquets. Ailleurs qu’à l’armée, le Roi n’a jamais mangé avec aucun homme, en quelque cas que ç’ait été, non pas même avec aucun prince du sang, qui n’y ont mangé qu’à des festins de leurs noces, quand le Roi les a voulu faire, comme on en a vu le oui et le non en leurs temps. Revenons maintenant à la cour.
A huit heures, le premier valet de chambre en quartier, qui avoit couché seul dans la chambre du Roi, et qui s’étoit habillé, l’éveilloit. Le premier médecin, le premier chirurgien, et sa nourrice tant qu’elle a vécu, entroient en même temps. Elle alloit le baiser, les autres le frottoient, 72 et souvent lui changeoient de chemise, parce qu’il étoit sujet à suer. Au quart, on appeloit le grand chambellan, en son absence le premier gentilhomme de la chambre d’année, avec eux les grandes entrées. L’un de ces deux ouvroit le rideau qui étoit refermé, et présentoit l’eau bénite du bénitier du chevet du lit. Ces Messieurs étoient là un moment, et c’en étoit un de parler au Roi s’ils avoient quelque chose à lui dire ou à lui demander, et alors les autres s’éloignoient; quand aucun d’eux n’avoit à parler, comme d’ordinaire, ils n’étoient là que quelques moments. Celui qui avoit ouvert le rideau et présenté l’eau bénite présentoit le livre de l’office du Saint-Esprit, puis passoient tous dans le cabinet du Conseil. Cet office fort court dit, le Roi appeloit; ils rentroient. Le même lui donnoit sa robe de chambre, et ce pendant les secondes entrées ou brevets d’affaires entroient; peu de moments après, la chambre; aussitôt, ce qui étoit là de distingué, puis tout le monde, qui trouvoit le Roi se chaussant; car il se faisoit presque tout lui-même, avec adresse et grâce. On lui voyoit faire la barbe de deux jours l’un, et il avoit une petite perruque courte, sans jamais en aucun temps, même au lit, les jours de médecine, paroître autrement en public. Souvent il parloit de chasse, et quelquefois quelque mot à quelqu’un. Point de toilette à portée de lui; on lui tenoit seulement un miroir.
Dès qu’il étoit habillé, il alloit prier Dieu à la ruelle de son lit, où tout ce qu’il y avoit de clergé se mettoit à genoux, les cardinaux sans carreau; tous les laïques demeuroient debout, et le capitaine des gardes venoit au balustre pendant la prière, d’où le Roi passoit dans son cabinet.
Il y trouvoit ou y étoit suivi de tout ce qui avoit cette entrée, qui étoit fort étendue par les charges, qui l’avoient toutes. Il y donnoit l’ordre à chacun pour la journée; ainsi on savoit, à un demi-quart d’heure près, tout ce que le Roi devoit faire. Tout ce monde sortoit ensuite. Il ne demeuroit que les bâtards, MM. de Montchevreuil[111] et 73 d’O[112], comme ayant été leurs gouverneurs, Mansart[113], et après lui d’Antin[114], qui tous entroient, non par la chambre mais par les derrières, et les valets intérieurs. C’étoit là leur bon temps aux uns et aux autres, et celui de raisonner sur les plans des jardins et des bâtiments, et cela duroit plus ou moins, selon que le Roi avoit affaire.
Toute la cour attendoit cependant dans la galerie, le capitaine des gardes seul dans la chambre, assis à la porte du cabinet, qu’on avertissoit quand le Roi vouloit aller à la messe, et qui alors entroit dans le cabinet. A Marly, la cour attendoit dans le salon; à Trianon, dans les pièces de devant, comme à Meudon; à Fontainebleau, on demeuroit dans la chambre et l’antichambre.
Cet entre-temps étoit celui des audiences, quand le Roi en accordoit, ou qu’il vouloit parler à quelqu’un, et des audiences secrètes des ministres étrangers, en présence de Torcy. Elles n’étoient appelées secrètes que pour les distinguer de celles qui se donnoient sans cérémonie à la ruelle du lit, au sortir de la prière, qu’on appeloit particulières, où celles de cérémonie se donnoient aussi aux ambassadeurs.
Le Roi alloit à la messe, où sa musique chantoit toujours un motet. Il n’alloit en bas qu’aux grandes fêtes, ou pour des cérémonies. Allant et revenant de la messe, chacun lui parloit qui vouloit, après l’avoir dit au capitaine des gardes si ce n’étoit gens distingués, et il y alloit, et rentroit par la porte des cabinets dans la galerie. Pendant la messe, les ministres étoient avertis, et s’assembloient dans la chambre du Roi, où les gens distingués pouvoient aller leur parler ou causer avec eux. Le Roi s’amusoit 74 peu au retour de la messe, et demandoit presque aussitôt le conseil. Alors la matinée étoit finie.
Le dimanche il y avoit conseil d’État[115], et souvent les lundis; les mardis, conseil de finance; les mercredis, conseil d’État; les samedis, conseil de finances. Il étoit rare qu’il y en eût deux par jour, et qu’il s’en tînt les jeudis ni les vendredis. Une ou deux fois le mois, il y avoit un lundi matin conseil de dépêches; mais les ordres que les secrétaires d’État prenoient tous les matins, entre le lever et la messe, abrégeoient et diminuoient fort ces sortes d’affaires. Tous les ministres étoient assis en rang entre eux, après le chancelier et le duc de Beauvillier, et le maréchal de Villeroy, et qui succéda au duc de Beauvillier, excepté au conseil de dépêches, où tous étoient debout, tout du long, excepté les fils de France quand il y en avoit, le chancelier et le duc de Beauvillier. Rarement, pour des affaires extraordinaires évoquées, et vues dans un bureau de conseillers d’État, ces mêmes conseillers d’État venoient à un conseil donné exprès de finance ou de dépêche, mais où on ne parloit que de cette seule affaire. Alors tous étoient assis, et les conseillers d’État y coupoient les secrétaires d’État et le contrôleur général, suivant leur ancienneté de conseiller d’État entre eux, et un maître des requêtes rapportoit debout, lui et les conseillers d’État en robes. Le jeudi matin étoit presque toujours vuide. C’étoit le temps des audiences que le Roi vouloit donner, et le plus souvent des audiences inconnues, par les derrières; c’étoit aussi le grand jour des bâtards, des bâtiments, des valets intérieurs, parce que le Roi n’avoit rien à faire. Le vendredi après la messe étoit le temps du confesseur, qui n’étoit borné par rien, et qui pouvoit durer jusqu’au dîner. A Fontainebleau, ces matins-là qu’il n’y avoit point de conseil, le Roi passoit très ordinairement de la messe chez Mme de Maintenon; et de même à Trianon et à Marly, quand elle n’étoit pas allée dès le matin à Saint-Cyr. C’étoit le temps de leur tête-à-tête sans ministre et sans interruption, et à 75 Fontainebleau jusqu’à dîner. Souvent, les jours qu’il n’y avoit pas de conseil, le dîner étoit avancé plus ou moins pour la chasse ou la promenade. L’heure ordinaire étoit une heure; si le Conseil duroit encore, le dîner attendoit, et on n’avertissoit point le Roi. Après le conseil de finance, Desmarets restoit souvent seul à travailler avec le Roi.
Le dîner étoit toujours au petit couvert, c’est-à-dire seul dans sa chambre, sur une table carrée vis-à-vis la fenêtre du milieu. Il étoit plus ou moins abondant; car il ordonnoit le matin petit couvert ou très petit couvert; mais ce dernier étoit toujours de beaucoup de plats et de trois services sans le fruit. La table entrée, les principaux courtisans entroient, puis tout ce qui étoit connu, et le premier gentilhomme de la chambre en année alloit avertir le Roi. Il le servoit si le grand chambellan n’y étoit pas.
Le marquis de Gesvres, depuis duc de Tresmes[116], prétendit que, le dîner commencé, M. de Bouillon arrivant ne lui pouvoit ôter le service, et fut condamné. J’ai vu M. de Bouillon arriver derrière le Roi au milieu du dîner, et M. de Beauvillier, qui servoit, lui vouloir donner le service, qu’il refusa poliment, et dit qu’il toussoit trop et étoit trop enrhumé. Ainsi il demeura derrière le fauteuil, et M. de Beauvillier continua le service, mais à son refus public. Le marquis de Gesvres avoit tort: le premier gentilhomme de la chambre n’a que le commandement dans la chambre, etc., et nul service; c’est le grand chambellan qui l’a tout entier, et nul commandement; ce n’est qu’en son absence que le premier gentilhomme de la chambre sert; mais si le premier gentilhomme de la chambre est absent, et qu’il n’y en ait aucun autre, ce n’est point le grand chambellan qui commande dans la chambre, c’est le premier valet de chambre.
J’ai vu, mais fort rarement, Monseigneur et Messeigneurs ses fils au petit couvert, debout, sans que jamais 76 le Roi leur ait proposé un siège. J’y ai vu continuellement les princes du sang et les cardinaux tout du long. J’y ai vu assez souvent Monsieur, ou venant de Saint-Cloud voir le Roi, ou sortant du conseil de dépêches, le seul où il entroit. Il donnoit la serviette et demeuroit debout; un peu après, le Roi, voyant qu’il ne s’en alloit point, lui demandoit s’il ne vouloit point s’asseoir; il faisoit la révérence, et le Roi ordonnoit qu’on lui apportât un siège; on mettoit un tabouret derrière lui. Quelques moments après, le Roi lui disoit: “Mon frère, asseyez-vous donc.” Il faisoit la révérence, et s’asseoyoit jusqu’à la fin du dîner, qu’il présentoit la serviette. D’autrefois, quand il venoit de Saint-Cloud, le Roi en arrivant à table demandoit un couvert pour Monsieur, ou bien lui demandoit s’il ne vouloit pas dîner. S’il le refusoit, il s’en alloit un moment après sans qu’il fût question de siège; s’il l’acceptoit, le Roi demandoit un couvert pour lui. La table étoit carrée; il se mettoit à un bout, le dos au cabinet. Alors le grand chambellan, s’il servoit, ou le premier gentilhomme de la chambre, donnoit à boire et des assiettes à Monsieur, et prenoit de lui celles qu’il ôtoit, tout comme il faisoit au Roi; mais Monsieur recevoit tout ce service avec une politesse fort marquée. S’ils alloient à son lever, comme cela leur arrivoit quelquefois, ils ôtoient le service au premier gentilhomme de sa chambre, et le faisoient, dont Monsieur se montroit fort satisfait. Quand il étoit au dîner du Roi, il remplissoit et il égayoit fort la conversation. Là, quoique à table, il donnoit la serviette au Roi en s’y mettant et en sortant; et, en la rendant au grand chambellan, il y lavoit. Le Roi, d’ordinaire, parloit peu à son dîner, quoique par-ci par-là quelques mots, à moins qu’il n’y eût de ces seigneurs familiers avec qui il causoit un peu plus, ainsi qu’à son lever.
De grand couvert à dîner, cela étoit extrêmement rare: quelques grandes fêtes, ou à Fontainebleau quelquefois, quand la reine d’Angleterre y étoit. Aucune dame ne venoit au petit couvert; j’y ai seulement vu très rarement 77 la maréchale de la Mothe[117], qui avoit conservé cela d’y avoir amené les enfants de France, dont elle avoit été gouvernante. Dès qu’elle y paroissoit, on lui apportoit un siège, et elle s’asseoyoit; car elle étoit duchesse à brevet.
Au sortir de table, le Roi rentroit tout de suite dans son cabinet. C’étoit là un des moments de lui parler, pour des gens distingués. Il s’arrêtoit à la porte un moment à écouter, puis il entroit, et très rarement l’y suivoit-on, jamais sans le lui demander, et c’est ce qu’on n’osoit guères. Alors il se mettoit avec celui qui le suivoit dans l’embrasure de la fenêtre la plus proche de la porte du cabinet, qui se fermoit aussitôt, et que l’homme qui parloit au Roi rouvroit lui-même pour sortir, en quittant le Roi. C’étoit encore le temps des bâtards et des valets intérieurs, quelquefois des bâtiments, qui attendoient dans les cabinets de derrière, excepté le premier médecin, qui étoit toujours au dîner, et qui suivoit dans les cabinets. C’étoit aussi le temps où Monseigneur se trouvoit quand il n’avoit pas vu le Roi le matin; il entroit et sortoit par la porte de la galerie.
Le Roi s’amusoit à donner à manger à ses chiens couchants, et avec eux plus ou moins, puis demandoit sa garde-robe, et changeoit devant le très peu de gens distingués qu’il plaisoit au premier gentilhomme de la chambre d’y laisser entrer, et tout de suite le Roi sortoit par derrière et par son petit degré dans la cour de Marbre pour monter en carrosse; depuis le bas de ce degré jusqu’à son carrosse, lui parloit qui vouloit, et de même en revenant.
Le Roi aimoit extrêmement l’air, et quand il en étoit privé, sa santé en souffroit par des maux de tête et par des vapeurs, que lui avoit causés un grand usage de parfums autrefois, tellement qu’il y avoit bien des années, que, excepté l’odeur de la fleur d’orange, il n’en pouvoit souffrir aucune, et qu’il falloit être fort en garde de n’en avoir point, pour peu qu’on eût à l’approcher.
78 Comme il étoit peu sensible au froid et au chaud, même à la pluie, il n’y avoit que des temps extrêmes qui l’empêchassent de sortir tous les jours. Ces sorties n’avoient que trois objets: courre le cerf, au moins une fois la semaine, et souvent plusieurs, à Marly et à Fontainebleau, avec ses meutes et quelques autres; tirer dans ses parcs, et homme en France ne tiroit si juste, si adroitement, ni de si bonne grâce, et il y alloit aussi une ou deux fois la semaine, surtout les dimanches et les fêtes qu’il ne vouloit point de grandes chasses, et qu’il n’avoit point d’ouvriers; les autres jours voir travailler et se promener dans ses jardins et ses bâtiments; quelquefois des promenades avec des dames, et la collation pour elles, dans la forêt de Marly et dans celle de Fontainebleau; et dans ce dernier lieu, des promenades avec toute la cour autour du canal, qui étoit un spectacle magnifique, où quelques courtisans se trouvoient à cheval. Aucuns ne le suivoient en ses autres promenades que ceux qui étoient en charges principales qui approchoient le plus de sa personne, excepté lorsque, assez rarement, il se promenoit dans ses jardins de Versailles, où lui seul étoit couvert, ou dans ceux de Trianon, lorsqu’il y couchoit et qu’il y étoit pour quelques jours, non quand il y alloit de Versailles s’y promener et revenir après. A Marly de même; mais s’il y demeuroit, tout ce qui étoit du voyage avoit toute liberté de l’y suivre dans les jardins, l’y joindre, l’y laisser, en un mot, comme ils vouloient.
Ce lieu avoit encore un privilège qui n’étoit pour nul autre; c’est qu’en sortant du château, le Roi disoit tout haut: Le chapeau, Messieurs; et aussitôt courtisans, officiers des gardes du corps, gens des bâtiments se couvroient tous, en avant, en arrière, à côté de lui, et il auroit trouvé mauvais si quelqu’un eût non-seulement manqué, mais différé à mettre son chapeau, et cela duroit toute la promenade, c’est-à-dire quelquefois quatre et cinq heures en été, ou en d’autres saisons, quand il mangeoit de bonne heure à Versailles pour s’aller promener à Marly, et n’y point coucher.
79 La chasse du cerf étoit plus étendue. Y alloit à Fontainebleau qui vouloit; ailleurs, il n’y avoit que ceux qui en avoient obtenu la permission une fois pour toutes, et ceux qui en avoient obtenu le justaucorps, qui étoit uniforme, bleu, avec des galons, un d’argent entre deux d’or, doublé de rouge. Il y en avoit un assez grand nombre, mais jamais qu’une partie à la fois, que le hasard rassembloit. Le Roi aimoit à y avoir une certaine quantité, mais le trop l’importunoit, et troubloit la chasse. Il se plaisoit qu’on l’aimât, mais il ne vouloit pas qu’on y allât sans l’aimer; il trouvoit cela ridicule, et ne savoit aucun mauvais gré à ceux qui n’y alloient jamais.
Il en étoit de même du jeu, qu’il vouloit gros et continuel dans le salon de Marly pour le lansquenet, et force tables d’autres jeux par tout le salon. Il s’amusoit volontiers à Fontainebleau, les jours de mauvais temps, à voir jouer les grands joueurs à la paume, où il avoit excellé autrefois[118], et à Marly très souvent, à voir jouer au mail[119], où il avoit aussi été fort adroit.
Quelquefois, les jours qu’il n’y avoit point de conseil, qui n’étoient pas maigres, et qu’il étoit à Versailles, il alloit dîner à Marly ou à Trianon avec Mme la duchesse de Bourgogne, Mme de Maintenon et des dames, et cela devint beaucoup plus ordinaire ces jours-là les trois dernières années de sa vie. Au sortir de table, en été, le ministre qui devoit travailler avec lui arrivoit, et quand le travail étoit fini, il passoit jusqu’au soir à se promener avec les dames, à jouer avec elles, et assez souvent à leur 80 faire tirer une loterie toute de billets noirs, sans y rien mettre; c’étoit ainsi une galanterie de présents qu’il leur faisoit, au hasard, de choses à leur usage, comme d’étoffes et d’argenterie, ou de joyaux ou beaux ou jolis, pour donner plus au hasard. Mme de Maintenon tiroit comme les autres, et donnoit presque toujours sur-le-champ ce qu’elle avoit gagné. Le Roi ne tiroit point, et souvent il y avoit plusieurs billets sous le même lot. Outre ces jours-là, il y avoit assez souvent de ces loteries quand le Roi dînoit chez Mme de Maintenon. Il s’avisa fort tard de ces dîners, qui furent longtemps rares, et qui sur la fin vinrent à une fois la semaine avec les dames familières, avec musique et jeu. A ces loteries, il n’y avoit que des dames du palais et des dames familières, et plus de dames du palais depuis la mort de Madame la Dauphine; mais il y en avoit trois, Mmes de Levis[120], Dangeau[121] et d’O[122], qui étoient familières. L’été, le Roi travailloit chez lui, au sortir de table, avec les ministres, et lorsque les jours s’accourcissoient, il y travailloit le soir chez Mme de Maintenon.
A son retour de dehors, lui parloit qui vouloit, depuis son carrosse jusqu’au bas de son petit degré. Il se rhabilloit comme il avoit changé d’habit, et restoit dans son cabinet. C’étoit le meilleur temps des bâtards, des valets intérieurs et des bâtiments. Ces intervalles-là, qui arrivoient trois fois par jour, étoient leurs temps, celui des rapporteurs de vive voix ou par écrit, celui où le Roi écrivoit, s’il avoit à écrire lui-même. Au retour de ses promenades, il étoit une heure et plus dans ses cabinets, puis passoit chez Mme de Maintenon, et en chemin lui parloit encore qui vouloit.
A dix heures il étoit servi. Le maître d’hôtel en quartier, ayant son bâton, alloit avertir le capitaine des gardes en 81 quartier dans l’antichambre de Mme de Maintenon, où, averti lui-même par un garde de l’heure, il venoit d’arriver. Il n’y avoit que les capitaines des gardes qui entrassent dans cette antichambre, qui étoit fort petite, entre la chambre où étoient le Roi et Mme de Maintenon, et une autre très petite antichambre pour les officiers, et le dessus public du degré, où le gros étoit. Le capitaine des gardes se montrait à l’entrée de la chambre, disant au Roi qu’il étoit servi, revenoit dans l’instant dans l’antichambre. Un quart d’heure après, le Roi venoit souper, toujours au grand couvert, et depuis l’antichambre de Mme de Maintenon jusqu’à sa table, lui parloit encore qui vouloit.
A son souper, toujours au grand couvert, avec la maison royale, c’est-à-dire uniquement les fils et filles de France et les petits-fils et petites-filles de France, étoient toujours grand nombre de courtisans, et de dames tant assises que debout, et la surveille des voyages de Marly toutes celles qui vouloient y aller; cela s’appeloit se présenter pour Marly. Les hommes demandoient le même jour le matin, en disant au Roi seulement: “Sire, Marly.” Les dernières années le Roi s’en importuna: un garçon bleu écrivoit dans la galerie les noms de ceux qui demandoient, et qui y alloient se faire écrire. Pour les dames, elles continuèrent toujours à se présenter.
Après souper, le Roi se tenoit quelques moments debout, le dos au balustre du pied de son lit, environné de toute la cour; puis, avec des révérences aux dames, passoit dans son cabinet, où en arrivant il donnoit l’ordre. Il y passoit un peu moins d’une heure avec ses enfants légitimes et bâtards, ses petits-enfants légitimes et bâtards, et leurs maris ou leurs femmes, tous dans un cabinet, le Roi dans un fauteuil, Monsieur dans un autre, qui dans le particulier vivoit avec le Roi en frère, Monseigneur debout ainsi que tous les autres princes, et les princesses sur des tabourets. Madame y fut admise après la mort de Madame la Dauphine. Ceux qui entroient par les derrières s’y trouvoient, et qu’on a nommés, et les valets 82 intérieurs avec Chamarande, qui avoit été premier valet de chambre en survivance de son père, et qui étoit devenu depuis premier maître d’hôtel de Madame la Dauphine de Bavière, et lieutenant général distingué, fort à la mode dans le monde, et avec fort peu d’esprit un fort galant homme, et bien reçu partout.
Les dames d’honneur des princesses, et les dames du palais de jour, attendoient dans le cabinet du Conseil, qui précédoit celui où étoit le Roi à Versailles, et ailleurs. A Fontainebleau, où il n’y avoit qu’un grand cabinet, les dames des princesses qui étoient assises achevoient le cercle avec les princesses, au même niveau et sur mêmes tabourets; les autres dames étoient derrière, en liberté de demeurer debout, ou de s’asseoir par terre sans carreau, comme plusieurs faisoient. La conversation n’étoit guère que de chasse ou de quelque autre chose aussi indifférente.
Le Roi, voulant se retirer, alloit donner à manger à ses chiens, puis donnoit le bonsoir, passoit dans sa chambre à la ruelle de son lit, où il faisoit sa prière comme le matin, puis se déshabilloit. Il donnoit le bonsoir d’une inclination de tête, et tandis qu’on sortoit, il se tenoit debout au coin de la cheminée, où il donnoit l’ordre au colonel des gardes seul; puis commençoit le petit coucher, où restoient les grandes et secondes entrées ou brevets d’affaires. Cela étoit court. Ils ne sortoient que lorsqu’il se mettoit au lit. Ce moment en étoit un de lui parler pour ces privilégiés; alors tous sortoient quand ils en voyoient un attaquer le Roi, qui demeuroit seul avec lui.
Lorsque le Roi mourut, il y avoit dix ou douze ans que ce qui n’avoit point ces entrées ne demeuroit plus au coucher, depuis une longue attaque de goutte que le Roi avoit eue, en sorte qu’il n’y avoit plus de grand coucher, et que la cour étoit finie au sortir du souper. Alors le colonel des gardes prenoit l’ordre avec tous les autres, et les aumôniers de quartier, et le grand et le premier aumônier sortoient après la prière.
Les jours de médecine, qui revenoient tous les mois au 83 plus loin, il la prenoit dans son lit, puis entendoit la messe, où il n’y avoit que les aumôniers et les entrées. Monseigneur et la maison royale venoient le voir un moment; puis M. du Maine, M. le comte de Toulouse, lequel y demeuroit peu, et Mme de Maintenon venoient l’entretenir. Il n’y avoit qu’eux et les valets intérieurs dans le cabinet, la porte ouverte. Mme de Maintenon s’asseyoit dans le fauteuil au chevet du lit. Monsieur s’y mettoit quelquefois, mais avant que Mme de Maintenon fût venue, et d’ordinaire après qu’elle étoit sortie; Monseigneur toujours debout, et les autres de la maison royale un moment. M. du Maine, qui y passoit toute la matinée, et qui étoit fort boiteux, se mettoit auprès du lit sur un tabouret, quand il n’y avoit personne que Mme de Maintenon et son frère. C’étoit où il tenoit le dé à les amuser tous deux, et où souvent il en faisoit de bonnes. Le Roi dînoit dans son lit, sur les trois heures, où tout le monde entroit, puis se levoit, et il n’y demeuroit que les entrées. Il passoit après dans son cabinet, où il tenoit conseil, et après il alloit à l’ordinaire chez Mme de Maintenon, et soupoit à dix heures au grand couvert.
Le Roi n’a de sa vie manqué la messe qu’une fois à l’armée, un jour de grande marche, ni aucun jour maigre, à moins de vraie et très rare incommodité. Quelques jours avant le carême, il tenoit un discours public à son lever, par lequel il témoignoit qu’il trouverait fort mauvais qu’on donnât à manger gras à personne, sous quelque prétexte que ce fût, et ordonnoit au grand prévôt d’y tenir la main, et de lui en rendre compte. Il ne vouloit pas non plus que ceux qui mangeoient gras mangeassent ensemble, ni autre chose que bouilli et rôti fort court, et personne n’osoit outre-passer ses défenses; car on s’en serait bientôt ressenti. Elles s’étendoient à Paris, où le lieutenant de police y veilloit et lui en rendoit compte. Il y avoit douze ou quinze ans qu’il ne faisoit plus de carême; d’abord quatre jours maigres, puis trois, et les quatre derniers de la semaine sainte. Alors son très petit couvert étoit fort retranché les jours qu’il faisoit 84 gras; et le soir au grand couvert tout étoit collation[123], et le dimanche tout étoit en poisson; cinq ou six plats gras tout au plus, tant pour lui que pour ceux qui à sa table mangeoient gras. Le vendredi saint, grand couvert matin et soir, en légumes, sans aucun poisson, ni à pas une de ses tables.
Il manquoit peu de sermons l’avent et le carême, et aucune des dévotions de la semaine sainte, des grandes fêtes, ni les deux processions du Saint Sacrement, ni celles des jours de l’ordre du Saint-Esprit, ni celle de l’Assomption. Il étoit très respectueusement à l’église. A sa messe tout le monde étoit obligé de se mettre à genoux au Sanctus, et d’y demeurer jusqu’après la communion du prêtre; et s’il entendoit le moindre bruit ou voyoit causer pendant la messe, il le trouvoit fort mauvais. Il manquoit rarement le salut les dimanches, s’y trouvoit souvent les jeudis, et toujours pendant toute l’octave du Saint Sacrement. Il communioit toujours en collier de l’Ordre, rabat et manteau, cinq fois l’année, le samedi saint à la paroisse, les autres jours à la chapelle, qui étoient la veille de la Pentecôte, le jour de l’Assomption, et la grand messe après, la veille de la Toussaint et la veille de Noël, et une messe basse après celle où il avoit communié, et ces jours-là point de musique à ses messes, et à chaque fois il touchoit les malades. Il alloit à vêpres les jours de communion, et après vêpres il travailloit dans son cabinet, avec son confesseur, à la distribution des bénéfices qui vaquoient; il n’y avoit rien de plus rare que de lui voir donner aucun bénéfice en d’autres temps; il alloit le lendemain à la grand messe et à vêpres. A matines et à trois messes de minuit en musique, et c’étoit un spectacle admirable que la chapelle; le lendemain à la grand messe, à vêpres, au salut. Le jeudi saint, il servoit les pauvres à dîner, et après la collation, il ne faisoit qu’entrer dans son cabinet, 85 et passoit à la tribune adorer le Saint Sacrement, et se venoit coucher tout de suite. A la messe, il disoit son chapelet (il n’en savoit pas davantage), et toujours à genoux, excepté à l’évangile. Aux grandes messes, il ne s’asseyoit dans son fauteuil qu’aux temps où on a coutume de s’asseoir. Aux jubilés, il faisoit presque toujours ses stations à pied; et tous les jours de jeûne, et ceux du carême où il mangeoit maigre, il faisoit seulement collation.
Il étoit toujours vêtu de couleur plus ou moins brune avec une légère broderie, jamais sur les tailles, quelquefois rien qu’un bouton d’or, quelquefois du velours noir. Toujours une veste de drap ou de satin rouge, ou bleue, ou verte, fort brodée. Jamais de bague, et jamais de pierreries qu’à ses boucles de souliers, de jarretières, et de chapeau toujours bordé de point d’Espagne avec un plumet blanc. Toujours le cordon bleu dessous, excepté des noces ou autres fêtes pareilles qu’il le portoit par dessus, fort long avec pour huit ou dix millions de pierreries. Il étoit le seul de la maison royale et des princes du sang qui portât l’Ordre dessous, en quoi fort peu de chevaliers de l’Ordre l’imitoient, et aujourd’hui presque aucun ne le porte dessus, les bons par honte de leurs confrères, et ceux-là embarrassés de le porter.
Jusqu’à la promotion de 1661 inclusivement, les chevaliers de l’Ordre en portoient tous le grand habit à toutes les trois cérémonies de l’Ordre, y alloient à l’offrande, et y communiant. Le Roi retrancha lors le grand habit, l’offrande et la communion. Henri III l’avoit prescrite à cause des huguenots et de la Ligue. La vérité est qu’une communion générale, publique, en pompe, prescrite à jour nommé trois fois l’an à des courtisans, devient une terrible et bien dangereuse pratique, qu’il a été très bon d’ôter; mais pour l’offrande, qui étoit majestueuse, où il n’y a plus que le Roi qui y aille, et le grand habit de l’Ordre réduit aux jours de réception, et le plus souvent encore seulement pour ceux qui sont reçus, cela ôte toute la beauté de la cérémonie. A l’égard du repas en réfectoire avec le Roi, on a dit ailleurs ce qui l’a fait supprimer.
86 Il ne se passoit guère quinze jours que le Roi n’allât à Saint-Germain, même après la mort du roi Jacques II. La cour de Saint-Germain venoit aussi à Versailles, mais plus souvent à Marly, et souvent y souper, et nulle fête de cérémonie ou de divertissement qu’elle n’y fût invitée, qu’elle n’y vînt et dont elle ne reçût tous les honneurs. Ils étoient réciproquement convenus de se recevoir et se conduire dans le milieu de leur appartement. A Marly, le Roi les recevoit et les conduisoit à la porte du petit salon du côté de la Perspective, et les y voyoit descendre et monter dans leur chaise à porteurs; à Fontainebleau, tous les voyages, au haut de l’escalier à fer à cheval, depuis que le Roi leur eut accordé de ne les aller plus recevoir et conduire au bout de la forêt. Rien n’étoit pareil aux soins, aux égards, à la politesse du Roi pour eux, ni à l’air de majesté et de galanterie avec lequel cela se passoit à chaque fois; on en a parlé ailleurs plus au long. A Marly, ils demeuroient en arrivant un quart d’heure dans le salon, debout au milieu de toute la cour, puis passoient chez le Roi ou chez Mme de Maintenon. Le Roi n’entroit jamais dans le salon que pour le traverser, pour des bals, ou pour y voir jouer un moment le jeune roi d’Angleterre ou l’électeur de Bavière. Les jours de naissance ou de la fête du Roi et de sa famille, si observés dans les cours de l’Europe, ont toujours été inconnus dans celle du Roi, en sorte que jamais il n’y en a été fait la moindre mention en rien, ni différence aucune de tous les autres jours de l’année.
Louis XIV ne fut regretté que de ses valets intérieurs, de peu d’autres gens, et des chefs de l’affaire de la Constitution. Son successeur n’en étoit pas en âge. Madame n’avoit pour lui que de la crainte et de la bienséance. Mme la duchesse de Berry ne l’aimoit pas, et comptoit aller régner. M. le duc d’Orléans n’étoit pas payé pour le pleurer, et ceux qui l’étoient n’en firent pas leur charge. Mme de Maintenon étoit excédée du Roi depuis la perte de la Dauphine; elle ne savoit qu’en faire ni à quoi l’amuser; sa contrainte en étoit triplée, parce qu’il étoit beaucoup 87 plus chez elle, ou en parties avec elle. Sa santé, ses affaires, les manèges qui avoient fait tout faire, ou pour parler plus exactement, qui avoient tout arraché pour le duc du Maine, avoient fait essuyer continuellement d’étranges humeurs, et souvent des sorties, à Mme de Maintenon. Elle étoit venue à bout de ce qu’elle avoit voulu; ainsi, quoi qu’elle perdît en perdant le Roi, elle se sentit délivrée, et ne fut capable que de ce sentiment. L’ennui et le vide dans la suite rappelèrent les regrets; mais comme elle n’influa plus rien de sa retraite, il n’est pas temps de parler d’elle, ni des occupations qu’elle s’y fit.
On a vu jusqu’à quelle joie, à quelle barbare indécence le prochain point de vue de la toute puissance jeta le duc du Maine. La tranquillité glacée de son frère ne s’en haussa ni baissa. Madame la Duchesse, affranchie de tous ses liens, n’avoit plus besoin de l’appui du Roi, elle n’en sentoit que la crainte et la contrainte, elle ne pouvoit souffrir Mme de Maintenon; elle ne pouvoit douter de la partialité du Roi pour le duc du Maine dans leur procès de la succession de Monsieur le Prince; on lui reprochoit depuis toute sa vie qu’elle n’avoit point de cœur, mais seulement un gisier[124]; elle se trouva donc fort à son aise et en liberté, et n’en fit pas grandes façons.
Mme la duchesse d’Orléans me surprit. Je m’étois attendu à de la douleur; je n’aperçus que quelques larmes qui, sur tous sujets, lui couloient très aisément des yeux, et qui furent bientôt taries. Son lit, qu’elle aimoit fort, suppléa à tout pendant quelques jours, avec la façon de l’obscurité qu’elle ne haïssoit pas; mais bientôt les rideaux des fenêtres se rouvrirent, et il n’y parut plus qu’en rappelant de fois à autre quelque bienséance. Pour les princes du sang, c’étoient des enfants.
La duchesse de Ventadour[125] et le maréchal de Villeroy 88 donnèrent un peu la comédie; pas un autre n’en prit même la peine. Mais quelques vieux et plats courtisans, comme Dangeau[126], Cavoye[127], et un très petit nombre d’autres, qui se voyoient hors de toute mesure, quoique tombés d’une fort commune situation, regrettèrent de n’avoir plus à se cuider parmi les sots, les ignorants, les étrangers, dans les raisonnements et l’amusement journalier d’une cour qui s’éteignoit avec le Roi.
Tout ce qui la composoit étoit de deux sortes: les uns, en espérance de figurer, de se mêler, de s’introduire, étoient ravis de voir finir un règne sous lequel il n’y avoit rien pour eux à attendre; les autres, fatigués d’un joug pesant, toujours accablant, et des ministres bien plus que du Roi, étoient charmés de se trouver au large; tous, en général, d’être délivrés d’une gêne continuelle, et amoureux des nouveautés.
Paris, las d’une dépendance qui avoit tout assujetti, respira dans l’espoir de quelque liberté, et dans la joie de voir finir l’autorité de tant de gens qui en abusoient. Les provinces, au désespoir de leur ruine et de leur anéantissement, respirèrent et tressaillirent de joie, et les parlements et toute espèce de judicature, anéantie par les édits et par les évocations, se flatta, les premiers de figurer, les autres de se trouver affranchis. Le peuple, ruiné, accablé, désespéré, rendit grâces à Dieu, avec un éclat scandaleux, d’une délivrance dont ses plus ardents desirs ne doutoient plus.
Les étrangers, ravis d’être enfin, après un si long cours d’années, défaits d’un monarque qui leur avoit si longuement imposé la loi, et qui leur avoit échappé par une espèce de miracle au moment qu’ils comptoient le plus sûrement de l’avoir enfin subjugué, se continrent avec plus de bienséance que les François. Les merveilles des trois quarts premiers de ce règne de plus de soixante-dix 89 ans, et la personnelle magnanimité de ce roi jusqu’alors si heureux, et si abandonné après de la fortune pendant le dernier quart de son règne, les avoit justement éblouis. Ils se firent un honneur de lui rendre après sa mort ce qu’ils lui avoient constamment refusé pendant sa vie. Nulle cour étrangère n’exulta; tous se piquèrent de louer et d’honorer sa mémoire.
L’Empereur en prit le deuil comme d’un père; et quoique il y eût quatre ou cinq mois depuis la mort du Roi jusqu’au carnaval, toute espèce de divertissement fut défendu à Vienne, et observé exactement. Le monstrueux fut que, sur la fin du carnaval, il y eut un bal unique, avec une espèce de fête, que le comte du Luc, ambassadeur de France, n’eut pas honte de donner aux dames, qui le séduisirent par l’ennui d’un carnaval si triste. Cette complaisance ne le fit pas estimer à Vienne ni ailleurs; en France on se contenta de l’ignorer. Pour nos ministres et les intendants des provinces, les financiers, et ce qu’on peut appeler la canaille, ceux-là sentirent toute l’étendue de leur perte. Nous allons voir si le royaume eut tort ou raison des sentiments qu’il montra, et s’il trouva bientôt après qu’il eût gagné ou perdu.
Le samedi 11 juin, la cour retourna à Versailles, où en arrivant le Roi alla voir Madame, M. et Mme de Chartres, chacun dans leur appartement; elle, fort en peine de la situation où elle se trouvoit avec le Roi, dans une occasion où il y alloit du tout pour elle, et avoit engagé la duchesse de Ventadour de voir Mme de Maintenon. Elle le fit: Mme de Maintenon ne s’expliqua qu’en général, et dit seulement qu’elle iroit chez Madame au sortir de son dîner, et voulut que Mme de Ventadour[129] se trouvât chez Madame et fût en tiers pendant sa visite. C’étoit le dimanche[130], le lendemain du retour de Marly. Après les premiers compliments, ce qui étoit là sortit, excepté Mme de Ventadour. Alors Madame fit asseoir Mme de Maintenon, et il falloit pour cela qu’elle en sentît tout le besoin. Elle entra en matière sur l’indifférence avec laquelle le Roi l’avoit traitée pendant toute sa maladie, et Mme de Maintenon la laissa dire tout ce qu’elle voulut, puis lui répondit que le Roi lui avoit ordonné de lui dire que leur perte commune effaçoit tout dans son cœur, pourvu que dans la suite il eût lieu d’être plus content d’elle qu’il n’avoit eu depuis quelque temps, non-seulement sur ce qui regardoit ce qui s’étoit passé à l’égard de M. le duc de Chartres, mais sur d’autres choses encore plus intéressantes, dont il n’avoit pas voulu parler, et qui étoient la vraie cause de l’indifférence qu’il avoit voulu lui témoigner pendant qu’elle avoit été malade. A ce mot, Madame, qui se croyoit bien assurée, se récrie, proteste qu’excepté le fait de son fils elle n’a jamais rien dit ni fait qui pût déplaire, et enfile des plaintes et des justifications. Comme elle y insistoit le plus, Mme de Maintenon tire une lettre de sa poche et la lui montre, en lui demandant si elle en connoissoit l’écriture. C’étoit une 91 lettre de sa main à sa tante la duchesse d’Hanovre[131], à qui elle écrivoit tous les ordinaires, où, après des nouvelles de cour, elle lui disoit en propres termes qu’on ne savoit plus que dire du commerce du Roi et de Mme de Maintenon, si c’étoit mariage ou concubinage, et de là tomboit sur les affaires du dehors et sur celles du dedans, et s’étendoit sur la misère du royaume, qu’elle disoit ne s’en pouvoir relever. La poste l’avoit ouverte, comme elle les ouvroit et les ouvre encore presque toutes, et l’avoit trouvée trop forte pour se contenter, à l’ordinaire, d’en donner un extrait, et l’avoit envoyée au Roi en original. On peut penser si, à cet aspect et à cette lecture, Madame pensa mourir sur l’heure. La voilà à pleurer, et Mme de Maintenon à lui représenter modestement l’énormité de toutes les parties de cette lettre, et en pays étranger; enfin Mme de Ventadour à verbiager, pour laisser à Madame le temps de respirer et de se remettre assez pour dire quelque chose. Sa meilleure excuse fut l’aveu de ce qu’elle ne pouvoit nier, des pardons, des repentirs, des prières, des promesses.
Quand tout cela fut épuisé, Mme de Maintenon la supplia de trouver bon qu’après s’être acquittée de la commission que le Roi lui avoit donnée, elle pût aussi lui dire un mot d’elle-même, et lui faire ses plaintes de ce qu’après l’honneur qu’elle lui avoit fait autrefois de vouloir bien desirer son amitié et de lui jurer la sienne, elle avoit entièrement changé depuis plusieurs années. Madame crut avoir beau champ: elle répondit qu’elle étoit d’autant plus aise de cet éclaircissement, que c’étoit à elle à se plaindre du changement de Mme de Maintenon, qui tout d’un coup l’avoit laissée et abandonnée, et forcée de l’abandonner à la fin aussi, après avoir longtemps essayé de la faire vivre avec elle comme elles avoient vécu auparavant. A cette seconde reprise, Mme de Maintenon se donna le plaisir de la laisser enfiler comme à l’autre les plaintes, et de plus les regrets et les reproches: après quoi elle avoua à Madame qu’il étoit vrai que c’étoit elle qui la première s’étoit retirée d’elle, et qui n’avoit osé s’en rapprocher, que ses raisons étoient telles qu’elle n’avoit 92 pu moins que d’avoir cette conduite; et par ce propos fit redoubler les plaintes de Madame, et son empressement de savoir quelles pouvoient être ses raisons. Alors Mme de Maintenon lui dit que c’étoit un secret qui jusqu’alors n’étoit jamais sorti de sa bouche, quoique elle en fût en liberté depuis dix ans qu’étoit morte celle qui le lui avoit confié sur sa parole de n’en parler à personne; et de là raconte à Madame mille choses plus offensantes les unes que les autres qu’elle avoit dites d’elle à Madame la Dauphine, lorsqu’elle étoit mal avec cette dernière, qui dans leur raccommodement le lui avoit redit de mot à mot. A ce second coup de foudre, Madame demeura comme une statue. Il y eut quelques moments de silence. Mme de Ventadour fit son même personnage, pour laisser reprendre les esprits à Madame, qui ne sut faire que comme l’autre fois, c’est-à-dire qu’elle pleura, cria, et pour fin demanda pardon, avoua; puis repentirs et supplications. Mme de Maintenon triompha froidement d’elle assez longtemps, la laissant s’engouer de parler, de pleurer et lui prendre les mains. C’étoit une terrible humiliation pour une si rogue et fière Allemande. A la fin, Mme de Maintenon se laissa toucher, comme elle l’avoit bien résolu, après avoir pris toute sa vengeance. Elles s’embrassèrent, elles se promirent oubli parfait et amitié nouvelle; Mme de Ventadour se mit à en pleurer de joie, et le sceau de la réconciliation fut la promesse de celle du Roi, et qu’il ne lui dirait pas un mot des deux matières qu’elles venoient de traiter: ce qui, plus que tout, soulagea Madame. Tout se sait enfin dans les cours, et, si je me suis peut-être un peu étendu sur ces anecdotes, c’est que je les ai sues d’original et qu’elles m’ont paru très curieuses[132].
Il n’étoit question que de Compiègne[134], où soixante mille hommes venoient former un camp. Il en fut en ce genre comme du mariage de Mgr le duc de Bourgogne au sien; le Roi témoigna qu’il comptoit que les troupes seroient belles et que chacun s’y piqueroit d’émulation; c’en fut assez pour exciter une telle émulation, qu’on eut, après tout, lieu de s’en repentir. Non-seulement il n’y eut rien de si parfaitement beau que toutes les troupes, et toutes à tel point qu’on ne sut à quels corps en donner le prix; mais leurs commandants ajoutèrent à la beauté majestueuse et guerrière des hommes, des armes, des chevaux, les parures et la magnificence de la cour, et les officiers s’épuisèrent encore par des uniformes qui auroient pu orner des fêtes.
Les colonels, et jusqu’à beaucoup de simples capitaines, eurent des tables abondantes et délicates; six lieutenants généraux et quatorze maréchaux de camp employés s’y distinguèrent par une grande dépense; mais le maréchal de Boufflers étonna par sa dépense et par l’ordre surprenant d’une abondance et d’une recherche de goût, de magnificence et de politesse qui, dans l’ordinaire de la durée de tout le camp et à toutes les heures de la nuit et du jour, put apprendre au Roi même ce que c’étoit que donner une fête vraiment magnifique et superbe, et à Monsieur le Prince, dont l’art et le goût y surpassoit tout le monde, ce que c’étoit que l’élégance, le nouveau et l’exquis. Jamais spectacle si éclatant, si éblouissant, il le faut dire, 94 si effrayant, et en même temps rien de si tranquille que lui et toute sa maison dans ce traitement universel, de si sourd que tous les préparatifs, de si coulant de source que le prodige de l’exécution, de si simple, de si modeste, de si dégagé de tout soin que ce général, qui néanmoins avoit tout ordonné et ordonnoit sans cesse, tandis qu’il ne paroissoit occupé que des soins du commandement de cette armée. Les tables sans nombre, et toujours neuves, et à tous les moments servies à mesure qu’il se présentoit ou officiers, ou courtisans, ou spectateurs. Jusqu’aux bayeurs les plus inconnus, tout étoit retenu, invité, et comme forcé par l’attention, la civilité et la promptitude du nombre infini de ses officiers; et pareillement toutes sortes de liqueurs chaudes et froides, et tout ce qui peut être le plus vastement et le plus splendidement compris dans le genre des rafraîchissements, les vins françois, étrangers, ceux de liqueur les plus rares, y étoient comme abandonnés à profusion; et les mesures étoient si bien prises que l’abondance de gibier et de venaison arrivoit de tous côtés, et que les mers de Normandie, de Hollande, d’Angleterre, de Bretagne, et jusqu’à la Méditerranée, fournissoient tout ce qu’elles avoient de plus monstrueux et de plus exquis, à jours et point nommés, avec un ordre inimitable, et un nombre de courriers et de petites voitures de poste prodigieux. Enfin jusqu’à l’eau, qui fut soupçonnée de se troubler ou de s’épuiser par le grand nombre de bouches, arrivoit de Sainte-Reine, de la Seine et des sources les plus estimées. Et il n’est possible d’imaginer rien en aucun genre qui ne fût là sous la main, et pour le dernier survenant de paille[135] comme pour l’homme le plus principal et le plus attendu: des maisons de bois meublées comme les maisons de Paris les plus superbes, et tout en neuf et fait exprès, avec un goût et une galanterie singulière, et des tentes immenses, magnifiques, et dont le nombre pouvoit seul former un camp; les cuisines, les divers lieux, et les divers officiers pour cette suite sans interruption de tables et 95 pour tous leurs différents services, les sommelleries, les offices, tout cela formoit un spectacle dont l’ordre, le silence, l’exactitude, la diligence et la parfaite propreté ravissoit de surprise et d’admiration.
Ce voyage fut le premier où les dames traitèrent d’ancienne délicatesse ce qu’on n’eût osé leur proposer: il y en eut tant qui s’empressèrent à être du voyage, que le Roi lâcha la main et permit à celles qui voudroient de venir à Compiègne; mais ce n’étoit pas où elles tendoient: elles vouloient toutes être nommées, et la nécessité, non la liberté, du voyage, et c’est ce qui leur fit sauter le bâton[136] de s’entasser dans les carrosses des princesses. Jusqu’alors, tous les voyages que le Roi avoit faits, il avoit nommé des dames pour suivre la Reine ou Madame la Dauphine dans les carrosses de ces premières princesses; ce qu’on appela les princesses, qui étoient les bâtardes du Roi, avoient leurs amies et leur compagnie pour elles, qu’elles faisoient agréer au Roi, et qui alloient dans leurs carrosses à chacune, mais qui le trouvoient bon et qui marchoient sur ce pied-là. En ce voyage-ci, tout fut bon pourvu qu’on allât. Il n’y en eut aucune dans le carrosse du Roi que la duchesse du Lude[137] avec les princesses. Monsieur et Madame demeurèrent à Saint-Cloud et à Paris.
La cour en hommes fut extrêmement nombreuse, et tellement que pour la première fois à Compiègne, les ducs furent couplés. J’échus avec le duc de Rohan[138] dans une belle et grande maison du sieur Chambaudon, où nous fûmes, nous et nos gens, fort à notre aise. J’allai avec M. de la Trémoïlle[139] et le duc d’Albret[140], qui me reprochèrent 96 un peu que j’en avois fait une honnêteté à M. de Bouillon, qui en fut fort touché; mais je crus la devoir à ce qu’il étoit, et plus encore à l’amitié intime qui étoit entre lui et M. le maréchal de Lorges, et qui, en outre, étoient cousins germains.
Les ambassadeurs furent conviés d’aller à Compiègne. Le vieux Ferreiro, qui l’étoit de Savoie, leur mit dans la tête de prétendre le pour: il assura qu’il l’avoit eu autrefois à sa première ambassade en France; celui de Portugal allégua que Monsieur, le menant à Montargis, le lui avoit fait donner par ses maréchaux des logis, ce qui, disoit-il, ne s’étoit fait que sur l’exemple de ceux du Roi, et le nonce maintint que le nonce Cavallerini l’avoit eu avant d’être cardinal. Pomponne, Torcy, les introducteurs des ambassadeurs, Cavoye[141], protestèrent tous que cela ne pouvoit être, que jamais ambassadeur ne l’avoit prétendu, et il n’y en avoit pas un mot sur les registres; mais on a vu quelle foi les registres peuvent porter. Le fait étoit que les ambassadeurs sentirent l’envie que le Roi avoit de leur étaler la magnificence de ce camp, et qu’ils crurent en pouvoir profiter pour obtenir une chose nouvelle. Le Roi tint ferme; les allées et venues se poussèrent jusque dans les commencements du voyage, et ils finirent par n’y point aller. Le Roi en fut si piqué, que lui, si modéré et si silencieux, je lui entendis dire à son souper, à Compiègne, que s’il faisoit bien il les réduiroit à ne venir à la cour que par audiences comme il se pratiquoit partout ailleurs.
Le pour est une distinction dont j’ignore l’origine, mais qui en effet n’est qu’une sottise; elle consiste à écrire en craie sur les logis: “Pour Monsieur un tel,” ou simplement écrire: “Monsieur un tel.” Les maréchaux des logis, qui marquent ainsi tous les logements dans les voyages, mettent ce pour aux princes du sang, aux cardinaux et aux princes étrangers. M. de la Trémoïlle l’a aussi obtenu, et la duchesse de Bracciano, depuis princesse des Ursins[142]. Ce qui me fait appeler cette distinction une sottise, c’est 97 qu’elle n’emporte ni primauté ni préférence de logement: les cardinaux, les princes étrangers et les ducs sont logés également entre eux, sans distinction quelconque, qui est toute renfermée dans ce mot pour, et n’opère d’ailleurs quoi que ce soit. Ainsi ducs, princes étrangers, cardinaux sont logés sans autre différence entre eux après les charges du service nécessaire, après eux les maréchaux de France, ensuite les charges considérables, et puis le reste des courtisans. Cela est de même dans les places; mais quand le Roi est à l’armée, son quartier est partagé, et la cour est d’un côté et le militaire de l’autre, sans avoir rien de commun; et s’il se trouve à la suite du Roi des maréchaux de France sans commandement dans l’armée, ils ne laissent pas d’être logés du côté militaire et d’y avoir les premiers logements.
Le jeudi 28 août, la cour partit pour Compiègne; le Roi passa à Saint-Cloud, coucha à Chantilly, y demeura un jour, et arriva le samedi à Compiègne. Le quartier général étoit au village de Condun, où le maréchal de Boufflers[143] avoit des maisons outre ses tentes. Le Roi y mena Mgr le duc de Bourgogne et Mme la duchesse de Bourgogne, etc., qui y firent une collation magnifique, et qui y virent les ordonnances dont j’ai parlé ci-dessus avec tant de surprise, qu’au retour à Compiègne, le Roi dit à Livry[144], qui par son ordre avoit préparé des tables au camp pour Mgr le duc de Bourgogne, qu’il ne falloit point que ce prince en tînt; que quoi qu’il pût faire, ce ne serait rien en comparaison de ce qu’il venoit de voir, et que quand son petit-fils iroit à l’avenir au camp, il dîneroit chez le maréchal de Boufflers. Le Roi s’amusa fort à voir et à faire voir les troupes aux dames, leur arrivée, leur campement, leurs distributions, en un mot tous les détails d’un camp, des détachements, des marches, des fourrages, des exercices, de petits combats, des convois. Mme la duchesse de Bourgogne, les princesses, Monseigneur, firent souvent 98 collation chez le maréchal, où la maréchale de Boufflers leur faisoit les honneurs. Monseigneur y dîna quelquefois, et le Roi y mena dîner le roi d’Angleterre, qui vint passer trois ou quatre jours au camp. Il y avoit longues années que le Roi n’avoit fait cet honneur à personne, et la singularité de traiter deux rois ensemble fut grande. Monseigneur et les trois princes ses enfants y dînèrent aussi, et dix ou douze hommes des principaux de la cour et de l’armée. Le Roi pressa fort le maréchal de se mettre à table; il ne voulut jamais: il servit le Roi et le roi d’Angleterre, et le duc de Gramont[145], son beau-père, servit Monseigneur. Ils avoient vu, en y allant, les troupes à pied, à la tête de leurs camps; et en revenant, ils virent faire l’exercice à toute l’infanterie, les deux lignes face à face l’une de l’autre. La veille, le Roi avoit mené le roi d’Angleterre à la revue de l’armée. Mme la duchesse de Bourgogne la vit dans son carrosse; elle y avoit Madame la Duchesse[146], Mme la princesse de Conti[147] et toutes les dames titrées; deux autres de ses carrosses la suivirent, remplis de toutes les autres dames.
Il arriva sur cette revue une plaisante aventure au comte de Tessé[148]. Il étoit colonel général des dragons. M. de Lauzun lui demanda deux jours auparavant, avec cet air de bonté, de douceur et de simplicité qu’il prenoit presque toujours, s’il avoit songé à ce qu’il lui falloit pour saluer le Roi à la tête des dragons; et là-dessus entrèrent en récit du cheval, de l’habit et de l’équipage. Après les louanges: "Mais le chapeau, lui dit bonnement Lauzun, je ne vous en entends point parler!—Mais non, répondit l’autre; je compte d’avoir un bonnet.—Un bonnet! reprit Lauzun, mais y pensez-vous? un bonnet! cela est bon pour tous les autres, mais le colonel général avoir 99 un bonnet! Monsieur le comte, vous n’y pensez pas.—Comment donc? lui dit Tessé, qu’aurois-je donc?" Lauzun le fit danser, et se fit prier longtemps, en lui faisant accroire qu’il savoit mieux qu’il ne disoit. Enfin, vaincu par ses prières, il lui dit qu’il ne lui vouloit pas laisser commettre une si lourde faute; que cette charge ayant été créée pour lui, il en savoit bien toutes les distinctions, dont une des principales étoit, lorsque le Roi voyoit les dragons, d’avoir un chapeau gris. Tessé surpris avoue son ignorance, et dans l’effroi de la sottise où il seroit tombé sans cet avis si à propos, se répand en actions de grâces, et s’en va vite chez lui dépêcher un de ses gens à Paris pour lui rapporter un chapeau gris. Le duc de Lauzun avoit bien pris garde à tirer adroitement Tessé à part pour lui donner cette instruction, et qu’elle ne fût entendue de personne; il se doutoit bien que Tessé, dans la honte de son ignorance, ne s’en vanteroit à personne, et lui aussi se garda bien d’en parler.
Le matin de la revue, j’allai au lever du Roi, et contre sa coutume, j’y vis M. de Lauzun y demeurer, qui, avec ses grandes entrées, s’en alloit toujours quand les courtisans entroient. J’y vis aussi Tessé avec un chapeau gris, une plume noire et une grosse cocarde, qui piaffoit et se pavanoit de son chapeau. Cela, qui me parut extraordinaire, et la couleur du chapeau, que le Roi avoit en aversion et dont personne ne portoit plus depuis bien des années, me frappa et me le fit regarder, car il étoit presque vis-à-vis de moi, et M. de Lauzun assez près de lui, un peu en arrière. Le Roi, après s’être chaussé, et parlé à quelques-uns, avise enfin ce chapeau. Dans la surprise où il en fut, il demanda à Tessé où il [l’]avoit pris. L’autre, s’applaudissant, répondit qu’il lui étoit arrivé de Paris. "Et pourquoi faire? dit le Roi.—Sire, répondit l’autre, c’est que Votre Majesté nous fait l’honneur de nous voir aujourd’hui.—Eh bien! reprit le Roi, de plus en plus surpris; que fait cela pour un chapeau gris?—Sire, dit Tessé, que cette réponse commençoit à embarrasser, c’est que le privilège du colonel général est d’avoir ce jour-là 100 un chapeau gris.—Un chapeau gris! reprit le Roi, où diable avez-vous pris cela?—M. de Lauzun, Sire, pour qui vous avez créé la charge, qui me l’a dit": et à l’instant, le bon duc à pouffer de rire et s’éclipser. "Lauzun s’est moqué de vous, répondit le Roi un peu vivement: croyez-moi, envoyez tout à l’heure ce chapeau-là au général des Prémontrés[149]." Jamais je ne vis homme plus confondu que Tessé: il demeura les yeux baissés, et regardant ce chapeau avec une tristesse et une honte qui rendit la scène parfaite. Aucun des spectateurs ne se contraignit de rire, ni des plus familiers avec le Roi d’en dire son mot. Enfin Tessé reprit assez ses sens pour s’en aller; mais toute la cour lui en dit sa pensée, et lui demanda s’il ne connoissoit point encore M. de Lauzun, qui en rioit sous cape quand on lui en parloit. Avec tout cela, Tessé n’osa s’en fâcher, et la chose, quoique un peu forte, demeura en plaisanterie, dont Tessé fut longtemps tourmenté et bien honteux.
Presque tous les jours, les enfants de France dînoient chez le maréchal de Boufflers, quelquefois Mme la duchesse de Bourgogne, les princesses et les dames, mais très souvent des collations. La beauté et la profusion de la vaisselle pour fournir à tout, et toute marquée aux armes du maréchal, fut immense et incroyable; ce qui ne le fut pas moins, l’exactitude des heures et des moments de tout service partout: rien d’attendu, rien de languissant, pas plus pour les bayeurs du peuple, et jusqu’à des laquais, que pour les premiers seigneurs, à toutes heures et à tous venants. A quatre lieues autour de Compiègne, les villages et les fermes étoient remplis de monde, et François et étrangers, à ne pouvoir plus contenir personne; et cependant tout se passa sans désordre. Ce qu’il y avoit de gentilshommes et de valets de chambre chez le maréchal étoit un monde, tous plus polis et plus attentifs les uns que les autres à leurs fonctions de retenir tout ce qui paroissoit, et les faire servir depuis cinq heures du matin 101 jusqu’à dix et onze heures du soir, sans cesse et à mesure, et à faire les honneurs, et une livrée prodigieuse avec grand nombre de pages. J’y reviens malgré moi, parce que quiconque l’a vu ne le peut oublier ni cesser d’en être dans l’admiration et l’étonnement, et de l’abondance, et de la somptuosité, et de l’ordre, qui ne se démentit jamais d’un seul moment ni d’un seul point.
Le Roi voulut montrer des images de tout ce qui se fait à la guerre; on fit donc le siège de Compiègne dans les formes, mais fort abrégées: lignes, tranchées, batteries, sapes, etc. Crenan défendoit la place. Un ancien rempart tournoit du côté de la campagne autour du château; il étoit de plain-pied à l’appartement du Roi, et par conséquent élevé, et dominoit toute la campagne. Il y avoit au pied une vieille muraille et un moulin à vent, un peu au delà de l’appartement du Roi, sur le rempart, qui n’avoit ni banquette ni mur d’appui. Le samedi 13 septembre fut destiné à l’assaut: le Roi, suivi de toutes les dames, et par le plus beau temps du monde, alla sur ce rempart; force courtisans, et tout ce qu’il y avoit d’étrangers considérables. De là, on découvroit toute la plaine et la disposition de toutes les troupes. J’étois dans le demi-cercle, fort près du Roi, à trois pas au plus, et personne devant moi. C’étoit le plus beau coup d’œil qu’on pût imaginer que toute cette armée, et ce nombre prodigieux de curieux de toutes conditions, à cheval et à pied, à distance des troupes pour ne les point embarrasser, et ce jeu des attaquants et des défendants à découvert, parce que, n’y ayant rien de sérieux que la montre et qu’il n’y avoit de précaution à prendre pour les uns et les autres que la justesse des mouvements[150]. Mais un spectacle d’une autre sorte, et que je peindrois dans quarante ans comme aujourd’hui, tant il me frappa, fut celui que, du haut de ce rempart, le Roi donna à toute son armée et à cette innombrable foule d’assistants de tous états, tant dans la plaine que dessus le rempart même.
Mme de Maintenon y étoit en face de la plaine et des 102 troupes, dans sa chaise à porteurs, entre ses trois glaces, et ses porteurs retirés. Sur le bâton de devant, à gauche, étoit assise Mme la duchesse de Bourgogne; du même côté, en arrière et en demi-cercle, debout, Madame la Duchesse, Mme la princesse de Conti et toutes les dames, et derrière elles des hommes; à la glace droite de la chaise, le Roi debout, et, un peu en arrière, un demi-cercle de ce qu’il y avoit en hommes de plus distingué. Le Roi étoit presque toujours découvert, et à tous moments se baissoit dans la glace pour parler à Mme de Maintenon, pour lui expliquer tout ce qu’elle voyoit et les raisons de chaque chose. A chaque fois, elle avoit l’honnêteté d’ouvrir sa glace de quatre ou cinq doigts, jamais de la moitié, car j’y pris garde, et j’avoue que je fus plus attentif à ce spectacle qu’à celui des troupes. Quelquefois elle ouvrait pour quelque question au Roi; mais presque toujours c’étoit lui qui, sans attendre qu’elle lui parlât, se baissoit tout à fait pour l’instruire, et quelquefois qu’elle n’y prenoit pas garde, il frappoit contre la glace pour la faire ouvrir. Jamais il ne parla qu’à elle, hors pour donner des ordres en peu de mots et rarement, et quelques réponses à Mme la duchesse de Bourgogne, qui tâchoit de se faire parler, et à qui Mme de Maintenon montrait et parloit par signes de temps en temps, sans ouvrir la glace de devant, à travers laquelle la jeune princesse lui crioit quelque mot. J’examinois fort les contenances: toutes marquoient une surprise honteuse, timide, dérobée, et tout ce qui étoit derrière la chaise et les demi-cercles avoient plus les yeux sur elle que sur l’armée, et tout dans un respect de crainte et d’embarras. Le Roi mit souvent son chapeau sur le haut de la chaise, pour parler dedans, et cet exercice si continuel lui devoit fort lasser les reins. Monseigneur étoit à cheval dans la plaine, avec les princes ses cadets, et Mgr le duc de Bourgogne, comme à tous les autres mouvements de l’armée, avec le maréchal de Boufflers, en fonction de général. C’étoit sur les cinq heures de l’après-dînée, par le plus beau temps du monde et le plus à souhait.
103 Il y avoit, vis-à-vis la chaise à porteurs, un sentier taillé en marches roides, qu’on ne voyoit point d’en haut, et une ouverture au bout, qu’on avoit faite dans cette vieille muraille pour pouvoir aller prendre les ordres du Roi d’en bas, s’il en étoit besoin. Le cas arriva: Crenan envoya Canillac[151], colonel de Rouergue, qui étoit un des régiments qui défendoient, pour prendre l’ordre du Roi sur je ne sais quoi. Canillac se met à monter, et dépasse jusqu’un peu plus que les épaules: je le vois d’ici aussi distinctement qu’alors. A mesure que la tête dépassoit, il avisoit cette chaise, le Roi et toute cette assistance, qu’il n’avoit point vue ni imaginée, parce que son poste étoit en bas, au pied du rempart, d’où on ne pouvoit découvrir ce qui étoit dessus. Ce spectacle le frappa d’un tel étonnement qu’il demeura court à regarder, la bouche ouverte, les yeux fixes, et le visage sur lequel le plus grand étonnement étoit peint. Il n’y eut personne qui ne le remarquât, et le Roi le vit si bien qu’il lui dit avec émotion: “Eh bien! Canillac, montez donc.” Canillac demeuroit; le Roi reprit: “Montez donc; qu’est[-ce] qu’il y a?” Il acheva donc de monter, et vint au Roi à pas lents, tremblants, et passant les yeux à droite et à gauche, avec un air éperdu. Je l’ai déjà dit: j’étois à trois pas du Roi; Canillac passa devant moi, et balbutia fort bas quelque chose. “Comment dites-vous? dit le Roi; mais parlez donc.” Jamais il ne put se remettre. Il tira de soi ce qu’il put. Le Roi, qui n’y comprit pas grand’chose, vit bien qu’il n’en tireroit rien de mieux, répondit aussi ce qu’il put, et ajouta d’un air chagrin: “Allez, Monsieur.” Canillac ne se le fit pas dire deux fois, et regagna son escalier, et disparut. A peine étoit-il dedans, que le Roi, regardant autour de lui: “Je ne sais pas ce qu’a Canillac, dit-il, mais il a perdu la tramontane, et n’a plus su ce qu’il me vouloit dire.” Personne ne répondit.
Vers le moment de la capitulation, Mme de Maintenon apparemment demanda permission de s’en aller; le Roi 104 le cria: “Les porteurs de Madame!” Ils vinrent et l’emportèrent. Moins d’un quart d’heure après, le Roi se retira, suivi de Mme la duchesse de Bourgogne et de presque tout ce qui étoit là. Plusieurs se parlèrent des yeux et du coude en se retirant, et puis à l’oreille bien bas: on ne pouvoit revenir de ce qu’on venoit de voir. Ce fut le même effet parmi tout ce qui étoit dans la plaine: jusqu’aux soldats demandoient ce que c’étoit que cette chaise à porteurs et le Roi à tous moments baissé dedans; il fallut doucement faire taire les officiers et les questions des troupes. On peut juger de ce qu’en dirent les étrangers, et de l’effet que fit sur eux un tel spectacle. Il fit du bruit par toute l’Europe, et y fut aussi répandu que le camp même de Compiègne avec toute sa pompe et sa prodigieuse splendeur. Du reste, Mme de Maintenon se produisit fort peu au camp, et toujours dans son carrosse avec trois ou quatre familières, et alla voir une fois ou deux le maréchal de Boufflers et les merveilles du prodige de sa magnificence.
Le dernier grand acte de cette scène fut l’image d’une bataille entre la première et la seconde ligne entières, l’une contre l’autre. M. Rosen[152], le premier des lieutenants généraux du camp, la commanda ce jour-là contre le maréchal de Boufflers, auprès duquel étoit Mgr le duc de Bourgogne comme le général. Le Roi, Mme la duchesse de Bourgogne, les princes, les dames, toute la cour et un monde de curieux assistèrent à ce spectacle, le Roi et tous les hommes à cheval, les dames en carrosse. L’exécution en fut parfaite en toutes ses parties et dura longtemps. Mais quand ce fut à la seconde ligne à ployer et à faire retraite, Rosen ne s’y pouvoit résoudre, et c’est ce qui allongea fort l’action. M. de Boufflers lui manda plusieurs fois, de la part de Mgr le duc de Bourgogne, qu’il étoit temps. Rosen entroit en colère, et n’obéissoit point. Le Roi en rit fort, qui avoit tout réglé, et qui voyoit aller et venir les aides de camp et la longueur de tout ce manège, 105 et dit: “Rosen n’aime point à faire le personnage de battu.” A la fin il lui manda lui-même de finir et de se retirer. Rosen obéit, mais fort mal volontiers, et brusqua un peu le porteur d’ordre. Ce fut la conversation du retour et de tout le soir.
Enfin, après des attaques de retranchements, et toutes sortes d’images de ce qui se fait à la guerre, et des revues infinies, le Roi partit de Compiègne le lundi 22 septembre, et s’en alla avec sa même carrossée à Chantilly, y demeura le mardi, et arriva le mercredi à Versailles, avec autant de joie de toutes les dames qu’elles avoient eu d’empressement à être du voyage: elles ne mangèrent point avec le Roi à Compiègne, et y virent Mme la duchesse de Bourgogne aussi peu qu’à Versailles; il falloit aller au camp tous les jours, et la fatigue leur parut plus grande que le plaisir, et encore plus que la distinction qu’elles s’en étoient proposée. Le Roi, extrêmement content de la beauté des troupes, qui toutes avoient habillé, et avec tous les ornements que leurs chefs avoient pu imaginer, fit donner en partant six cents francs de gratification à chaque capitaine de cavalerie et de dragons, et trois cents francs à chaque capitaine d’infanterie; il en fit donner autant aux majors de tous les régiments, et distribua quelques grâces dans sa maison. Il fit au maréchal de Boufflers un présent de cent mille francs. Tout cela ensemble coûta beaucoup; mais, pour chacun, ce fut une goutte d’eau. Il n’y eut point de régiment qui n’en fût ruiné pour bien des années, corps et officiers, et, pour le maréchal de Boufflers, je laisse à penser ce que ce fut que cent mille francs à la magnificence, incroyable à qui l’a vue, dont il épouvanta toute l’Europe par les relations des étrangers qui en furent témoins, et qui, tous les jours, n’en pouvoient croire leurs yeux.
Ce prince, allant, comme je l’ai dit, à Meudon[154] le lendemain des fêtes de Pâques, rencontra à Chaville un prêtre qui portoit Notre-Seigneur à un malade, et mit pied à terre pour l’adorer à genoux avec Mme la duchesse de Bourgogne. Il demanda à quel malade on le portoit: il apprit que ce malade avoit la petite vérole. Il y en avoit partout quantité. Il ne l’avoit eue que légère, volante, et enfant; il la craignoit fort. Il en fut frappé, et dit le soir à Boudin, son premier médecin, qu’il ne seroit pas surpris s’il l’avoit. La journée s’étoit cependant passée tout à fait à l’ordinaire.
Il se leva le lendemain jeudi 9, pour aller courre le loup; mais en s’habillant il lui prit une foiblesse qui le fit tomber dans sa chaise. Boudin le fit remettre au lit. Toute la journée fut effrayante par l’état du pouls. Le Roi, qui en fut foiblement averti par Fagon[155], crut que ce n’étoit rien, et s’alla promener à Marly après son dîner, où il eut plusieurs fois des nouvelles de Meudon. Mgr et Mme la duchesse de Bourgogne y dînèrent, et ne voulurent pas quitter Monseigneur d’un moment. La princesse ajouta aux devoirs de belle-fille toutes les grâces qui étoient en elle, et présenta tout de sa main à Monseigneur. Le cœur ne pouvoit pas être troublé de ce que l’esprit lui faisoit envisager comme possible; mais les soins et l’empressement n’en furent pas moins marqués, sans air d’affectation ni de comédie. Mgr le duc de Bourgogne, tout simple, tout saint, tout plein de ses devoirs, les remplit outre mesure; et quoique il y eût déjà un grand soupçon de petite vérole, 107 et que ce prince ne l’eût jamais eue, ils ne voulurent pas s’éloigner un moment de Monseigneur, et ne le quittèrent que pour le souper du Roi.
A leur récit, le Roi envoya le lendemain matin, vendredi 10, des ordres si précis à Meudon qu’il apprit à son réveil le grand péril où on trouvoit Monseigneur. Il avoit dit la veille, en revenant de Marly, qu’il iroit le lendemain matin à Meudon, pour y demeurer pendant toute la maladie de Monseigneur, de quelque nature qu’elle pût être; et en effet il s’y en alla au sortir de la messe. En partant, il défendit à ses enfants d’y aller; il le défendit en général à quiconque n’avoit pas eu la petite vérole, avec une réflexion de bonté, et permit à tous ceux qui l’avoient eue de lui faire leur cour à Meudon, ou de n’y aller pas, suivant le degré de leur peur ou de leur convenance.
Du Mont[156] renvoya plusieurs de ceux qui étoient de ce voyage de Meudon, pour y loger la suite du Roi, qu’il borna à son service le plus étroit, et à ses ministres, excepté le Chancelier, qui n’y coucha pas, pour y travailler avec eux. Madame la Duchesse[157] et Mme la princesse de Conti[158], chacune uniquement avec sa dame d’honneur, Mlle de Lislebonne, Mme d’Espinoy et Mlle de Melun[159], comme si particulièrement attachées à Monseigneur, et Mlle de Bouillon, parce qu’elle ne quittoit point son père, qui suivit comme grand chambellan[160], y avoient devancé le Roi, et furent les seules dames qui y demeurèrent, et qui mangèrent les soirs avec le Roi, qui dîna seul comme à Marly. Je ne parle point de Mlle Choin[161], qui y dîna dès le 108 mercredi, ni de Mme de Maintenon, qui vint trouver le Roi après dîner avec Mme la duchesse de Bourgogne. Le Roi ne voulut point qu’elle approchât de l’appartement de Monseigneur, et la renvoya assez promptement. C’est où en étoient les choses lorsque Mme de Saint-Simon m’envoya le courrier, les médecins souhaitant la petite vérole, dont on étoit persuadé, quoique elle ne fût pas encore déclarée.
Je continuerai à parler de moi avec la même vérité dont [je] traite les autres et les choses, avec toute l’exactitude qui m’est possible. A la situation où j’étois à l’égard de Monseigneur et de son intime cour, on sentira aisément quelle impression je reçus de cette nouvelle[162]: je compris, par ce qui m’étoit mandé de l’état de Monseigneur, que la chose en bien ou en mal seroit promptement décidée; je me trouvois fort à mon aise à la Ferté[163]: je résolus d’y attendre des nouvelles de la journée; je renvoyai un courrier à Mme de Saint-Simon, et je lui en demandai un pour le lendemain. Je passai la journée dans un mouvement vague et de flux et de reflux qui gagne et qui perd du terrain, tenant l’homme et le chrétien en garde contre l’homme et le courtisan, avec cette foule de choses et d’objets qui se présentoient à moi dans une conjoncture si critique, qui me faisoit entrevoir une délivrance inespérée, subite, sous les plus agréables apparences pour les suites.
Le courrier que j’attendois impatiemment arriva le lendemain, dimanche de Quasimodo[164], de bonne heure dans l’après-dînée. J’appris par lui que la petite vérole étoit déclarée, et alloit aussi bien qu’on le pouvoit souhaiter, et je le crus d’autant mieux que j’appris que la veille, qui étoit celle du dimanche de Quasimodo, Mme de Maintenon, qui à Meudon ne sortoit point de sa chambre, et 109 qui y avoit Mme de Dangeau[165] pour toute compagnie, avec qui elle mangeoit, étoit allée dès le matin à Versailles, y avoit dîné chez Mme de Caylus[166], où elle avoit vu Mme la duchesse de Bourgogne, et n’étoit pas retournée de fort bonne heure à Meudon.
Je crus Monseigneur sauvé, et voulus demeurer chez moi; néanmoins je crus conseil, comme j’ai fait toute ma vie, et m’en suis toujours bien trouvé: je donnai ordre à regret pour mon départ le lendemain, qui étoit celui de la Quasimodo, 13 avril, et je partis en effet de bon matin. Arrivant à la Queue, à quatorze lieues de la Ferté et à six de Versailles, un financier qui s’appeloit la Fontaine, et que je connoissois fort pour l’avoir vu toute ma vie à la Ferté, chargé de Senonches et des autres biens de feu Monsieur le Prince de ce voisinage, aborda ma chaise comme je relayois; il venoit de Paris et de Versailles, où il avoit vu des gens de Madame la Duchesse: il me dit Monseigneur le mieux du monde, et avec des détails qui le faisoient compter hors de danger. J’arrivai à Versailles rempli de cette opinion, qui me fut confirmée par Mme de Saint-Simon et tout ce que je vis de gens, en sorte qu’on ne craignoit plus que par la nature traîtresse de cette sorte de maladie dans un homme de cinquante ans fort épais.
Le Roi tenoit son Conseil et travailloit le soir avec ses ministres, comme à l’ordinaire. Il voyoit Monseigneur les matins et les soirs, et plusieurs fois l’après-dînée, et toujours longtemps dans la ruelle de son lit. Ce lundi que j’arrivai, il avoit dîné de bonne heure, et s’étoit allé promener à Marly, où Mme la duchesse de Bourgogne l’alla trouver. Il vit en passant au bord des jardins de Versailles Messeigneurs ses petits-fils, qui étoient venus l’y attendre, mais qu’il ne laissa pas approcher, et leur cria bonjour. Mme la duchesse de Bourgogne avoit eu la petite vérole; mais il n’y paroissoit point.
Le Roi ne se plaisoit que dans ses maisons, et n’aimoit point à être ailleurs. C’est par ce goût que ses voyages à 110 Meudon étoient rares et courts, et de pure complaisance. Mme de Maintenon s’y trouvoit encore plus déplacée. Quoique sa chambre fût partout un sanctuaire où il n’entroit que des femmes de la plus étroite privance, il lui falloit partout une autre retraite entièrement inaccessible, sinon à Mme la duchesse de Bourgogne, encore pour des instants, et seule. Ainsi, elle avoit Saint-Cyr pour Versailles et pour Marly, et à Marly encore ce Repos dont j’ai parlé ailleurs; à Fontainebleau sa maison à la ville. Voyant donc Monseigneur si bien, et conséquemment un long séjour à Meudon, les tapissiers du Roi eurent ordre de meubler Chaville, maison du feu chancelier le Tellier, que Monseigneur avait achetée et mise dans le parc de Meudon; et ce fut à Chaville où Mme de Maintenon destina ses retraites pendant la journée.
Le Roi avoit commandé la revue des gens d’armes et des chevau-légers pour le mercredi: tellement que tout sembloit aller à souhait. J’écrivis en arrivant à Versailles à M. de Beauvillier[167], à Meudon, pour le prier de dire au Roi que j’étois revenu sur la maladie de Monseigneur, et que je serois allé à Meudon, si, n’ayant pas eu la petite vérole, je ne me trouvois dans le cas de la défense. Il s’en acquitta, me manda que mon retour avoit été fort à propos, et me réitéra de la part du Roi la défense d’aller à Meudon, tant pour moi que pour Mme de Saint-Simon, qui n’avoit point eu non plus la petite vérole. Cette défense particulière ne m’affligea point du tout. Mme la duchesse de Berry, qui l’avoit eue, n’eut point le privilège de voir le Roi, comme Mme la duchesse de Bourgogne: leurs deux époux ne l’avoient point eue. La même raison exclut M. le duc d’Orléans de voir le Roi; mais Mme la duchesse d’Orléans, qui n’étoit pas dans le même cas, eut permission de l’aller voir, dont elle usa pourtant fort sobrement. Madame ne le vit point, quoique il n’y eût point pour elle de raison d’exclusion, qui, excepté les deux fils de France, par juste crainte pour eux, ne s’étendit dans la famille royale que selon le goût du Roi.
111 Meudon, pris en soi, avoit aussi ses contrastes: la Choin y étoit dans son grenier; Madame la Duchesse, Mlle de Lislebonne et Mme d’Espinoy ne bougeoient de la chambre de Monseigneur, et la recluse n’y entroit que lorsque le Roi n’y étoit pas, et que Mme la princesse de Conti, qui y étoit aussi fort assidue, étoit retirée. Cette princesse sentit bien qu’elle contraindrait cruellement Monseigneur, si elle ne le mettoit en liberté là-dessus, et elle le fit de fort bonne grâce: dès le matin du jour que le Roi arriva, et elle y avoit déjà couché, elle dit à Monseigneur qu’il y avoit longtemps qu’elle n’ignorait pas ce qui étoit dans Meudon, qu’elle n’avoit pu vivre hors de ce château dans l’inquiétude où elle étoit, mais qu’il n’étoit pas juste que son amitié fût importune; qu’elle le prioit d’en user très librement, de la renvoyer toutes les fois que cela lui conviendrait, et qu’elle auroit soin, de son côté, de n’entrer jamais dans sa chambre sans savoir si elle pouvoit le voir sans l’embarrasser. Ce compliment plut infiniment à Monseigneur. La princesse fut en effet fidèle à cette conduite, et docile aux avis de Madame la Duchesse et des deux Lorraines pour sortir quand il étoit à propos, sans air de chagrin ni de contrainte, et revenoit après, quand cela se pouvoit, sans la plus légère humeur, en quoi elle mérita de vraies louanges.
C’étoit Mlle Choin dont il étoit question, qui figurait à Meudon, avec le P. Tellier[168], d’une façon tout à fait étrange. Tous deux incognito, relégués chacun dans leur grenier, servis seuls chacun dans leur chambre, vus des seuls indispensables, et sus pourtant de chacun, avec cette différence que la demoiselle voyoit Monseigneur nuit et jour, sans mettre le pied ailleurs, et que le confesseur alloit chez le Roi et partout, excepté dans l’appartement 112 de Monseigneur ni dans tout ce qui en approchoit. Mme d’Espinoy portoit et rapportoit les compliments entre Mme de Maintenon et Mlle Choin. Le Roi ne la vit point. Il croyoit que Mme de Maintenon l’avoit vue: il le lui demanda un peu sur le tard; il sut que non, et il ne l’approuva pas. Là-dessus Mme de Maintenon chargea Mme d’Espinoy d’en faire ses excuses à Mlle Choin, et de lui dire qu’elle espéroit qu’elles se verraient: compliment bizarre d’une chambre à l’autre, sous le même toit. Elles ne se virent jamais depuis.
Versailles présentoit une autre scène: Mgr et Mme la duchesse de Bourgogne y tenoient ouvertement la cour, et cette cour ressembloit à la première pointe de l’aurore. Toute la cour étoit là rassemblée; tout Paris y abondoit, et comme la discrétion et la précaution ne furent jamais françoises, tout Meudon y venoit, et on en croyoit les gens sur leur parole de n’être pas entrés chez Monseigneur ce jour-là. Lever et coucher, dîner et souper avec les dames, conversations publiques après les repas, promenades, étoient les heures de faire sa cour, et les appartements ne pouvoient contenir la foule; courriers à tous quarts d’heure, qui rappeloient l’attention aux nouvelles de Monseigneur, cours de maladie à souhait, et facilité extrême d’espérance et de confiance; desir et empressement de tous de plaire à la nouvelle cour; majesté et gravité gaie dans le jeune prince et la jeune princesse, accueil obligeant à tous, attention continuelle à parler à chacun, et complaisance dans cette foule, satisfaction réciproque; duc et duchesse de Berry à peu près nuls. De cette sorte s’écoulèrent cinq jours, chacun pensant sans cesse aux futurs contingents, tâchant d’avance de s’accommoder à tout événement.
Le mardi 14 avril, lendemain de mon retour de la Ferté à Versailles, le Roi, qui, comme j’ai dit, s’ennuyoit à Meudon, donna à l’ordinaire conseil des finances le matin, et, contre sa coutume, conseil de dépêches l’après-dînée, pour en remplir le vide. J’allai voir le Chancelier à son retour de ce dernier conseil, et je m’informai beaucoup 113 à lui de l’état de Monseigneur. Il me l’assura bon, et me dit que Fagon lui avoit dit ces mêmes mots: que les choses alloient selon leurs souhaits, et au delà de leurs espérances. Le Chancelier me parut dans une grande confiance, et j’y ajoutai foi d’autant plus aisément qu’il étoit extrêmement bien avec Monseigneur, et qu’il ne bannissoit pas toute crainte, mais sans en avoir d’autre que celle de la nature propre à cette sorte de maladie.
Les harengères de Paris, amies fidèles de Monseigneur, qui s’étoient déjà signalées à cette forte indigestion qui fut prise pour apoplexie, donnèrent ici le second tome de leur zèle. Ce même matin, elles arrivèrent en plusieurs carrosses de louage à Meudon. Monseigneur les voulut voir: elles se jetèrent au pied de son lit, qu’elles baisèrent plusieurs fois, et ravies d’apprendre de si bonnes nouvelles, elles s’écrièrent dans leur joie qu’elles alloient réjouir tout Paris et faire chanter le Te Deum. Monseigneur, qui n’étoit pas insensible à ces marques d’amour du peuple, leur dit qu’il n’étoit pas encore temps, et après les avoir remerciées, il ordonna qu’on leur fît voir sa maison, qu’on les traitât à dîner, et qu’on les renvoyât avec de l’argent.
Revenant chez moi, de chez le Chancelier, par les cours, je vis Mme la duchesse d’Orléans se promenant sur la terrasse de l’aile Neuve, qui m’appela, et que je ne fis semblant de voir ni d’entendre, parce que la Montauban étoit avec elle, et je gagnai mon appartement l’esprit fort rempli de ces bonnes nouvelles de Meudon. Ce logement étoit dans la galerie haute de l’aile Neuve, qu’il n’y avoit presque qu’à traverser pour être dans l’appartement de M. et de Mme la duchesse de Berry, qui ce soir-là devoient donner à souper chez eux à M. et à Mme la duchesse d’Orléans et à quelques dames, dont Mme de Saint-Simon se dispensa sur ce qu’elle avoit été un peu incommodée.
Il y avoit peu que j’étois dans mon cabinet seul avec Coëttenfao, qu’on m’annonça Mme la duchesse d’Orléans, qui venoit causer en attendant l’heure du souper. J’allai 114 la recevoir dans l’appartement de Mme de Saint-Simon, qui étoit sortie, et qui revint bientôt après se mettre en tiers avec nous. La princesse et moi étions, comme on dit, gros de nous voir et de nous entretenir dans cette conjoncture, sur laquelle elle et moi nous pensions si pareillement. Il n’y avoit guère qu’une heure qu’elle étoit revenue de Meudon, où elle avoit vu le Roi, et il en étoit alors huit du soir de ce même mardi 14 avril.
Elle me dit la même expression dont Fagon s’étoit servi, que j’avois apprise du Chancelier; elle me rendit la confiance qui régnoit dans Meudon; elle me vanta les soins et la capacité des médecins, qui ne négligeoient pas jusqu’aux plus petits remèdes qu’ils ont coutume de mépriser le plus; elle nous en exagéra le succès; et pour en parler franchement et en avouer la honte, elle et moi nous lamentâmes ensemble de voir Monseigneur échapper, à son âge et à sa graisse, d’un mal si dangereux. Elle réfléchissoit tristement, mais avec ce sel et ces tons à la Mortemart[169], qu’après une dépuration de cette sorte il ne restoit plus la moindre pauvre petite espérance aux apoplexies, que celle des indigestions étoit ruinée sans ressource depuis la peur que Monseigneur en avoit prise et l’empire qu’il avoit donné sur sa santé aux médecins; et nous conclûmes plus que langoureusement qu’il falloit désormais compter que ce prince vivroit et régneroit longtemps: de là, des raisonnements sans fin sur les funestes accompagnements de son règne, sur la vanité des apparences les mieux fondées d’une vie qui promettoit si peu, et qui trouvoit son salut et sa durée au sein du péril et de la mort. En un mot, nous nous lâchâmes, non sans quelque scrupule qui interrompoit de fois à autre cette rare conversation, mais qu’avec un tour languissamment plaisant elle ramenoit toujours à son point. Mme de Saint-Simon, tout dévotement, enrayoit tant qu’elle pouvoit ces propos étranges; mais l’enrayure cassoit, et entretenoit ainsi un combat très singulier entre la liberté 115 des sentiments humainement pour nous très raisonnables, mais qui ne laissoit pas de nous faire sentir qu'ils n’étoient pas selon la religion.
Deux heures s’écoulèrent de la sorte entre nous trois, qui nous parurent courtes, mais que l’heure du souper termina. Mme la duchesse d’Orléans s’en alla chez Madame sa fille, et nous passâmes dans ma chambre, où bonne compagnie s’étoit cependant assemblée, qui soupa avec nous.
Tandis qu’on étoit si tranquille à Versailles, et même à Meudon, tout y changeoit de face. Le Roi avoit vu Monseigneur plusieurs fois dans la journée, qui étoit sensible à ces marques d’amitié et de considération. Dans la visite de l’après-dînée, avant le conseil des dépêches, le Roi fut si frappé de l’enflure extraordinaire du visage et de la tête, qu’il abrégea, et qu’il laissa échapper quelques larmes en sortant de la chambre. On le rassura tant qu’on put, et, après le conseil des dépêches, il se promena dans les jardins.
Cependant Monseigneur avoit déjà méconnu Mme la princesse de Conti, et Boudin en avoit été alarmé. Ce prince l’avoit toujours été. Les courtisans le voyoient tous les uns après les autres; les plus familiers n’en bougeoient jour et nuit. Il s’informoit sans cesse à eux si on avoit coutume d’être, dans cette maladie, dans l’état où il se sentoit. Dans les temps où ce qu’on lui disoit pour le rassurer lui faisoit le plus d’impression, il fondoit sur cette dépuration des espérances de vie et de santé, et en une de ces occasions, il lui échappa d’avouer à Mme la princesse de Conti qu’il y avoit longtemps qu’il se sentoit fort mal sans en avoir voulu rien témoigner, et dans un tel état de foiblesse que, le jeudi saint dernier, il n’avoit pu durant l’office tenir sa Semaine sainte dans ses mains.
Il se trouva plus mal vers quatre heures après midi, pendant le conseil des dépêches: tellement que Boudin proposa à Fagon d’envoyer querir du conseil, lui représenta qu’eux, médecins de la cour, qui ne voyoient jamais aucune maladie de venin, n’en pouvoient avoir d’expérience, et le pressa de mander promptement des médecins 116 de Paris; mais Fagon se mit en colère, ne se paya d’aucunes raisons, s’opiniâtra au refus d’appeler personne, à dire qu’il étoit inutile de se commettre à des disputes et à des contrariétés, soutint qu’ils feroient aussi bien et mieux que tout le secours qu’ils pourroient faire venir, voulut enfin tenir secret l’état de Monseigneur, quoique il empirât d’heure en heure, et que sur les sept heures du soir quelques valets et quelques courtisans même commençassent à s’en apercevoir; mais tout en ce genre trembloit sous Fagon: il étoit là, et personne n’osoit ouvrir la bouche pour avertir le Roi ni Mme de Maintenon. Madame la Duchesse et Mme la princesse de Conti, dans la même impuissance, cherchoient à se rassurer. Le rare fut qu’on voulut laisser mettre le Roi à table pour souper, avant d’effrayer par de grands remèdes, et laisser achever son souper sans l’interrompre et sans l’avertir de rien, qui, sur la foi de Fagon et le silence public, croyoit Monseigneur en bon état, quoique il l’eût trouvé enflé et changé dans l’après-dînée, et qu’il en eût été fort peiné.
Pendant que le Roi soupoit ainsi tranquillement, la tête commença à tourner à ceux qui étoient dans la chambre de Monseigneur. Fagon et les autres entassèrent remèdes sur remèdes, sans en attendre l’effet. Le curé, qui tous les soirs avant de se retirer chez lui alloit savoir des nouvelles, trouva, contre l’ordinaire, toutes les portes ouvertes, et les valets éperdus. Il entra dans la chambre, où voyant de quoi il n’étoit que trop tardivement question, il courut au lit, prit la main de Monseigneur, lui parla de Dieu, et le voyant plein de connoissance, mais presque hors d’état de parler, il en tira ce qu’il put pour une confession, dont qui que ce soit ne s’étoit avisé, lui suggéra des actes de contrition. Le pauvre prince en répéta distinctement quelques mots, confusément les autres, se frappa la poitrine, serra la main au curé, parut pénétré des meilleurs sentiments, et reçut d’un air contrit et desireux l’absolution du curé.
Cependant le Roi sortoit de table, et pensa tomber à la renverse lorsque Fagon, se présentant à lui, lui cria 117 tout troublé, que tout étoit perdu. On peut juger quelle horreur saisit tout le monde en ce passage si subit d’une sécurité entière à la plus désespérée extrémité.
Le Roi, à peine à lui-même, prit à l’instant le chemin de l’appartement de Monseigneur, et réprima très sèchement l’indiscret empressement de quelques courtisans à le retenir, disant qu’il vouloit voir encore son fils, et s’il n’y avoit plus de remède. Comme il étoit près d’entrer dans la chambre, Mme la princesse de Conti, qui avoit eu le temps d’accourir chez Monseigneur dans ce court intervalle de la sortie de table, se présenta pour l’empêcher d’entrer; elle le repoussa même des mains, et lui dit qu’il ne falloit plus désormais penser qu’à lui-même. Alors le Roi, presque en foiblesse d’un renversement si subit et si entier, se laissa aller sur un canapé qui se trouva à l’entrée de la porte du cabinet par lequel il étoit entré, qui donnoit dans la chambre: il demandoit des nouvelles à tout ce qui en sortoit, sans que presque personne osât lui répondre. En descendant chez Monseigneur, car il logeoit au-dessus de lui, il avoit envoyé chercher le P. Tellier, qui venoit de se mettre au lit. Il fut bientôt rhabillé et arrivé dans la chambre; mais il n’étoit plus temps, à ce qu’ont dit depuis tous les domestiques, quoique le jésuite, peut-être pour consoler le Roi, lui eût assuré qu’il avoit donné une absolution bien fondée. Mme de Maintenon, accourue auprès du Roi, et assise sur le même canapé, tâchoit de pleurer. Elle essayoit d’emmener le Roi, dont les carrosses étoient déjà prêts dans la cour; mais il n’y eut pas moyen de l’y faire résoudre que Monseigneur ne fût expiré.
Cette agonie sans connoissance dura près d’une heure depuis que le Roi fut dans le cabinet. Madame la Duchesse et Mme la princesse de Conti se partageoient entre les soins du mourant et ceux du Roi, près duquel elles revenoient souvent, tandis que la Faculté confondue, les valets éperdus, le courtisan bourdonnant, se poussoient les uns les autres, et cheminoient sans cesse sans presque changer de lieu. Enfin le moment fatal arriva: Fagon sortit, qui le laissa entendre.
118 Le Roi, fort affligé, et très peiné du défaut de confession, maltraita un peu ce premier médecin, puis sortit, emmené par Mme de Maintenon et par les deux princesses. L’appartement étoit de plein pied à la cour, et comme il se présenta pour monter en carrosse, il trouva devant lui la berline[170] de Monseigneur. Il fit signe de la main qu’on lui amenât un autre carrosse, par la peine que lui faisoit celui-là. Il n’en fut pas néanmoins tellement occupé que, voyant Pontchartrain, il ne l’appelât pour lui dire d’avertir son père et les autres ministres de se trouver le lendemain matin, un peu tard, à Marly, pour le conseil d’État ordinaire du mercredi. Sans commenter ce sens froid, je me contenterai de rapporter la surprise extrême de tous les témoins et de tous ceux qui l’apprirent. Pontchartrain répondit que, ne s’agissant que d’affaires courantes, il vaudrait mieux remettre le conseil d’un jour que de l’en importuner. Le Roi y consentit. Il monta avec peine en carrosse, appuyé des deux côtés, Mme de Maintenon tout de suite après, qui se mit à côté de lui; Madame la Duchesse et Mme la princesse de Conti montèrent après elle, et se mirent sur le devant. Une foule d’officiers de Monseigneur se jetèrent à genoux tout du long de la cour, des deux côtés, sur le passage du Roi, lui criant avec des hurlements étranges d’avoir compassion d’eux, qui avoient tout perdu et qui mouraient de faim.
Tandis que Meudon étoit rempli d’horreur, tout étoit tranquille à Versailles, sans en avoir le moindre soupçon. Nous avions soupé; la compagnie, quelque temps après, s’étoit retirée, et je causois avec Mme de Saint-Simon, qui achevoit de se déshabiller pour se mettre au lit, lorsqu’un ancien valet de chambre à qui elle avoit donné une charge de garçon de la chambre de Mme la duchesse de Berry, et qui y servoit à table, entra tout effarouché. Il nous dit qu’il falloit qu’il y eût de mauvaises nouvelles de Meudon; que Mgr le duc de Bourgogne venoit d’envoyer parler à l’oreille à M. le duc de Berry, à qui les yeux avoient rougi 119 à l’instant; qu’aussitôt il étoit sorti de table, et que, sur un second message fort prompt, la table où la compagnie étoit restée s’étoit levée avec précipitation, et que tout le monde étoit passé dans le cabinet. Un changement si subit rendit ma surprise extrême; je courus chez Mme la duchesse de Berry aussitôt: il n’y avoit plus personne; ils étoient tous allés chez Mme la duchesse de Bourgogne. J’y poussai tout de suite.
J’y trouvai tout Versailles rassemblé ou y arrivant, toutes les dames en déshabillé, la plupart prêtes à se mettre au lit, toutes les portes ouvertes, et tout en trouble. J’appris que Monseigneur avoit reçu l’extrême-onction, qu’il étoit sans connoissance et hors de toute espérance, et que le Roi avoit mandé à Mme la duchesse de Bourgogne qu’il s’en alloit à Marly, et de le venir attendre dans l’avenue entre les deux écuries, pour le voir en passant.
Le spectacle attira toute l’attention que j’y pus donner parmi les divers mouvements de mon âme et ce qui tout à la fois se présenta à mon esprit. Les deux princes et les deux princesses étoient dans le petit cabinet derrière la ruelle du lit; la toilette pour le coucher étoit à l’ordinaire dans la chambre de Mme la duchesse de Bourgogne, remplie de toute la cour en confusion; elle alloit et venoit du cabinet dans la chambre, en attendant le moment d’aller au passage du Roi, et son maintien, toujours avec ses mêmes grâces, étoit un maintien de trouble et de compassion que celui de chacun sembloit prendre pour douleur; elle disoit ou répondoit, en passant devant les uns et les autres, quelques mots rares. Tous les assistants étoient des personnages vraiment expressifs; il ne falloit qu’avoir des yeux, sans aucune connoissance de la cour, pour distinguer les intérêts peints sur les visages, ou le néant de ceux qui n’étoient de rien: ceux-ci tranquilles à eux-mêmes, les autres pénétrés de douleur ou de gravité et d’attention sur eux-mêmes, pour cacher leur élargissement et leur joie.
Mon premier mouvement fut de m’informer à plus d’une fois, de ne croire qu’à peine au spectacle et aux paroles, 120 ensuite de craindre trop peu de cause pour tant d’alarme, enfin de retour sur moi-même, par la considération de la misère commune à tous les hommes, et que moi-même je me trouverois un jour aux portes de la mort. La joie néanmoins perçoit à travers les réflexions momentanées de religion et d’humanité par lesquelles j’essayois de me rappeler; ma délivrance particulière me sembloit si grande et si inespérée qu’il me sembloit, avec une évidence encore plus parfaite que la vérité, que l’État gagnoit tout en une telle perte. Parmi ces pensées, je sentois malgré moi un reste de crainte que le malade en réchappât, et j’en avois une extrême honte.
Enfoncé de la sorte en moi-même, je ne laissai pas de mander à Mme de Saint-Simon qu’il étoit à propos qu’elle vînt, et de percer de mes regards clandestins chaque visage, chaque maintien, chaque mouvement, d’y délecter ma curiosité, d’y nourrir les idées que je m’étois formées de chaque personnage, qui ne m’ont jamais guère trompé, et de tirer de justes conjectures de la vérité de ces premiers élans, dont on est si rarement maître, et qui par là, à qui connoît la carte et les gens, deviennent des indications sûres des liaisons et des sentiments les moins visibles en tous autres temps rassis.
Je vis arriver Mme la duchesse d’Orléans, dont la contenance majestueuse et compassée ne disoit rien; elle entra dans le petit cabinet, d’où bientôt après elle sortit avec M. le duc d’Orléans, duquel l’activité et l’air turbulent marquoient plus l’émotion du spectacle que tout autre sentiment. Ils s’en allèrent, et je le remarque exprès par ce qui bientôt après arriva en ma présence.
Quelques moments après, je vis de loin, vers la porte du petit cabinet, Mgr le duc de Bourgogne avec un air fort ému et peiné; mais le coup d’œil que j’assenai vivement sur lui ne m’y rendit rien de tendre, et ne me rendit que l’occupation profonde d’un esprit saisi.
Valets et femmes de chambre crioient déjà indiscrètement, et leur douleur prouva bien tout ce que cette espèce de gens alloit perdre. Vers minuit et demi, on eut des 121 nouvelles du Roi, et aussitôt je vis Mme la duchesse de Bourgogne sortir du petit cabinet avec Mgr le duc de Bourgogne, l’air alors plus touché qu’il ne m’avoit paru la première fois, et qui rentra aussitôt dans le cabinet. La princesse prit à sa toilette son écharpe et ses coiffes, debout et d’un air délibéré, traversa la chambre, les yeux à peine mouillés, mais trahie par de curieux regards lancés de part et d’autre à la dérobée, et, suivie seulement de ses dames, gagna son carrosse par le grand escalier.
Comme elle sortit de sa chambre, je pris mon temps pour aller chez Mme la duchesse d’Orléans, avec qui je grillois d’être. Entrant chez elle, j’appris qu’ils étoient chez Madame; je poussai jusque-là à travers leurs appartements. Je trouvai Mme la duchesse d’Orléans qui retournoit chez elle, et qui, d’un air fort sérieux, me dit de revenir avec elle. M. le duc d’Orléans étoit demeuré. Elle s’assit dans sa chambre, et auprès d’elle la duchesse de Villeroy[171], la maréchale de Rochefort[172], et cinq ou six dames familières. Je petillois cependant de tant de compagnie; Mme la duchesse d’Orléans, qui n’en étoit pas moins importunée, prit une bougie et passa derrière sa chambre. J’allai alors dire un mot à l’oreille à la duchesse de Villeroy: elle et moi pensions de même sur l’événement présent; elle me poussa, et me dit tout bas de me bien contenir. J’étouffois de silence parmi les plaintes et les surprises narratives de ces dames, lorsque M. le duc d’Orléans parut à la porte du cabinet et m’appela.
Je le suivis dans son arrière-cabinet en bas sur la galerie, lui près de se trouver mal, et moi les jambes tremblantes de tout ce qui se passoit sous mes yeux et au dedans de moi. Nous nous assîmes par hasard vis-à-vis l’un de l’autre: mais quel fut mon étonnement lorsque incontinent après je vis les larmes lui tomber des yeux: “Monsieur!” m’écriai-je en me levant dans l’excès de 122 ma surprise. Il me comprit aussitôt, et me répondit d’une voix coupée et pleurant véritablement: “Vous avez raison d’être surpris, et je le suis moi-même; mais le spectacle touche. C’est un bon homme avec qui j’ai passé ma vie; il m’a bien traité et avec amitié tant qu’on l’a laissé faire et qu’il a agi de lui-même. Je sens bien que l’affliction ne peut pas être longue; mais ce sera dans quelques jours que je trouverai tous les motifs de me consoler dans l’état où on m’avoit mis avec lui; mais présentement le sang, la proximité, l’humanité, tout touche, et les entrailles s’émeuvent.” Je louai ce sentiment; mais j’en avouai mon extrême surprise par la façon dont il étoit avec Monseigneur. Il se leva, se mit la tête dans un coin, le nez dedans, et pleura amèrement et à sanglots, chose que, si je n’avois vue, je n’eusse jamais crue. Après quelque peu de silence, je l’exhortai à se calmer: je lui représentai qu’incessamment il faudroit retourner chez Mme la duchesse de Bourgogne, et que si on l’y voyoit avec des yeux pleureux, il n’y avoit personne qui ne s’en moquât comme d’une comédie très déplacée, à la façon dont toute la cour savoit qu’il étoit avec Monseigneur. Il fit donc ce qu’il put pour arrêter ses larmes, et pour bien essuyer et retaper ses yeux. Il y travailloit encore, lorsqu’il fut averti que Mme la duchesse de Bourgogne arrivoit, et que Mme la duchesse d’Orléans alloit retourner chez elle. Il la fut joindre, et je les y suivis.
Mme la duchesse de Bourgogne, arrêtée dans l’avenue entre les deux écuries, n’avoit attendu le Roi que fort peu de temps; dès qu’il approcha, elle mit pied à terre et alla à sa portière. Mme de Maintenon, qui étoit de ce même côté, lui cria: “Où allez-vous, Madame? N’approchez pas; nous sommes pestiférés.” Je n’ai point su quel mouvement fit le Roi, qui ne l’embrassa point à cause du mauvais air. La princesse à l’instant regagna son carrosse, et s’en revint.
Le beau secret que Fagon avoit imposé sur l’état de Monseigneur avoit si bien trompé tout le monde, que le duc de Beauvillier étoit revenu à Versailles après le conseil 123 de dépêches, et qu’il y coucha contre son ordinaire depuis la maladie de Monseigneur. Comme il se levoit fort matin, il se couchoit toujours sur les dix heures, et il s’étoit mis au lit sans se défier de rien. Il n’y fut pas longtemps sans être réveillé par un message de Mme la duchesse de Bourgogne, qui l’envoya chercher, et il arriva dans son appartement peu avant son retour du passage du Roi. Elle retrouva les deux princes et Mme la duchesse de Berry, avec le duc de Beauvillier, dans ce petit cabinet où elle les avoit laissés.
Après les premiers embrassements d’un retour qui signifioit tout, le duc de Beauvillier, qui les vit étouffants dans ce petit lieu, les fit passer par la chambre dans le salon qui la sépare de la galerie, dont, depuis quelque temps, on avoit fermé ce salon d’une porte pour en faire un grand cabinet. On y ouvrit des fenêtres, et les deux princes, ayant chacun sa princesse à son côté, s’assirent sur un même canapé près des fenêtres, le dos à la galerie, tout le monde épars, assis et debout, et en confusion dans ce salon, et les dames les plus familières par terre aux pieds ou proche du canapé des princes.
Là, dans la chambre et par tout l’appartement, on lisoit apertement sur les visages. Monseigneur n’étoit plus; on le savoit, on le disoit; nul contrainte ne retenoit plus à son égard, et ces premiers moments étoient ceux des premiers mouvements peints au naturel, et pour lors affranchis de toute politique, quoique avec sagesse, par le trouble, l’agitation, la surprise, la foule, le spectacle confus de cette nuit si rassemblée.
Les premières pièces offroient les mugissements contenus des valets, désespérés de la perte d’un maître si fait exprès pour eux, et pour les consoler d’une autre qu’ils ne prévoyoient qu’avec transissement, et qui par celle-ci devenoit la leur propre. Parmi eux s’en remarquoient d’autres des plus éveillés de gens principaux de la cour, qui étoient accourus aux nouvelles, et qui montroient bien à leur air de quelle boutique ils étoient balayeurs.
Plus avant commençoit la foule des courtisans de toute 124 espèce. Le plus grand nombre, c’est-à-dire les sots, tiroient des soupirs de leurs talons, et, avec des yeux égarés et secs, louoient Monseigneur, mais toujours de la même louange, c’est-à-dire de bonté, et plaignoient le Roi de la perte d’un si bon fils. Les plus fins d’entre eux, ou les plus considérables, s’inquiétoient déjà de la santé du Roi; ils se savoient bon gré de conserver tant de jugement parmi ce trouble, et n’en laissoient pas douter par la fréquence de leurs répétitions. D’autres, vraiment affligés, et de cabale frappée, pleuroient amèrement, ou se contenoient avec un effort aussi aisé à remarquer que les sanglots. Les plus forts de ceux-là, ou les plus politiques, les yeux fichés à terre, et reclus en des coins, méditoient profondément aux suites d’un événement si peu attendu, et bien davantage sur eux-mêmes. Parmi ces diverses sortes d’affligés, point ou peu de propos, de conversation nulle, quelque exclamation parfois échappée à la douleur, et parfois répondue par une douleur voisine, un mot en un quart d’heure, des yeux sombres ou hagards, des mouvements de mains moins rares qu’involontaires, immobilité du reste presque entière; les simples curieux et peu soucieux presque nuls, hors les sots, qui avoient le caquet en partage; les questions, et le redoublement du désespoir des affligés, et l’importunité pour les autres. Ceux qui déjà regardoient cet événement comme favorable avoient beau pousser la gravité jusqu’au maintien chagrin et austère; le tout n’étoit qu’un voile clair, qui n’empêchoit pas de bons yeux de remarquer et de distinguer tous leurs traits. Ceux-ci se tenoient aussi tenaces en place que les plus touchés, en garde contre l’opinion, contre la curiosité, contre leur satisfaction, contre leurs mouvements; mais leurs yeux suppléoient au peu d’agitation de leurs corps. Des changements de posture, comme des gens peu assis ou mal debout; un certain soin de s’éviter les uns les autres, même de se rencontrer des yeux; les accidents momentanés qui arrivoient de ces rencontres; un je ne sais quoi de plus vif, de plus libre en toute la personne, à travers le soin de se tenir et de se composer; un vif, une 125 sorte d’étincelant autour d’eux, les distinguoit malgré qu’ils en eussent.
Les deux princes et les deux princesses assises à leurs côtés, prenant soin d’eux, étoient les plus exposés à la pleine vue. Mgr le duc de Bourgogne pleuroit d’attendrissement et de bonne foi, avec un air de douceur, des larmes de nature, de religion, de patience. M. le duc de Berry, tout d’aussi bonne foi, en versoit en abondance, mais des larmes pour ainsi dire sanglantes, tant l’amertume en paroissoit grande, et poussoit non des sanglots, mais des cris, mais des hurlements. Il se taisoit parfois, mais de suffocation, puis éclatoit, mais avec un tel bruit, et un bruit si fort, la trompette forcée du désespoir, que la plupart éclatoient aussi à ces redoublements si douloureux, ou par un aiguillon d’amertume, ou par un aiguillon de bienséance. Cela fut au point qu’il fallut le déshabiller là même, et se précautionner de remèdes et de gens de la Faculté. Mme la duchesse de Berry étoit hors d’elle; on verra bientôt pourquoi. Le désespoir le plus amer étoit peint avec horreur sur son visage. On y voyoit comme écrit une rage de douleur, non d’amitié, mais d’intérêt; des intervalles secs, mais profonds et farouches, puis un torrent de larmes et de gestes involontaires, et cependant retenus, qui montroit une amertume d’âme extrême, fruit de la méditation profonde qui venoit de précéder. Souvent réveillée par les cris de son époux, prompte à le secourir, à le soutenir, à l’embrasser, à lui présenter quelque chose à sentir, on voyoit un soin vif pour lui, mais tôt après une chute profonde en elle-même, puis un torrent de larmes qui lui aidoient à suffoquer ses cris. Mme la duchesse de Bourgogne consoloit aussi son époux, et y avoit moins de peine qu’à acquérir le besoin d’être elle-même consolée, à quoi pourtant, sans rien montrer de faux, on voyoit bien qu’elle faisoit de son mieux pour s’acquitter d’un devoir pressant de bienséance sentie, mais qui se refuse au plus grand besoin: le fréquent moucher répondoit aux cris du prince son beau-frère; quelques larmes amenées du spectacle, et souvent entretenues avec 126 soin, fournissoient à l’art du mouchoir pour rougir et grossir les yeux et barbouiller le visage, et cependant le coup d’œil fréquemment dérobé se promenoit sur l’assistance et sur la contenance de chacun.
Le duc de Beauvillier, debout auprès d’eux, l’air tranquille et froid, comme à chose non avenue ou à spectacle ordinaire, donnoit ses ordres pour le soulagement des princes, pour que peu de gens entrassent, quoique les portes fussent ouvertes à chacun, en un mot pour tout ce qu’il étoit besoin, sans empressement, sans se méprendre en quoi que ce soit ni aux gens ni aux choses: vous l’auriez cru au lever ou au petit couvert, servant à l’ordinaire. Ce flegme dura sans la moindre altération, également éloigné d’être aise par religion et de cacher aussi le peu d’affliction qu’il ressentoit, pour conserver toujours la vérité.
Madame, rhabillée en grand habit, arriva hurlante, ne sachant bonnement pourquoi ni l’un ni l’autre, les inonda tous de ses larmes en les embrassant, fit retentir le château d’un renouvellement de cris, et fournit un spectacle bizarre d’une princesse qui se remet en cérémonie, en pleine nuit, pour venir pleurer et crier parmi une foule de femmes en déshabillé de nuit, presque en mascarades.
Mme la duchesse d’Orléans s’étoit éloignée des princes, et s’étoit assise le dos à la galerie, vers la cheminée, avec quelques dames. Tout étant fort silencieux autour d’elle, ces dames peu à peu se retirèrent d’auprès elle, et lui firent grand plaisir. Il n’y resta que la duchesse Sforze[173], la duchesse de Villeroy, Mme de Castries[174], sa dame d’atour, et Mme de Saint-Simon. Ravies de leur liberté, elles s’approchèrent en un tas, tout le long d’un lit de veille à pavillon et le joignant, et comme elles étoient toutes affectées de même à l’égard de l’événement qui rassembloit là tant de monde, elles se mirent à en deviser tout bas ensemble dans ce groupe avec liberté.
Dans la galerie et dans ce salon il y avoit plusieurs lits 127 de veille, comme dans tout le grand appartement, pour la sûreté, où couchoient des Suisses de l’appartement et des frotteurs, et ils y avoient été mis à l’ordinaire avant les mauvaises nouvelles de Meudon. Au fort de la conversation de ces dames, Mme de Castries, qui touchoit au lit, le sentit remuer, et en fut fort effrayée, car elle l’étoit de tout, quoique avec beaucoup d’esprit. Un moment après elles virent un gros bras presque nu relever tout à coup le pavillon, qui leur montra un bon gros Suisse entre deux draps, demi-éveillé et tout ébahi, très long à reconnoître son monde, qu’il regardoit fixement l’un après l’autre, qui enfin, ne jugeant pas à propos de se lever en si grande compagnie, se renfonça dans son lit et ferma son pavillon. Le bonhomme s’étoit apparemment couché avant que personne eût rien appris, et avoit assez profondément dormi depuis pour ne s’être réveillé qu’alors. Les plus tristes spectacles sont assez souvent sujets aux contrastes les plus ridicules: celui-ci fit rire quelque dame de là autour, et quelque peur à Mme la duchesse d’Orléans et à ce qui causoit avec elle, d’avoir été entendues; mais, réflexion faite, le sommeil et la grossièreté du personnage les rassura.
La duchesse de Villeroy, qui ne faisoit presque que les joindre, s’étoit fourrée un peu auparavant dans le petit cabinet, avec la comtesse de Roucy[175] et quelques dames du palais, dont Mme de Levis[176] n’avoit osé approcher, par penser trop conformément à la duchesse de Villeroy. Elles y étoient quand j’arrivai.
Je voulois douter encore, quoique tout me montrât ce 128 qui étoit, mais je ne pus me résoudre à m’abandonner à le croire que le mot ne m’en fût prononcé par quelqu’un à qui on pût ajouter foi. Le hasard me fit rencontrer M. d’O[177], à qui je le demandai, et qui me le dit nettement. Cela su, je tâchai de n’en être pas bien aise. Je ne sais pas trop si j’y réussis bien, mais au moins est-il vrai que ni joie ni douleur n’émoussèrent ma curiosité, et qu’en prenant bien garde à conserver toute bienséance, je ne me crus pas engagé par rien au personnage douloureux. Je ne craignois plus les retours du feu de la citadelle de Meudon, ni les cruelles courses de son implacable garnison, et je me contraignis moins qu’avant le passage du Roi pour Marly de considérer plus librement toute cette nombreuse compagnie, d’arrêter mes yeux sur les plus touchés et sur ceux qui l’étoient le moins avec une affection différente, de suivre les uns et les autres de mes regards, et de les en percer tous à la dérobée. Il faut avouer que, pour qui est bien au fait de la carte intime d’une cour, les premiers spectacles d’événements rares de cette nature, si intéressante à tant de divers égards, sont d’une satisfaction extrême: chaque visage vous rappelle les soins, les intrigues, les sueurs employées à l’avancement des fortunes, à la formation, à la force des cabales, les adresses à se maintenir et à en écarter d’autres, les moyens de toute espèce mis en œuvre pour cela, les liaisons plus ou moins avancées, les éloignements, les froideurs, les haines, les mauvais offices, les manèges, les avances, les ménagements, les petitesses, les bassesses de chacun, le déconcertement des uns au milieu de leur chemin, au milieu ou au comble de leurs espérances, la stupeur de ceux qui en jouissoient en plein, le poids donné du même coup à leurs contraires et à la cabale opposée, la vertu de ressort qui pousse dans cet instant leurs menées et leurs concerts à bien, la satisfaction extrême et inespérée de ceux-là, et j’en étois des plus avant, la rage qu’en conçoivent les autres, leur embarras et leur dépit à le cacher, la promptitude des yeux à voler partout en sondant les âmes à la 129 faveur de ce premier trouble de surprise et de dérangement subit, la combinaison de tout ce qu’on y remarque, l’étonnement de ne pas trouver ce qu’on avoit cru de quelques-uns, faute de cœur ou d’assez d’esprit en eux, et plus en d’autres qu’on n’avoit pensé: tout cet amas d’objets vifs et de choses si importantes forme un plaisir à qui le sait prendre qui, tout peu solide qu’il devient, est un des plus grands dont on puisse jouir dans une cour.
Ce fut donc à celui-là que je me livrai tout entier en moi-même, avec d’autant plus d’abandon que, dans une délivrance bien réelle, je me trouvois étroitement lié et embarqué avec les têtes principales qui n’avoient point de larmes à donner à leurs yeux. Je jouissois de leur avantage sans contre-poids, et de leur satisfaction qui augmentoit la mienne, qui consolidoit mes espérances, qui me les élevoit, qui m’assuroit un repos auquel, sans cet événement, je voyois si peu d’apparence que je ne cessois point de m’inquiéter d’un triste avenir, et que d’autre part, ennemi de liaison, et presque personnel, des principaux personnages que cette perte accabloit, je vis [du] premier coup d’œil vivement porté, tout ce qui leur échappoit et tout ce qui les accableroit, avec un plaisir qui ne se peut rendre. J’avois si fort imprimé dans ma tête les différentes cabales, leurs subdivisions, leurs replis, leurs divers personnages et leurs degrés, la connoissance de leurs chemins, de leurs ressorts, de leurs divers intérêts, que la méditation de plusieurs jours ne m’auroit pas développé et représenté toutes ces choses plus nettement que ce premier aspect de tous ces visages, qui me rappeloient encore ceux que je ne voyois pas, et qui n’étoient pas les moins friands à s’en repaître.
Je m’arrêtai donc un peu à considérer le spectacle de ces différentes pièces de ce vaste et tumultueux appartement. Cette sorte de désordre dura bien une heure, où la duchesse du Lude[178] ne parut point, retenue au lit par la goutte. A la fin M. de Beauvillier s’avisa qu’il étoit temps de délivrer les deux princes d’un si fâcheux public. Il 130 leur proposa donc que M. et Mme la duchesse de Berry se retirassent dans leur appartement, et le monde de celui de Mme la duchesse de Bourgogne. Cet avis fut aussitôt embrassé. M. le duc de Berry s’achemina donc, partie seul et quelquefois appuyé par son épouse, Mme de Saint-Simon avec eux, et une poignée de gens. Je les suivis de loin, pour ne pas exposer ma curiosité plus longtemps. Ce prince vouloit coucher chez lui; mais Mme la duchesse de Berry ne le voulut pas quitter. Il était si suffoqué et elle aussi, qu’on fit demeurer auprès d’eux une Faculté complète et munie.
Toute leur nuit se passa en larmes et en cris. De fois à autre M. le duc de Berry demandoit des nouvelles de Meudon, sans vouloir comprendre la cause de la retraite du Roi à Marly. Quelquefois il s’informoit s’il n’y avoit plus d’espérance. Il vouloit envoyer aux nouvelles; et ce ne fut qu’assez avant dans la matinée que le funeste rideau fut tiré de devant ses yeux, tant la nature et l’intérêt ont de peine à se persuader des maux extrêmes sans remède. On ne peut rendre l’état où il fut quand il se sentit enfin dans toute son étendue. Celui de Mme la duchesse de Berry ne fut guère meilleur, mais qui ne l’empêcha pas de prendre de lui tous les soins possibles.
La nuit de M. et de Mme la duchesse de Bourgogne fut plus tranquille; ils se couchèrent assez paisiblement. Mme de Levis dit tout bas à la princesse que, n’ayant pas lieu d’être affligée, il seroit horrible de lui voir jouer la comédie. Elle répondit bien naturellement que, sans comédie, la pitié et le spectacle la touchoient et la bienséance la contenoit, et rien de plus; et en effet elle se tint dans ces bornes-là, avec vérité et avec décence. Ils voulurent que quelques-unes des dames du palais passassent la nuit dans leur chambre dans des fauteuils. Le rideau demeura ouvert, et cette chambre devint aussitôt le palais de Morphée. Le prince et la princesse s’endormirent promptement, s’éveillèrent une fois ou deux un instant; à la vérité, ils se levèrent d’assez bonne heure, et assez doucement. Le réservoir d’eau étoit tari chez eux; 131 les larmes ne revinrent plus depuis que rares et foibles, à force d’occasion. Les dames qui avoient veillé et dormi dans cette chambre contèrent à leurs amis ce qui s’y étoit passé. Personne n’en fut surpris, et comme il n’y avoit plus de Monseigneur, personne aussi n’en fut scandalisé.
Mme de Saint-Simon et moi, au sortir de chez M. et Mme la duchesse de Berry, nous fûmes encore deux heures ensemble. La raison, plutôt que le besoin, nous fit coucher, mais avec si peu de sommeil qu’à sept heures du matin j’étois debout; mais, il faut l’avouer, de telles insomnies sont douces, et de tels réveils savoureux.
L’horreur régnoit à Meudon. Dès que le Roi en fut parti, tout ce qu’il y avoit de gens de la cour le suivirent, et s’entassèrent dans ce qui se trouva de carrosses, et dans ce qu’il en vint aussitôt après. En un instant Meudon se trouva vide. Mlle de Lislebonne et Mlle de Melun montèrent chez Mlle Choin, qui, recluse dans son grenier, ne faisoit que commencer à entrer dans les transes funestes. Elle avoit tout ignoré; personne n’avoit pris soin de lui apprendre de tristes nouvelles; elle ne fut instruite de son malheur que par les cris. Ces deux amies la jetèrent dans un carrosse de louage qui se trouva encore là par hasard, y montèrent avec elle, et la menèrent à Paris.
Pontchartrain, avant partir, monta chez Voysin[179]. Il trouva ses gens difficiles à ouvrir, et lui profondément endormi; il s’étoit couché sans aucun soupçon sinistre, et fut étrangement surpris à ce réveil. Le comte de Brionne[180] le fut bien davantage. Lui et ses gens s’étoient couchés dans la même confiance; personne ne songea à eux. Lorsqu’en se levant il sentit ce grand silence, il voulut aller aux nouvelles, et ne trouva personne, jusqu’à 132 ce que, dans cette surprise, il apprit enfin ce qui étoit arrivé.
Cette foule de bas officiers de Monseigneur, et bien d’autres, errèrent toute la nuit dans les jardins. Plusieurs courtisans étoient partis épars à pied. La dissipation fut entière et la dispersion générale. Un ou deux valets au plus demeurèrent auprès du corps, et, ce qui est très digne de louange, la Vallière[181] fut le seul des courtisans qui, ne l’ayant point abandonné pendant sa vie, ne l’abandonna point après sa mort. Il eut peine à trouver quelqu’un pour aller chercher des capucins pour venir prier Dieu auprès du corps. L’infection en devint si prompte et si grande que l’ouverture des fenêtres qui donnoient en portes sur la terrasse ne suffit pas, et que la Vallière, les capucins et ce très peu de bas étage qui étoit demeuré passèrent la nuit dehors. Du Mont et Casaus son neveu, navrés de la plus extrême douleur, y étoient ensevelis dans la Capitainerie. Ils perdoient tout après une longue vie toute de petits soins, d’assiduité, de travail, soutenue par les plus flatteuses et les plus raisonnables espérances, et les plus longuement prolongées, qui leur échappoient en un moment. A peine, sur le matin, du Mont put-il donner quelques ordres. Je plaignis celui-là avec amitié.
On s’étoit reposé sur une telle confiance que personne n’avoit songé que le Roi pût aller à Marly. Aussi n’y trouva-t-il rien de prêt: point de clefs des appartements, à peine quelque bout de bougie, et même de chandelle. Le Roi fut plus d’une heure dans cet état, avec Mme de Maintenon, dans son antichambre à elle, Madame la Duchesse, Mme la princesse de Conti, Mmes de Dangeau et de Caylus, celle-ci accourue de Versailles auprès de sa tante. Mais ces deux dames ne se tinrent que peu, par-ci par-là, dans cette antichambre, par discrétion. Ce qui avoit suivi et qui arrivoit à la file étoit dans le salon, en même désarroi et sans savoir où gîter. On fut longtemps 133 à tâtons, et toujours sans feu, et toujours les clefs mêlées, égarées par l’égarement des valets. Les plus hardis de ce qui étoit dans le salon montrèrent peu à peu le nez dans l’antichambre, où Mme d’Espinoy ne fut pas des dernières, et de l’un à l’autre tout ce qui étoit venu s’y présenta, poussés de curiosité et de desir de tâcher que leur empressement fût remarqué. Le Roi, reculé en un coin, assis entre Mme de Maintenon et les deux princesses, pleuroit à longues reprises. Enfin la chambre de Mme de Maintenon fut ouverte, qui le délivra de cette importunité. Il y entra seul avec elle, et y demeura encore une heure. Il alla ensuite se coucher, qu’il étoit près de quatre heures du matin, et la laissa en liberté de respirer et de se rendre à elle-même. Le Roi couché, chacun sut enfin où loger, et Bloin eut ordre de répandre que les gens qui desireroient des logements à Marly s’adressassent à lui, pour qu’il en rendît compte au Roi et qu’il avertît les élus.
Monseigneur étoit plutôt grand que petit, fort gros, mais sans être trop entassé, l’air fort haut et fort noble, sans rien de rude, et il auroit eu le visage fort agréable si M. le prince de Conti, le dernier mort, ne lui avoit pas cassé le nez par malheur en jouant, étant tous deux enfants. Il étoit d’un fort beau blond, avoit le visage fort rouge de hâle partout et fort plein, mais sans aucune physionomie, les plus belles jambes du monde, les pieds singulièrement petits et maigres. Il tâtonnoit toujours en marchant, et mettoit le pied à deux fois: il avoit toujours peur de tomber, et il se faisoit aider pour peu que le chemin ne fût pas parfaitement droit et uni. Il étoit fort bien à cheval et y avoit grande mine, mais il n’y étoit pas hardi. Casaus couroit devant lui à la chasse; s’il le perdoit de vue, il croyoit tout perdu; il n’alloit guère qu’au petit galop, et attendoit souvent sous un arbre ce que devenoit la chasse, la cherchoit lentement, et s’en revenoit. Il avoit fort aimé la table, mais toujours sans indécence. Depuis cette grande indigestion qui fut prise d’abord pour apoplexie, il ne faisoit guère qu’un vrai repas, et se contenoit fort, quoique grand mangeur comme toute la 134 maison royale. Presque tous ses portraits[182] lui ressemblent bien.
De caractère, il n’en avoit aucun; du sens assez, sans aucune sorte d’esprit, comme il parut dans l’affaire du testament du roi d’Espagne; de la hauteur, de la dignité par nature, par prestance, par imitation du Roi; de l’opiniâtreté sans mesure, et un tissu de petitesses arrangées, qui formoient tout le tissu de sa vie; doux par paresse et par une sorte de stupidité, dur au fond, avec un extérieur de bonté qui ne portoit que sur des subalternes, et sur des valets, et qui ne s’exprimoit que par des questions basses; il étoit avec eux d’une familiarité prodigieuse, d’ailleurs insensible à la misère et à la douleur des autres, en cela peut-être plutôt en proie à l’incurie et à l’imitation qu’à un mauvais naturel; silencieux jusqu’à l’incroyable, conséquemment fort secret, jusque-là qu’on a cru qu’il n’avoit jamais parlé d’affaires d’État à la Choin, peut-être que parce que tous [deux] n’y entendoient guère. L’épaisseur d’une part, la crainte de l’autre, formoient en ce prince une retenue qui a peu d’exemples; en même temps glorieux à l’excès, ce qui est plaisant à dire d’un Dauphin, jaloux du respect, et presque uniquement attentif et sensible à ce qui lui étoit dû, et partout. Il dit une fois à Mlle Choin, sur ce silence dont elle lui parloit, que les paroles de gens comme lui portant un grand poids, et obligeant ainsi à de grandes réparations quand elles n’étoient pas mesurées, il aimoit mieux très souvent garder le silence que de parler. C’étoit aussi plus tôt fait pour sa paresse et sa parfaite incurie; et cette maxime excellente, mais qu’il outroit, étoit apparemment une des leçons du Roi ou du duc de Montausier qu’il avoit le mieux retenue.
Son arrangement étoit extrême pour les affaires particulières: il écrivoit lui-même toutes ses dépenses prises sur lui; il savoit ce que lui coûtoient les moindres choses, quoique il dépensât infiniment en bâtiments, en meubles, en joyaux de toute espèce, en voyages de Meudon, et à 135 l’équipage du loup, dont il s’étoit laissé accroire qu’il aimoit la chasse. Il avoit fort aimé toute sorte de gros jeu, mais depuis qu’il s’étoit mis à bâtir il s’étoit réduit à des jeux médiocres; du reste, avare au delà de toute bienséance, excepté de très rares occasions, qui se bornoient à quelques pensions à des valets ou à quelques médiocres domestiques; mais assez d’aumônes au curé et aux capucins de Meudon.
Il est inconcevable le peu qu’il donnoit à la Choin, si fort sa bien-aimée: cela ne passoit point quatre cents louis par quartier, en or, quoi qu’ils valussent, faisant pour tout seize cents louis par an. Il les lui donnoit lui-même, de la main à la main, sans y ajouter ni s’y méprendre jamais d’une pistole, et tout au plus une boîte ou deux par an; encore y regardoit-il de fort près.
Il faut rendre justice à cette fille, et convenir aussi qu’il est difficile d’être plus désintéressée qu’elle l’étoit, soit qu’elle en connût la nécessité avec ce prince, soit plutôt que cela lui fût naturel, comme il a paru dans tout le tissu de sa vie. C’est encore un problème si elle étoit mariée; tout ce qui a été le plus intimement initié dans leurs mystères s’est toujours fortement récrié qu’il n’y a jamais eu de mariage. Ce n’a jamais été qu’une grosse camarde brune, qui avec toute la physionomie d’esprit, et aussi le jeu, n’avoit l’air que d’une servante, et qui longtemps avant cet événement-ci étoit devenue excessivement grasse, et encore vieille et puante; mais de la voir aux parvulo[183] de Meudon, dans un fauteuil devant Monseigneur, en présence de tout ce qui y étoit admis, Mme la duchesse de Bourgogne et Mme la duchesse de Berry, qui y fut tôt introduite, chacune sur un tabouret, dire devant Monseigneur et tout cet intérieur la duchesse de Bourgogne et la duchesse de Berry et le duc de Berry, en parlant d’eux, répondre souvent sèchement aux deux filles de la maison, les reprendre, trouver à redire à leur ajustement, et quelquefois à leur air et à leur conduite, 136 et le leur dire, on a peine à tout cela à ne pas reconnoître la belle-mère et la parité avec Mme de Maintenon. A la vérité, elle ne disoit pas mignonne en parlant à Mme la duchesse de Bourgogne, qui l’appeloit Mademoiselle, et non ma tante; mais aussi c’étoit toute la différence d’avec Mme de Maintenon. D’ailleurs encore cela n’avoit jamais pris de même entre elles. Madame la Duchesse, les deux Lislebonnes et tout cet intérieur y étoit un obstacle; et Mme la duchesse de Bourgogne, qui le sentoit et qui étoit timide, se trouvoit toujours gênée et en brassière à Meudon, tandis qu’entre le Roi et Mme de Maintenon elle jouissoit de toute aisance et de toute liberté. De voir encore Mlle Choin à Meudon, pendant une maladie si périlleuse, voir Monseigneur plusieurs fois le jour, le Roi non-seulement le savoir, mais demander à Mme de Maintenon, qui, à Meudon non plus qu’ailleurs, ne voyoit personne, et qui n’entra peut-être pas deux fois chez Monseigneur, lui demander, dis-je, si elle avoit vu la Choin, et trouver mauvais qu’elle ne l’eût pas vue, bien loin de la faire sortir du château, comme on le fait toujours en ces occasions, c’est encore une preuve du mariage d’autant plus grande que Mme de Maintenon, mariée elle-même, et qui affichoit si fort la pruderie et la dévotion, n’avoit, ni le Roi non plus, aucun intérêt d’exemple et de ménagement à garder là-dessus s’il n’y avoit point de sacrement, et on ne voit point qu’en aucun temps la présence de Mlle Choin ait causé le plus léger embarras. Cet attachement incompréhensible, et si semblable en tout à celui du Roi, à la figure près de la personne chérie, est peut-être l’unique endroit par où le fils ait ressemblé au père.
Monseigneur, tel pour l’esprit qu’il vient d’être représenté, n’avoit pu profiter de l’excellente culture qu’il reçut du duc de Montausier, et de Bossuet et de Fléchier, évêques de Meaux et de Nîmes. Son peu de lumière, s’il en eut jamais, s’éteignit au contraire sous la rigueur d’une éducation dure et austère[184], qui donna le dernier poids à 137 sa timidité naturelle, et le dernier degré d’aversion pour toute espèce, non pas de travail et d’étude, mais d’amusement d’esprit, en sorte que, de son aveu, depuis qu’il avoit été affranchi des maîtres, il n’avoit de sa vie lu que l’article de Paris de la Gazette de France, pour y voir les morts et les mariages.
Tout contribua donc en lui, timidité naturelle, dur joug d’éducation, ignorance parfaite et défaut de lumière, à le faire trembler devant le Roi, qui, de son côté, n’omit rien pour entretenir et prolonger cette terreur toute sa vie. Toujours roi, presque jamais père avec lui, ou s’il lui en échappa bien rarement quelques traits, ils ne furent jamais purs et sans mélange de royauté, non pas même dans les moments les plus particuliers et les plus intérieurs. Ces moments même étoient rares tête à tête, et n’étoient que des moments presque toujours en présence des bâtards et des valets intérieurs, sans liberté, sans aisance, toujours en contrainte et en respect, sans jamais oser rien hasarder ni usurper, tandis que tous les jours il voyoit faire l’un et l’autre au duc du Maine avec succès, et Mme la duchesse de Bourgogne dans une habitude de tous les temps particuliers, des plus familiers badinages, et des privautés avec le Roi quelquefois les plus outrées. Il en sentoit contre eux une secrète jalousie, mais qui ne l’élargissoit pas. L’esprit ne lui fournissoit rien comme à M. du Maine, fils d’ailleurs de la personne et non de la royauté, et en telle disproportion qu’elle n’étoit point en garde. Il n’étoit plus de l’âge de Mme la duchesse de Bourgogne, à qui on passoit encore les enfances par habitude et par la grâce qu’elle y mettoit; il ne lui restoit donc que la qualité de fils et de successeur, qui étoit précisément ce qui tenoit le Roi en garde, et lui sous le joug.
De ce long et curieux détail il résulte que Monseigneur étoit sans vice ni vertu, sans lumières ni connoissances quelconques, radicalement incapable d’en acquérir, très paresseux, sans imagination ni production, sans goût, sans choix, sans discernement, né pour l’ennui, qu’il 138 communiquoit aux autres, et pour être une boule roulante au hasard par l’impulsion d’autrui, opiniâtre et petit en tout à l’excès, de l’incroyable facilité à se prévenir et à tout croire qu’on a vue, livré aux plus pernicieuses mains, incapable d’en sortir ni de s’en apercevoir, absorbé dans sa graisse et dans ses ténèbres, et que, sans avoir aucune volonté de mal faire, il eût été un roi pernicieux.
Le pourpre, mêlé à la petite vérole dont il mourut, et la prompte infection qui en fut la suite, firent juger également inutile et dangereuse l’ouverture de son corps. Il fut enseveli, les uns ont dit par des Sœurs grises[185], les autres par des frotteurs du château, d’autres par les plombiers mêmes qui apportèrent le cercueil. On jeta dessus un vieux poêle[186] de la paroisse, et sans aucun accompagnement que des mêmes qui y étoient restés, c’est-à-dire du seul la Vallière, de quelques subalternes et des capucins de Meudon, qui se relevèrent à prier Dieu auprès du corps, sans aucune tenture, ni luminaire que quelques cierges.
Il étoit mort vers minuit du mardi au mercredi; le jeudi il fut porté à Saint-Denis dans un carrosse du Roi, qui n’avoit rien de deuil, et dont on ôta la glace de devant pour laisser passer le bout du cercueil. Le curé de Meudon et le chapelain en quartier chez Monseigneur y montèrent. Un autre carrosse du Roi suivit, aussi sans aucun deuil, au derrière duquel montèrent le duc de la Trémoïlle[187], premier gentilhomme de la chambre, point en année, et Monsieur de Metz[188], premier aumônier; sur le devant, Dreux[189], grand maître des cérémonies, et l’abbé de Brancas[190], aumônier de quartier chez Monseigneur, depuis évêque de 139 Lisieux, et frère du maréchal de Brancas[191] des gardes du corps, des valets de pied et vingt-quatre pages du Roi portant des flambeaux. Ce très simple convoi partit de Meudon sur les six ou sept heures du soir, passa sur le pont de Sèvres, traversa le bois de Boulogne, et par la plaine de Saint-Ouen gagna Saint-Denis, où tout de suite le corps fut descendu dans le caveau royal, sans aucune sorte de cérémonie.
Telle fut la fin d’un prince qui passa près de cinquante ans à faire faire des plans aux autres, tandis que sur le bord du trône il mena toujours une vie privée, pour ne pas dire obscure, jusque-là qu’il ne s’y trouve rien de marqué que la propriété de Meudon et ce qu’il y a fait d’embellissement. Chasseur sans plaisir, presque voluptueux, mais sans goût, gros joueur autrefois pour gagner, mais depuis qu’il bâtissoit sifflant dans un coin du salon de Marly, et frappant des doigts sur sa tabatière, ouvrant de grands yeux sur les uns et les autres sans presque regarder, sans conversation, sans amusement, je dirois volontiers sans sentiment et sans pensée, et toutefois, par la grandeur de son être, le point aboutissant, l’âme, la vie de la cabale la plus étrange, la plus terrible, la plus profonde, la plus unie, nonobstant ses subdivisions, qui ait existé depuis la paix des Pyrénées, qui a scellé la dernière fin des troubles nés de la minorité du Roi. Je me suis un peu longuement arrêté sur ce prince presque indéfinissable, parce qu’on ne peut le faire connoître que par des détails. On seroit infini à les rapporter tous. Cette matière d’ailleurs est assez curieuse pour permettre de s’étendre sur un Dauphin si peu connu, qui n’a jamais été rien ni de rien en une si longue et si vaine attente de la couronne, et sur qui enfin la corde a cassé de tant d’espérances, de craintes et de projets[192].
Achille de Harlay (1639-1712), a great-nephew of the celebrated magistrate of the same name who was Chancellor to Henri III, was appointed First President of the Paris Parlement in 1689. Saint-Simon was violently prejudiced against him on account of the partiality which he believed him to have shewn to the Duc de Luxembourg in his case against his fellow ducs et pairs (see Introduction). He returns to the charge in vol. V. with an even more furious attack, and a report of some of his malicious sayings (pp. 166-171). See for a judicial estimate of his character based on contemporary evidence Boislisle, XIV. 371, n. 2, and 617-622.
The truth seems to be that with great capacity and perfect integrity he had a malicious and biting tongue and the reputation of being a Tartuffe.
Harlay étoit fils d’un autre procureur général du Parlement et d’une Bellièvre, duquel le grand-père fut ce fameux Achille d’Harlay, premier président du Parlement après ce célèbre Christophle de Thou, son beau-père, lequel étoit père de ce fameux historien. Issu de ces grands magistrats, Harlay en eut toute la gravité, qu’il outra en cynique, en affecta le désintéressement et la modestie, qu’il déshonora l’une par sa conduite, l’autre par un orgueil raffiné, mais extrême, et qui, malgré lui, sautoit aux yeux. Il se piqua surtout de probité et de justice, dont le masque tomba bientôt. Entre Pierre et Jacques il conservoit la plus exacte droiture; mais dès qu’il apercevoit un intérêt ou une faveur à ménager, tout aussitôt il étoit vendu. La suite de ces Mémoires en pourra fournir des exemples; en attendant, ce procès-ci le manifesta à découvert.
Il étoit savant en droit public, il possédoit fort le fond des diverses jurisprudences, il égaloit les plus versés aux belles-lettres, il connoissoit bien l’histoire, et savoit surtout gouverner sa compagnie avec une autorité qui ne 141 souffroit point de réplique, et que nul autre premier président n’atteignit jamais avant lui. Une austérité pharisaïque le rendoit redoutable par la licence qu’il donnoit à ses répréhensions publiques, et aux parties, et aux avocats, et aux magistrats, en sorte qu’il n’y avoit personne qui ne tremblât d’avoir affaire à lui. D’ailleurs, soutenu en tout par la cour, dont il étoit l’esclave, et le très humble serviteur de ce qui y étoit en vraie faveur, fin courtisan et singulièrement rusé politique, tous ces talents, il les tournoit uniquement à son ambition de dominer et de parvenir, et de se faire une réputation de grand homme; d’ailleurs, sans honneur effectif, sans mœurs dans le secret, sans probité qu’extérieure, sans humanité même, en un mot un hypocrite parfait, sans foi, sans loi, sans Dieu et sans âme, cruel mari, père barbare, frère tyran, ami uniquement de soi-même, méchant par nature, se plaisant à insulter, à outrager, à accabler, et n’en ayant de sa vie perdu une occasion. On feroit un volume de ses traits, et tous d’autant plus perçants qu’il avoit infiniment d’esprit, l’esprit naturellement porté à cela, et toujours maître de soi pour ne rien hasarder dont il pût avoir à se repentir.
Pour l’extérieur, un petit homme vigoureux et maigre, un visage en losange, un nez grand et aquilin, des yeux beaux, parlants, perçants, qui ne regardoient qu’à la dérobée, mais qui, fixés sur un client ou sur un magistrat, étoient pour le faire rentrer en terre; un habit peu ample, un rabat presque d’ecclésiastique, et des manchettes plates, comme eux, une perruque fort brune et fort mêlée de blanc, touffue, mais courte, avec une grande calotte par-dessus. Il se tenoit et marchoit un peu courbé, avec un faux air plus humble que modeste, et rasoit toujours les murailles pour se faire faire place avec plus de bruit, et n’avançoit qu’à force de révérences respectueuses et comme honteuses à droite et à gauche, à Versailles[193].
Marie-Elisabeth de Vivonne, daughter of Louis-Victor de Rochechouart, Duc de Vivonne, the brother of Mme de Montespan, and wife of the Marquis de Castries. She died in 1718.
Mme de Castries étoit un quart de femme, une espèce de biscuit manqué, extrêmement petite, mais bien prise, et auroit passé dans un médiocre anneau: ni derrière, ni gorge, ni menton, fort laide, l’air toujours en peine et étonné; avec cela une physionomie qui éclatoit d’esprit et qui tenoit encore plus parole. Elle savoit tout: histoire, philosophie, mathématiques, langues savantes, et jamais il ne paroissoit qu’elle sût mieux que parler françois; mais son parler avoit une justesse, une énergie, une éloquence, une grâce jusque dans les choses les plus communes, avec ce tour unique qui n’est propre qu’aux Mortemarts. Aimable, amusante, gaie, sérieuse, toute à tous, charmante quand elle vouloit plaire, plaisante naturellement, avec la dernière finesse, sans la vouloir être, et assénant aussi les ridicules à ne les jamais oublier; glorieuse, choquée de mille choses, avec un ton plaintif qui emportoit la pièce, cruellement méchante quand il lui plaisoit, et fort bonne amie, polie, gracieuse, obligeante en général; sans aucune galanterie, mais délicate sur l’esprit, et amoureuse de l’esprit où elle le trouvoit à son gré; avec cela un talent de raconter qui charmoit, et quand elle vouloit faire un roman sur-le-champ, une source de production, de variété et d’agrément qui étonnoit. Avec sa gloire, elle se croyoit bien mariée, par l’amitié qu’elle eut pour son mari: elle l’étendit sur tout ce qui lui appartenoit, et elle étoit aussi glorieuse pour lui que pour elle; elle en recevoit le réciproque et toutes sortes d’égards et de respects[194].
André le Nostre (1613-1700) attracted the notice of Louis XIV by his great work at Vaux-le-Vicomte, the princely residence of Fouquet. Among the famous gardens designed by him were Versailles, the Tuileries, Trianon, the terrace of Saint-Germain, Saint-Cloud, and Chantilly. Dr Martin Lister visited him in 1698 and found him "quick and lively[195]."
Le Nostre mourut presque en même temps, après avoir vécu quatre-vingt-huit ans dans une santé parfaite, sa tête et toute la justesse et le bon goût de sa capacité, illustre pour avoir le premier donné les divers dessins de ces beaux jardins qui décorent la France, et qui ont tellement effacé la réputation de ceux d’Italie, qui en effet ne sont plus rien en comparaison, que les plus fameux maîtres en ce genre viennent d’Italie apprendre et admirer ici. Le Nostre avoit une probité, une exactitude et une droiture qui le faisoit estimer et aimer de tout le monde. Jamais il ne sortit de son état ni ne se méconnut, et fut toujours parfaitement désintéressé. Il travailloit pour les particuliers comme pour le Roi, et avec la même application, ne cherchoit qu’à aider la nature, et à réduire le vrai beau aux moins de frais qu’il pouvoit. Il avoit une naïveté et une vérité charmante. Le Pape pria le Roi de le lui prêter pour quelques mois; en entrant dans la chambre du Pape, au lieu de se mettre à genoux, il courut à lui: “Eh! bonjour, lui dit-il, mon Révérend Père, en lui sautant au col, et l’embrassant et le baisant des deux côtés; eh! que vous avez bon visage, et que je suis aise de vous voir, et en si bonne santé!” Le Pape, qui étoit Clément X, Altieri, se mit à rire de tout son cœur; il fut ravi de cette bizarre entrée, et lui fit mille amitiés.
A son retour, le Roi le mena dans ses jardins de Versailles, où il lui montra ce qu’il y avoit fait depuis son absence. A la colonnade, il ne disoit mot; le Roi le pressa d’en dire son avis: “Eh bien! Sire, que voulez-vous que je vous dise? d’un maçon vous avez fait un jardinier (c’étoit Mansart), il vous a donné un plat de son métier.”
144 Le Roi se tut, et chacun sourit; et il étoit vrai que ce morceau d’architecture, qui n’étoit rien moins qu’une fontaine et qui la vouloit être, étoit fort déplacé dans un jardin. Un mois avant sa mort, le Roi, qui aimoit à le voir et à le faire causer[196], le mena dans ses jardins, et à cause de son grand âge, le fit mettre dans une chaise que des porteurs rouloient à côté de la sienne, et le Nostre disoit là: “Ah! mon pauvre père, si tu vivois et que tu pusses voir un pauvre jardinier comme moi, ton fils, se promener en chaise à côté du plus grand roi du monde, rien ne manqueroit à ma joie.” Il étoit intendant des bâtiments, et logeoit aux Tuileries, dont il avoit soin du jardin, qui est de lui, et du palais. Tout ce qu’il a fait est encore fort au-dessus de tout ce qui a été fait depuis, quelque soin qu’on ait pris de l’imiter et de travailler d’après lui le plus qu’il a été possible. Il disoit des parterres qu’ils n’étoient que pour les nourrices, qui, ne pouvant quitter leurs enfants, s’y promenoient des yeux et les admiraient du second étage. Il y excelloit néanmoins, comme dans toutes les parties des jardins; mais il n’en faisoit aucune estime, et il avoit raison, car c’est où on ne se promène jamais[197].
Louis-Joseph, Duc de Vendôme (1654-1712), was the grandson of César, Duc de Vendôme, the son of Henri IV and Gabrielle d’Estrées. Having distinguished himself at Steinkirk and in Piedmont, he was given the command of the army of Catalonia (1695) and the capture of Barcelona by his troops was an important factor in bringing about the peace of Ryswick (1697). In the war of the Spanish Succession he was less successful, but on being sent as general to Spain in 1710 he restored the fallen fortunes of Philip V. Saint-Simon is blinded by prejudice to his very real military talent. His soldiers adored him. See Voltaire, Le siècle de Louis XIV, pp. 209-210, and Boislisle, XIII. 564-567.
Il étoit d’une taille ordinaire pour la hauteur, un peu gros, mais vigoureux, fort et alerte; un visage fort noble et l’air haut, de la grâce naturelle dans le maintien et dans 145 la parole, beaucoup d’esprit naturel, qu’il n’avoit jamais cultivé, une énonciation facile, soutenue d’une hardiesse naturelle, qui se tourna depuis en audace la plus effrénée, beaucoup de connoissance du monde, de la cour, des personnages successifs, et sous une apparente incurie, un soin et une adresse continuelle à en profiter en tout genre; surtout admirable courtisan, et qui sut tirer avantage jusque de ses plus grands vices, à l’abri du foible du Roi pour sa naissance; poli par art, mais avec un choix et une mesure avare, insolent à l’excès dès qu’il crut le pouvoir oser impunément, et, en même temps, familier et populaire avec le commun par une affectation qui voiloit sa vanité, et le faisoit aimer du vulgaire; au fond, l’orgueil même, et un orgueil qui vouloit tout, qui dévoroit tout. A mesure que son rang s’éleva et que sa faveur augmenta, sa hauteur, son peu de ménagement, son opiniâtreté jusqu’à l’entêtement, tout cela crût à proportion, jusqu’à se rendre inutile toute espèce d’avis, et se rendre inaccessible qu’à un nombre très petit de familiers et à ses valets. La louange, puis l’admiration, enfin l’adoration, furent le canal unique par lequel on pût approcher ce demi-dieu, qui soutenoit des thèses ineptes sans que personne osât, non pas contredire, mais ne pas approuver.
Sa paresse étoit à un point qui ne se peut concevoir. Il a pensé être enlevé plus d’une fois pour s’être opiniâtré dans un logement plus commode, mais trop éloigné, et risqué les succès de ses campagnes, donné même des avantages considérables à l’ennemi, par ne se pouvoir résoudre à quitter un camp où il se trouvoit logé à son aise. Il voyoit peu à l’armée par lui-même; il s’en fioit à ses familiers, que très souvent encore il n’en croyoit pas. Sa journée, dont il ne pouvoit troubler l’ordre ordinaire, ne lui permettoit guère de faire autrement. Sa saleté étoit extrême; il en tiroit vanité: les sots le trouvoient un homme simple. Il étoit plein de chiens et de chiennes dans son lit, qui y faisoient leurs petits à ses côtés. Lui-même ne s’y contraignoit de rien. Une de ses thèses étoit que 146 tout le monde en usoit de même, mais n’avoit pas la bonne foi d’en convenir comme lui. Il le soutint un jour à Mme la princesse de Conti, la plus propre personne du monde et la plus recherchée dans sa propreté[198].
Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban (1633-1707), was rewarded in 1703 with a marshal’s bâton for his great services as a military engineer. He was equally skilled in the art of fortifying towns and in that of besieging them.
Vauban s’appeloit le Prestre, petit gentilhomme de Bourgogne tout au plus, mais peut-être le plus honnête homme et le plus vertueux de son siècle, et avec la plus grande réputation du plus savant homme dans l’art des sièges et de la fortification, le plus simple, le plus vrai et le plus modeste. C’étoit un homme de médiocre taille, assez trapu, qui avoit fort l’air de guerre, mais en même temps un extérieur rustre et grossier, pour ne pas dire brutal et féroce. Il n’étoit rien moins; jamais homme plus doux, plus compatissant, plus obligeant, mais respectueux sans nulle politesse, et le plus avare ménager de la vie des hommes, avec une valeur qui prenoit tout sur soi et donnoit tout aux autres. Il est inconcevable qu’avec tant de droiture et de franchise, incapable de se prêter à rien de faux ni de mauvais, il ait pu gagner au point qu’il fit l’amitié et la confiance de Louvois et du Roi.
Ce prince s’étoit ouvert à lui, un an auparavant, de la volonté qu’il avoit de le faire maréchal de France: Vauban l’avoit supplié de faire réflexion que cette dignité n’étoit point faite pour un homme de son état, qui ne pouvoit jamais commander ses armées, et qui les jetteroit dans l’embarras si, faisant un siège, le général se trouvoit moins ancien maréchal de France que lui. Un refus si généreux, et appuyé de raisons que la seule vertu fournissoit, augmenta encore le desir du Roi de la couronner.
Vauban avoit fait cinquante-trois sièges en chef, dont une vingtaine en présence du Roi, qui crut se faire maréchal 147 de France soi-même et honorer ses propres lauriers en donnant le bâton à Vauban. Il le reçut avec la même modestie qu’il avoit marqué de désintéressement. Tout applaudit à ce comble d’honneur, où aucun autre de ce genre n’étoit parvenu avant lui et n’est arrivé depuis. Je n’ajouterai rien ici sur cet homme véritablement fameux; il se trouvera ailleurs occasion d’en parler encore[199].
On a vu quel étoit Vauban, à l’occasion de son élévation à l’office de maréchal de France. Maintenant nous l’allons voir réduit au tombeau par l’amertume de la douleur, pour cela même qui le combla d’honneur, et qui ailleurs qu’en France lui eût tout mérité et acquis.
Patriote comme il l’étoit, il avoit toute sa vie été touché de la misère du peuple et de toutes les vexations qu’il souffroit. La connoissance que ses emplois lui donnoient de la nécessité des dépenses, et du peu d’espérance que le Roi fût pour retrancher celles de splendeur et d’amusements, le faisoit gémir de ne voir point de remède à un accablement qui augmentoit son poids de jour en jour.
Dans cet esprit, il ne fit point de voyage, et il traversoit souvent le royaume de tous les biais, qu’il ne prît partout des informations exactes sur la valeur et le produit des terres, sur la sorte de commerce et d’industrie des provinces et des villes, sur la nature et l’imposition des levées, sur la manière de les percevoir. Non content de ce qu’il pouvoit voir et faire par lui-même, il envoya secrètement partout où il ne pouvoit aller, et même où il avoit été et où il devoit aller, pour être instruit de tout, et comparer les rapports avec ce qu’il auroit connu par lui-même. Les vingt dernières années de sa vie au moins furent employées à ces recherches, auxquelles il dépensa beaucoup. Il les vérifia souvent, avec toute l’exactitude et la justesse qu’il y put apporter, et il excelloit en ces deux qualités. Enfin il se convainquit que les terres étoient le seul bien solide, et il se mit à travailler à un nouveau système.
148 Il étoit bien avancé, lorsqu’il parut divers petits livres du sieur de Boisguilbert[200], lieutenant général au siège de Rouen, homme de beaucoup d’esprit de détail et de travail, frère d’un conseiller au parlement de Normandie, qui de longue main touché des mêmes vues que Vauban, y travailloit aussi depuis longtemps. Il y avoit déjà fait du progrès avant que le Chancelier eût quitté les finances. Il vint exprès le trouver, et comme son esprit vif avoit du singulier, il lui demanda de l’écouter avec patience, et tout de suite lui dit que d’abord il le prendrait pour un fou, qu’ensuite il verroit qu’il méritoit attention, et qu’à la fin il demeureroit content de son système. Pontchartrain, rebuté de tant de donneurs d’avis qui lui avoient passé par les mains, et qui étoit tout salpêtre, se mit à rire, lui répondit brusquement qu’il s’en tenoit au premier, et lui tourna le dos. Boisguilbert, revenu à Rouen, ne se rebuta point du mauvais succès de son voyage; il n’en travailla que plus infatigablement à son projet, qui étoit à peu près le même que celui de Vauban, sans se connoître l’un l’autre. De ce travail naquit un livre savant et profond sur la matière, dont le système alloit à une répartition exacte, à soulager le peuple de tous les frais qu’il supportoit et de beaucoup d’impôts, qui faisoit entrer les levées directement dans la bourse du Roi, et conséquemment, ruineux à l’existence des traitants, à la puissance des intendants, au souverain domaine des ministres des finances. Aussi déplut-il à tous ceux-là autant qu’il fut applaudi de tous ceux qui n’avoient pas les mêmes intérêts. Chamillart, qui avoit succédé à Pontchartrain[201], examina ce livre; il en conçut de l’estime: il manda Boisguilbert deux ou trois fois à l’Étang, et y travailla avec lui à plusieurs reprises, en ministre dont la probité ne cherche que le bien.
En même temps, Vauban, toujours appliqué à son ouvrage, vit celui-ci avec attention, et quelques autres du même auteur qui le suivirent; de là il voulut entretenir 149 Boisguilbert. Peu attaché aux siens, mais ardent pour le soulagement des peuples et pour le bien de l’État, il les retoucha et les perfectionna sur ceux-ci, et y mit la dernière main. Ils convenoient sur les choses principales, mais non en tout.
Boisguilbert vouloit laisser quelques impôts sur le commerce étranger et sur les denrées à la manière de Hollande, et s’attachoit principalement à ôter les plus odieux, et surtout les frais immenses, qui, sans entrer dans les coffres du Roi, ruinoient les peuples à la discrétion des traitants et de leurs employés, qui s’y enrichissoient sans mesure, comme cela est encore aujourd’hui et n’a fait qu’augmenter sans avoir jamais cessé depuis.
Vauban, d’accord sur ces suppressions, passoit jusqu’à celle des impôts mêmes: il prétendoit n’en laisser qu’un unique, et avec cette simplification remplir également leurs vues communes sans tomber en aucun inconvénient. Il avoit l’avantage sur Boisguilbert de tout ce qu’il avoit examiné, pesé, comparé et calculé lui-même, en ses divers voyages, depuis vingt ans, de ce qu’il avoit tiré du travail de ceux que, dans le même esprit, il avoit envoyés depuis plusieurs années en diverses provinces, toutes choses que Boisguilbert, sédentaire à Rouen, n’avoit pu se proposer, et l’avantage encore de se rectifier par les lumières et les ouvrages de celui-ci; par quoi il avoit raison de se flatter de le surpasser en exactitude et en justesse, base fondamentale de pareille besogne. Vauban donc abolissoit toutes sortes d’impôts auxquels il en substituoit un unique, divisé en deux branches, auxquelles il donnoit le nom de dîme royale: l’une sur les terres, par un dixième de leur produit; l’autre léger, par estimation, sur le commerce et l’industrie, qu’il estimoit devoir être encouragés l’un et l’autre, bien loin d’être accablés. Il prescrivoit des règles très simples, très sages et très faciles pour la levée et la perception de ces deux droits, suivant la valeur de chaque terre, et par rapport au nombre d’hommes sur lequel on peut compter avec le plus d’exactitude dans l’étendue du royaume. Il ajouta la comparaison de la répartition 150 en usage avec celle qu’il proposoit, les inconvénients de l’une et de l’autre, et réciproquement leurs avantages, et conclut par des preuves en faveur de la sienne, d’une netteté et d’une évidence à ne s’y pouvoir refuser. Aussi cet ouvrage[202] reçut-il les applaudissements publics, et l’approbation des personnes les plus capables de ces calculs et de ces comparaisons et les plus versées en toutes ces matières, qui en admirèrent la profondeur, la justesse, l’exactitude et la clarté.
Mais ce livre avoit un grand défaut: il donnoit à la vérité au Roi plus qu’il ne tiroit par les voies jusqu’alors pratiquées, il sauvoit aussi les peuples de ruine et de vexations, et les enrichissoit en leur laissant tout ce qui n’entroit point dans les coffres du Roi, à peu de choses près; mais il ruinoit une armée de financiers, de commis, d’employés de toute espèce, il les réduisoit à chercher à vivre à leurs dépens, et non plus à ceux du public, et il sapoit par les fondements ces fortunes immenses qu’on voit naître en si peu de temps. C’étoit déjà de quoi échouer.
Mais le crime fut qu’avec cette nouvelle pratique tomboit l’autorité du contrôleur général, sa faveur, sa fortune, sa toute-puissance, et, par proportion, celles des intendants des finances, des intendants de provinces, de leurs secrétaires, de leurs commis, de leurs protégés, qui ne pouvoient plus faire valoir leur capacité et leur industrie, leurs lumières et leur crédit, et qui de plus tomboient du même coup dans l’impuissance de faire du bien ou du mal à personne. Il n’est donc pas surprenant que tant de gens si puissants en tout genre, à qui ce livre arrachoit tout des mains, ne conspirassent contre un système si utile à l’État, si heureux pour le Roi, si avantageux aux peuples du royaume, mais si ruineux pour eux. La robe entière en rugit pour son intérêt: elle est la modératrice des impôts par les places qui en regardent toutes les sortes d’administration, et qui lui sont affectées privativement à tous 151 autres, et elle se le croit en corps avec plus d’éclat par la nécessité de l’enregistrement des édits bursaux.
Les liens du sang fascinèrent les yeux aux deux gendres de M. Colbert[203], de l’esprit et du gouvernement duquel ce livre s’écartoit fort, et furent trompés par les raisonnements vifs et captieux de Desmaretz[204], dans la capacité duquel ils avoient toute confiance, comme au disciple unique de Colbert son oncle, qui l’avoit élevé et instruit; Chamillart, si doux, si amoureux du bien, et qui n’avoit pas, comme on l’a vu, négligé de travailler avec Boisguilbert, tomba sous la même séduction de Desmaretz. Le Chancelier, qui se sentoit toujours d’avoir été, quoique malgré lui, contrôleur général des finances, s’emporta. En un mot, il n’y eut que les impuissants et les désintéressés pour Vauban et Boisguilbert, je veux dire l’Église et la noblesse; car pour les peuples, qui y gagnoient tout, ils ignorèrent qu’ils avoient touché à leur salut, que les bons bourgeois seuls déplorèrent.
Ce ne fut donc pas merveilles si le Roi, prévenu et investi de la sorte, reçut très mal le maréchal de Vauban lorsqu’il lui présenta son livre[205], qui lui étoit adressé dans tout le contenu de l’ouvrage. On peut juger si les ministres à qui il le présenta lui firent un meilleur accueil. De ce moment, ses services, sa capacité militaire, unique en son genre, ses vertus, l’affection que le Roi y avoit mise, jusqu’à croire se couronner de lauriers en l’élevant, tout disparut à l’instant à ses yeux: il ne vit plus en lui qu’un insensé pour l’amour du public, et qu’un criminel qui attentoit à l’autorité de ses ministres, par conséquent à la sienne; il s’en expliqua de la sorte sans ménagement.
L’écho en retentit plus aigrement encore dans toute la nation offensée, qui abusa sans aucun ménagement de sa 152 victoire; et le malheureux maréchal, porté dans tous les cœurs françois, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître, pour qui il avoit tout fait, et mourut peu de mois après, ne voyant plus personne, consommé de douleur et d’une affliction que rien ne put adoucir, et à laquelle le Roi fut insensible, jusqu’à ne pas faire semblant de s’apercevoir qu’il eût perdu un serviteur si utile et si illustre. Il n’en fut pas moins célébré par toute l’Europe, et par les ennemis mêmes, ni moins regretté en France de tout ce qui n’étoit pas financier ou suppôts de financiers[206].
Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, Marquis and afterwards Duc d’Antin (1665-1736), was the son of M. and Mme de Montespan. He was the type of a perfect courtier, but it was not till 1707, after paying court assiduously for twenty-five years, that he succeeded in winning the favour of Louis XIV who conferred on him the governorship of Orleans. “Me voilà dégelé!” On the death of J.-H. Mansard he became Superintendent of the royal buildings. See XII. 239, and Sainte-Beuve, Caus. du Lundi, V. 478 ff.
Né avec beaucoup d’esprit naturel, il tenoit de ce langage charmant de sa mère et du gascon de son père, mais avec un tour et des grâces naturelles qui prévenoient toujours. Beau comme le jour étant jeune, il en conserva de grands restes jusqu’à la fin de sa vie, mais une beauté mâle et une physionomie d’esprit. Personne n’avoit ni plus d’agréments, de mémoire, de lumière, de connoissance des hommes et de chacun, d’art et de ménagement pour savoir les prendre, plaire, s’insinuer, et parler toutes sortes de langages; beaucoup de connoissances et des talents sans nombre, qui le rendoient propre à tout, avec quelque lecture. Un corps robuste, et qui sans peine fournissoit à tout, répondoit au génie, et quoique peu à peu devenu fort gros, il ne lui refusoit ni veilles ni fatigues. Brutal par tempérament, doux, poli par jugement, accueillant, empressé à plaire, jamais il ne lui arrivoit de dire mal de 153 personne. Il sacrifia tout à l’ambition et aux richesses, quoique prodigue, et fut le plus habile et le plus raffiné courtisan de son temps, comme le plus incompréhensiblement assidu: application sans relâche, fatigues incroyables pour se trouver partout à la fois, assiduité prodigieuse en tous lieux différents, soins sans nombre, vues en tout, et cent à la fois, adresses, souplesses, flatteries sans mesure, attention continuelle et à laquelle rien n’échappoit, bassesses infinies, rien ne lui coûta, rien ne le rebuta vingt ans durant, sans aucun autre succès que la familiarité qu’usurpoit sa gasconne impudence, avec des gens que tout lui persuadoit avec raison qu’il falloit violer quand on étoit à portée de le pouvoir. Aussi n’y avoit-il pas manqué avec Monseigneur, dont il étoit menin[207], et duquel son mariage l’avoit fort approché: il avoit épousé la fille aînée du duc d’Uzès[208] et de la fille unique du duc de Montausier, dont la conduite obscure et peu régulière ne l’empêcha jamais de vivre avec elle et avec tous les siens avec une considération très marquée, et prenant une grande part à eux tous, ainsi qu’à ceux de la maison de sa mère. Sa table, ses équipages, toute sa dépense étoit prodigieuse, et la fut dans tous les temps. Son jeu furieux le fit subsister longtemps: il y étoit prompt, exact en comptes, bon payeur, sans incidents, les jouoit tous fort bien, heureux à ceux de hasard, et avec tout cela, fort accusé d’aider la fortune.
Sa servitude fut extrême à l’égard des enfants de sa mère, sa patience infinie aux rebuts. On a vu celui qu’ils essuyèrent pour lui, lorsqu’à la mort de son père ils demandèrent tous au Roi de le faire duc, et si le dénouement qui se verra bientôt n’eût découvert ce qui avoit rendu tant d’années et de ressorts inutiles, on ne pourrait le concevoir. On a vu comment sa mère lui fit quitter solennellement le jeu en lui assurant une pension de dix mille 154 écus, combien le Roi trouva ridicule l’éclat de la profession qu’il en fit, et comment peu à peu il le reprit, deux ans après, tout aussi gros qu’auparavant. Une autre disparate qu’il fit pendant cette abstinence de jeu lui réussit tout aussi mal: il se mit dans la dévotion, dans les jeûnes, qu’il ne laissoit pas ignorer, et qui durent coûter à sa gourmandise et à son furieux appétit; il affecta d’aller tous les jours à la messe, et une régularité extérieure. Il soutint cette tentative près de deux ans; à la fin, la voyant sans succès, il s’en lassa, et peu à peu, avec le jeu, il reprit son premier genre de vie. Avec de tels défauts si reconnus, il en eut un plus malheureux que coupable, puisqu’il ne dépendoit pas de lui, dont il souffrit plus que de pas un: c’étoit une poltronnerie, mais telle, qu’il est incroyable ce qu’il faut qu’il ait pris sur lui pour avoir servi si longtemps. Il en a reçu en sa vie force affronts, avec une dissimulation sans exemple. Monsieur le Duc, méchant jusqu’à la barbarie, étant de jour au bombardement de Bruxelles, le fit venir à la tranchée pour dîner avec lui; aussitôt il donna le mot, mit toute la tranchée dans la confidence, et un peu après s’être mis à table, voilà une vive alarme, une grande sortie des ennemis, et tout l’appareil d’un combat chaud et imminent. Quand Monsieur le Duc[209] s’en fut assez diverti, il regarda d’Antin: “Remettons-nous à table, lui dit-il; la sortie n’étoit que pour toi.” D’Antin s’y remit sans s’en émouvoir, et il n’y parut pas.
Une autre fois, M. le prince de Conti, qui ne l’aimoit pas, à cause de M. du Maine et de M. de Vendôme[210], visitoit des postes à je ne sais plus quel siège, et trouva d’Antin dans un assez avancé. Le voilà à faire ses grands rires, qui lui cria: “Comment, d’Antin, te voilà ici et tu n’es pas encore mort!” Cela fut avalé avec tranquillité, et sans changer de conduite avec ces deux princes, qu’il voyoit très familièrement. La Feuillade[211], fort envieux et 155 fort avantageux, lui fit une incartade aussi gratuite que ces deux-là. Il étoit à Meudon, à deux pas de Monseigneur, dans la même pièce. Je ne sais sur quoi on vint à parler de grenadiers, ni ce que dit d’Antin, qui forma une dispute fort légère, et plutôt matière de conversation. Tout d’un coup: “C’est bien à vous, lui dit la Feuillade en élevant le ton, à parler de grenadiers! et où en auriez-vous vu?” D’Antin voulut répondre: “Et moi, interrompit la Feuillade, j’en ai vu souvent en des endroits dont vous n’auriez osé approcher de bien loin.” D’Antin se tut, et la compagnie resta stupéfaite. Monseigneur, qui l’entendit, n’en fit pas semblant, et dit après que, s’il avoit témoigné l’avoir ouï, il n’avoit plus de parti à prendre que celui de faire jeter la Feuillade par les fenêtres, pour un si grand manque de respect en sa présence. Cela passa doux comme lait, et il n’en fut autre chose. En un mot, il étoit devenu honteux d’insulter d’Antin.
Il faut convenir que c’étoit grand dommage qu’il eût un défaut si infamant, sans lequel on eût peut-être difficilement trouvé un homme plus propre que lui à commander les armées: il avoit les vues vastes, justes, exactes, de grandes parties de général, un talent singulier pour les marches, les détails de troupes, de fourrages, de subsistances, pour tout ce qui fait le meilleur intendant d’armée, pour la discipline, sans pédanterie et allant droit au but et au fait, une soif d’être instruit de tout, qui lui donnoit une peine infinie et lui coûtoit cher en espions. Ces qualités le rendoient extrêmement commode à un général d’armée; le maréchal de Villeroy et M. de Vendôme s’en sont très utilement servis. Il avoit toujours un dessinateur ou deux, qui prenoient tant qu’ils pouvoient les plans des pays, des marches, des camps, des fourrages et de ce 156 qu’ils pouvoient de l’armée des ennemis. Avec tant de vues, de soins, d’applications différentes à la cour et à la guerre, toujours à soi, toujours la tête libre et fraîche, despotique sur son corps et sur son esprit, d’une société charmante, sans tracasserie, sans embarras, avec de la gaieté et un agrément tout particulier, affable aux officiers, aimable aux troupes, à qui il étoit prodigue avec art et avec goût, naturellement éloquent et parlant à chacun sa propre langue, aisé en tout, aplanissant tout, fécond en expédients et capable à fond de toutes sortes d’affaires, c’étoit un homme certainement très rare. Cette raison m’a fait étendre sur lui, et il est bon de faire connoître d’avance ce courtisan, jusqu’ici si délaissé, qui va devenir un personnage pour le reste de sa vie. Fait et demeuré comme il étoit, il n’est pas surprenant qu’il ait eu autant d’envie de s’accrocher aux Noailles. Le surprenant est que sa mère y ait non-seulement consenti, mais qu’elle l’ait desiré plus que lui encore, avec sa retraite et sa dévotion véritable, pour se rapprocher Mme de Maintenon, qu’elle avoit tant de raisons de haïr et de se la croire irréconciliable. Elle lui écrivit plusieurs lettres flatteuses à l’occasion de ce mariage; elle n’en reçut que des réponses sèches, et néanmoins fit tout pour le conclure, dans le dessein de lui plaire, tant sont fortes les chaînes du monde, auquel trop souvent on croit de bonne foi avoir entièrement renoncé, et que cependant, malgré tout ce qu’on en a éprouvé, il se trouve qu’on y tient encore[212].
François-Louis de Bourbon (1664-1709), younger son of Armand, Prince de Conti, and nephew of the great Condé, inherited his father’s title on the death of his elder brother in 1685. He fought with distinction at Fleurus, Steinkirk, and Neerwinden. In 1697 he was elected King of Poland, but, being unable to maintain himself against his rival the Elector of Saxony, he renounced his claim and returned to France. Louis XIV, who was jealous of his brilliance and capacity, regarded him with disfavour, but just before his last illness he was appointed to the command of the army in Flanders. He married his cousin, a daughter of Henri-Jules, Prince de Condé.
Sa figure avoit été charmante; jusqu’aux défauts de son corps et de son esprit avoient des grâces infinies; des épaules trop hautes, la tête un peu penchée de côté, un rire qui eût tenu du braire dans un autre, enfin une distraction étrange. Galant avec toutes les femmes, amoureux de plusieurs, bien traité de beaucoup, il étoit encore coquet avec tous les hommes: il prenoit à tâche de plaire au cordonnier, au laquais, au porteur de chaise, comme au ministre d’État, au grand seigneur, au général d’armée, et si naturellement que le succès en étoit certain. Il fut aussi les constantes délices du monde, de la cour, des armées, la divinité du peuple, l’idole des soldats, le héros des officiers, l’espérance de ce qu’il y avoit de plus distingué, l’amour du Parlement, l’ami avec discernement des savants, et souvent l’admiration de la Sorbonne, des jurisconsultes, des astronomes et des mathématiciens les plus profonds. C’étoit un très bel esprit, lumineux, juste, exact, vaste, étendu, d’une lecture infinie, qui n’oublioit rien, qui possédoit les histoires générales et particulières, qui connoissoit les généalogies, leurs chimères et leurs réalités, qui savoit où il avoit appris chaque chose et chaque fait, qui en discernoit les sources, et qui retenoit et jugeoit de même tout ce que la conversation lui avoit appris, sans confusion, sans mélange, sans méprise, avec une singulière netteté[213].
158 M. de Montausier et Monsieur de Meaux, qui l’avoient vu élever auprès de Monseigneur, l’avoient toujours aimé avec tendresse, et lui eux avec confiance; il étoit de même avec les ducs de Chevreuse et de Beauvillier, et avec l’archevêque de Cambray[214] et les cardinaux d’Estrées[215] et de Janson[216]. Monsieur le Prince le héros ne se cachoit pas d’une prédilection pour lui au-dessus de ses enfants; il fut la consolation de ses dernières années, il s’instruisit dans son exil et sa retraite auprès de lui, il écrivit sous lui beaucoup de choses curieuses. Il fut le cœur et le confident de M. de Luxembourg dans ses dernières années.
Chez lui l’utile et le futile, l’agréable et le savant, tout étoit distinct et en sa place. Il avoit des amis: il savoit les choisir, les cultiver, les visiter, vivre avec eux, se mettre à leur niveau sans hauteur et sans bassesse. Il avoit aussi des amies indépendamment d’amour; il en fut accusé de plus d’une sorte, et c’étoit un de ses prétendus rapports avec César. Doux jusqu’à être complaisant dans le commerce, extrêmement poli, mais d’une politesse distinguée selon le rang, l’âge, le mérite, et mesuré avec tous, il ne déroboit rien à personne; il rendoit tout ce que les princes du sang doivent, et qu’ils ne rendent plus; il s’en expliquoit même et sur leurs usurpations et sur l’histoire des usages et de leurs altérations. L’histoire des livres et des conversations lui fournissoit de quoi placer, avec un art imperceptible, ce qu’il pouvoit de plus obligeant sur la naissance, les emplois, les actions. Son esprit étoit naturel, brillant, vif, ses reparties promptes, plaisantes, jamais blessantes, le gracieux répandu partout, sans affectation; avec toute la futilité du monde, de la cour, des femmes, et leur langage avec elles, l’esprit solide et infiniment 159 sensé; il en donnoit à tout le monde, il se mettoit sans cesse et merveilleusement à la portée et au niveau de tous, et parloit le langage de chacun avec une facilité nonpareille. Tout en lui prenoit un air aisé. Il avoit la valeur des héros, leur maintien à la guerre, leur simplicité partout, qui toutefois cachoit beaucoup d’art. Les marques de leurs talents pourroient passer pour le dernier coup de pinceau de son portrait; mais, comme tous les hommes, il avoit sa contre-partie.
Cet homme si aimable, si charmant, si délicieux, n’aimoit rien. Il avoit et vouloit des amis, comme on veut et qu’on a des meubles. Encore qu’il se respectât, il étoit bas courtisan; il ménageoit tout, et montroit trop combien il sentoit ses besoins en tous genres de choses et d’hommes; avare, avide de bien, ardent, injuste.
Le Roi étoit véritablement peiné de la considération qu’il ne pouvoit lui refuser, et qu’il étoit exact à n’outrepasser pas d’une ligne. Il ne lui avoit jamais pardonné son voyage d’Hongrie[217]. Les lettres interceptées qui lui avoient été écrites et qui avoient perdu les écrivains, quoique fils de favoris, avoient allumé une haine dans Mme de Maintenon et une indignation dans le Roi que rien n’avoit pu effacer. Les vertus, les talents, les agréments, la grande réputation que ce prince s’étoit acquise, l’amour général qu’il s’étoit concilié lui étoient tournés en crimes. Le contraste de M. du Maine excitoit un dépit journalier dans sa gouvernante et dans son tendre père, qui leur échappoit malgré eux. Enfin la pureté de son sang, le seul qui ne fut point mêlé avec la bâtardise, étoit un autre démérite qui se faisoit sentir à tous moments. Jusqu’à ses amis étoient odieux, et le sentoient.
Toutefois, malgré la crainte servile, les courtisans mêmes aimoient à s’approcher de ce prince: on étoit flatté d’un accès familier auprès de lui; le monde le plus important, le plus choisi, le couroit; jusque dans le salon de Marly il étoit environné du plus exquis; il y tenoit des 160 conversations charmantes sur tout ce qui se présentoit indifféremment; jeunes et vieux y trouvoient leur instruction et leur plaisir, par l’agrément avec lequel il s’énonçoit sur toutes matières, par la netteté de sa mémoire, par son abondance sans être parleur. Ce n’est point une figure, c’est une vérité cent fois éprouvée, qu’on y oublioit l’heure des repas. Le Roi le savoit; il en étoit piqué, quelquefois même il n’étoit pas fâché qu’on pût s’en apercevoir. Avec tout cela on ne pouvoit s’en déprendre; la servitude si régnante jusque sur les moindres choses y échoua toujours.
Jamais homme n’eut tant d’art caché sous une simplicité si naïve, sans quoi que ce soit d’affecté en rien. Tout en lui couloit de source; jamais rien de tiré, de recherché; rien ne lui coûtoit. On n’ignoroit pas qu’il n’aimoit rien, ni ses autres défauts; on les lui passoit tous, et on l’aimoit véritablement, quelquefois jusqu’à se le reprocher, toujours sans s’en corriger[218].
Marie-Adelaïde of Savoy, grand-daughter of Monsieur and Henrietta of England, came to France in 1696 shortly before her eleventh birthday, and was married to the Duc de Bourgogne a year later. She died of measles on February 12, 1712. There is a good bust of her by Coysevox at Versailles.
Jamais princesse arrivée si jeune ne vint si bien instruite, et ne sut mieux profiter des instructions qu’elle avoit reçues. Son habile père qui connoissoit à fond notre cour, la lui avoit peinte, et lui avoit appris la manière unique de s’y rendre heureuse. Beaucoup d’esprit naturel 161 et facile l’y seconda, et beaucoup de qualités aimables lui attachèrent les cœurs, tandis que sa situation personnelle avec son époux, avec le Roi, avec Mme de Maintenon lui attira les hommages de l’ambition. Elle avoit su travailler à s’y mettre dès les premiers moments de son arrivée; elle ne cessa, tant qu’elle vécut, de continuer un travail si utile, et dont elle recueillit sans cesse tous les fruits. Douce, timide, mais adroite, bonne jusqu’à craindre de faire la moindre peine à personne, et toute légère et vive qu’elle étoit, très capable de vues et de suite de la plus longue haleine; la contrainte jusqu’à la gêne, dont elle sentoit tout le poids, sembloit ne lui rien coûter. La complaisance lui étoit naturelle, couloit de source; elle en avoit jusque pour sa cour.
Régulièrement laide, les joues pendantes, le front trop avancé, un nez qui ne disoit rien, de grosses lèvres mordantes, des cheveux et des sourcils châtain brun, fort bien plantés, des yeux les plus parlants et les plus beaux du monde, peu de dents et toutes pourries, dont elle parloit et se moquoit la première, le plus beau teint et la plus belle peau, peu de gorge, mais admirable, le cou long, avec un soupçon de goître qui ne lui seyoit point mal, un port de tête galant, gracieux, majestueux, et le regard de même, le sourire le plus expressif, une taille longue, ronde, menue, aisée, parfaitement coupée, une marche de déesse sur les nuées. Elle plaisoit au dernier point; les grâces naissoient d’elles-mêmes de tous ses pas, de toutes ses manières, et de ses discours les plus communs. Un air simple et naturel toujours, naïf assez souvent, mais assaisonné d’esprit, charmoit, avec cette aisance qui étoit en elle jusqu’à la communiquer à tout ce qui l’approchoit.
Elle vouloit plaire même aux personnes les plus inutiles et les plus médiocres, sans qu’elle parût le rechercher. On étoit tenté de la croire toute et uniquement à celles avec qui elle se trouvoit. Sa gaieté, jeune, vive, active, animoit tout, et sa légèreté de nymphe la portoit partout, comme un tourbillon qui remplit plusieurs lieux à la fois, et qui y donne le mouvement et la vie. Elle ornoit tous 162 les spectacles, étoit l’âme des fêtes, des plaisirs, des bals, et y ravissoit par les grâces, la justesse et la perfection de sa danse. Elle aimoit le jeu, s’amusoit au petit jeu, car tout l’amusoit; elle préféroit le gros, y étoit nette, exacte, la plus belle joueuse du monde, et en un instant faisoit le jeu de chacun; également gaie et amusée à faire, les après-dînées, des lectures sérieuses, à converser dessus, et à travailler avec ses dames sérieuses: on appeloit ainsi ses dames du palais les plus âgées. Elle n’épargna rien, jusqu’à sa santé, elle n’oublia pas jusqu’aux plus petites choses, et sans cesse, pour gagner Mme de Maintenon, et le Roi par elle. Sa souplesse à leur égard étoit sans pareille, et ne se démentit jamais d’un moment. Elle l’accompagnoit de toute la discrétion que lui donnoit la connoissance d’eux, que l’étude et l’expérience lui avoient acquise, pour les degrés d’enjouement ou de mesure qui étoient à propos. Son plaisir, ses agréments, je le répète, sa santé même, tout leur fut immolé. Par cette voie elle s’acquit une familiarité avec eux dont aucun des enfants du Roi, non pas même ses bâtards, n’avoient pu approcher.
En public, sérieuse, mesurée, respectueuse avec le Roi, et en timide bienséance avec Mme de Maintenon, qu’elle n’appeloit jamais que ma tante, pour confondre joliment le rang et l’amitié; en particulier, causante, sautante, voltigeante autour d’eux, tantôt perchée sur le bras du fauteuil de l’un ou de l’autre, tantôt se jouant sur leurs genoux, elle leur sautoit au col, les embrassoit, les baisoit, les caressoit, les chiffonnoit, leur tiroit le dessous du menton, les tourmentoit, fouilloit leurs tables, leurs papiers, leurs lettres, les décachetoit, les lisoit quelquefois malgré eux, selon qu’elle les voyoit en humeur d’en rire, et parlant quelquefois dessus; admise à tout, à la réception des courriers qui apportoient les nouvelles les plus importantes, entrant chez le Roi à toute heure, même des moments pendant le conseil, utile et fatale aux ministres mêmes, mais toujours portée à obliger, à servir, à excuser, à bien faire, à moins qu’elle ne fût violemment poussée contre quelqu’un, comme elle fut contre Pontchartrain, 163 qu’elle nommoit quelquefois au Roi votre vilain borgne, ou par quelque cause majeure, comme elle la fut contre Chamillart; si libre, qu’entendant un soir le Roi et Mme de Maintenon parler avec affection de la cour d’Angleterre dans les commencements qu’on espéra la paix par la reine Anne: “Ma tante, se mit-elle à dire, il faut convenir qu’en Angleterre les reines gouvernent mieux que les rois, et savez-vous bien pourquoi, ma tante?” et toujours courant et gambadant, “c’est que sous les rois ce sont les femmes qui gouvernent, et ce sont les hommes sous les reines.” L’admirable est qu’ils en rirent tous deux, et qu’ils trouvèrent qu’elle avoit raison.
Avec toute cette galanterie, jamais femme ne parut se soucier moins de sa figure, ni y prendre moins de précaution et de soin: sa toilette étoit faite en un moment; le peu même qu’elle duroit n’étoit que pour la cour. Elle ne se soucioit de parure que pour les bals et les fêtes, et ce qu’elle en prenoit en tout autre temps, et le moins encore qu’il lui étoit possible, n’étoit que par complaisance pour le Roi. Avec elle s’éclipsèrent joie, plaisirs, amusements mêmes, et toutes espèces de grâces; les ténèbres couvrirent toute la surface de la cour. Elle l’animoit toute entière; elle en remplissoit tous les lieux à la fois; elle y occupoit tout, elle en pénétroit tout l’intérieur; si la cour subsista après elle, ce ne fut plus que pour languir. Jamais princesse si regrettée, jamais il n’en fut si digne de l’être. Aussi les regrets n’en ont-ils pu passer, et l’amertume involontaire et secrète en est constamment demeurée, avec un vuide affreux qui n’a pu être diminué.
Monseigneur le Dauphin, malade et navré de la plus intime et de la plus amère douleur, ne sortit point de son appartement, où il ne voulut voir que Monsieur son frère, son confesseur, et le duc de Beauvillier, qui malade depuis sept ou huit jours dans sa maison de la ville, fit un effort pour sortir de son lit, pour aller admirer dans son pupille tout ce que Dieu y avoit mis de grand, qui ne parut jamais 164 tant qu’en cette affreuse journée et en celles qui suivirent jusqu’à sa mort. Ce fut, sans s’en douter, la dernière fois qu’ils se virent en ce monde. Cheverny[219], d’O[220] et Gamaches[221] passèrent la nuit dans son appartement, mais sans le voir que des instants.
Le samedi matin 13 février, ils le pressèrent de s’en aller à Marly, pour lui épargner l’horreur du bruit qu’il pouvoit entendre sur sa tête, où la Dauphine étoit morte. Il sortit à sept heures du matin, par une porte de derrière de son appartement, où il se jeta dans une chaise bleue qui le porta à son carrosse. Il trouva, en entrant dans l’une et dans l’autre, quelques courtisans plus indiscrets encore qu’éveillés, qui lui firent leur révérence, et qu’il reçut avec un air de politesse. Ces trois menins[222] vinrent dans son carrosse avec lui. Il descendit à la chapelle, entendit la messe, d’où il se fit porter en chaise à une fenêtre de son appartement, par où il entra. Mme de Maintenon y vint aussitôt: on peut juger quelle fut l’angoisse de cette entrevue; elle ne put y tenir longtemps, et s’en retourna. Il lui fallut essuyer princes et princesses, qui par discrétion n’y furent que des moments, même Mme la duchesse de Berry et Mme de Saint-Simon avec elle, vers qui le Dauphin se tourna avec un air expressif de leur commune douleur. Il demeura quelque temps seul avec M. le duc de Berry. Le réveil du Roi approchant, ses trois menins entrèrent, et j’hasardai d’entrer avec eux. Il me montra qu’il s’en apercevoit, avec un air de douceur et d’affection qui me pénétra; mais je fus épouvanté de son regard, également contraint, fixe, avec quelque chose de farouche, du changement de son visage, et des marques plus livides que rougeâtres que j’y remarquai en assez grand nombre et assez larges, et dont ce qui étoit dans la chambre s’aperçut comme moi. Il étoit debout, et peu d’instants après on le vint avertir que le Roi étoit éveillé. Les larmes, qu’il retenoit, lui rouloient dans les yeux. 165 A cette nouvelle il se tourna sans rien dire, et demeura. Il n’y avoit que ses trois menins et moi, et du Chesne[223]; les menins lui proposèrent une fois ou deux d’aller chez le Roi: il ne remua ni ne répondit. Je m’approchai, et je lui fis signe d’aller, puis je lui proposai à voix basse. Voyant qu’il demeuroit et se taisoit, j’osai lui prendre le bras, lui représenter que tôt ou tard il falloit bien qu’il vît le Roi, qu’il l’attendoit, et sûrement avec desir de le voir et de l’embrasser, qu’il y avoit plus de grâce à ne pas différer; et en le pressant de la sorte, je pris la liberté de le pousser doucement. Il me jeta un regard à percer l’âme, et partit. Je le suivis quelques pas, et m’ôtai de là pour prendre haleine. Je ne l’ai pas vu depuis. Plaise à la miséricorde de Dieu que je le voie éternellement où sa bonté sans doute l’a mis[224]!
The disquieting symptoms which Saint-Simon had noticed in the Duc de Bourgogne rapidly developed into an attack of measles, which proved fatal on February 18, six days after the death of his wife.
Ce prince, héritier nécessaire, puis présomptif, de la couronne, naquit terrible, et sa première jeunesse fit trembler. Dur et colère jusqu’aux derniers emportements, et jusque contre les choses inanimées; impétueux avec fureur, incapable de souffrir la moindre résistance, même des heures et des éléments, sans entrer en des fougues à faire craindre que tout ne se rompît dans son corps; opiniâtre à l’excès; passionné pour toute espèce de volupté, et des femmes, et ce qui est rare à la fois, avec un autre penchant tout aussi fort. Il n’aimoit pas moins le vin, la bonne chère, la chasse avec fureur, la musique avec une sorte de ravissement, et le jeu encore, où il ne pouvoit supporter d’être vaincu, et où le danger avec lui étoit extrême. Enfin livré à toutes les passions et transporté de tous les plaisirs; souvent farouche, naturellement porté à la cruauté; barbare en railleries et à produire les ridicules 166 avec une justesse qui assommoit. De la hauteur des cieux il ne regardoit les hommes que comme des atomes avec qui il n’avoit aucune ressemblance quels qu’ils fussent. A peine Messieurs ses frères lui paroissoient-ils intermédiaires entre lui et le genre humain, quoique on [eût] toujours affecté de les élever tous trois ensemble dans une égalité parfaite. L’esprit, la pénétration brilloient en lui de toutes parts: jusque dans ses furies ses réponses étonnoient; ses raisonnements tendoient toujours au juste et au profond, même dans ses emportements. Il se jouoit des connoissances les plus abstraites. L’étendue et la vivacité de son esprit étoient prodigieuses, et l’empêchoient de s’appliquer à une seule chose à la fois, jusqu’à l’en rendre incapable. La nécessité de le laisser dessiner en étudiant, à quoi il avoit beaucoup de goût et d’adresse, et sans quoi son étude étoit infructueuse, a peut-être beaucoup nui à sa taille.
Il étoit plutôt petit que grand, le visage long et brun, le haut parfait, avec les plus beaux yeux du monde, un regard vif, touchant, frappant, admirable, assez ordinairement doux, toujours perçant, et une physionomie agréable, haute, fine, spirituelle jusqu’à inspirer de l’esprit; le bas du visage assez pointu, et le nez long, élevé, mais point beau, n’alloit pas si bien; des cheveux châtains si crépus et en telle quantité qu’ils bouffoient à l’excès; les lèvres et la bouche agréables quand il ne parloit point, mais quoique ses dents ne fussent pas vilaines, le râtelier supérieur s’avançoit trop, et emboîtoit presque celui de dessous, ce qui, en parlant et en riant, faisoit un effet désagréable. Il avoit les plus belles jambes et les plus beaux pieds qu’après le Roi j’aie jamais vues à personne, mais trop longues, aussi bien que ses cuisses, pour la proportion de son corps. Il sortit droit d’entre les mains des femmes. On s’aperçut de bonne heure que sa taille commençoit à tourner; on employa aussitôt et longtemps le collier et la croix de fer, qu’il portoit tant qu’il étoit dans son appartement, même devant le monde, et on n’oublia aucun des jeux et des exercices propres à le redresser. La nature 167 demeura la plus forte: il devint bossu, mais si particulièrement d’une épaule qu’il en fut enfin boiteux, non qu’il n’eût les cuisses et les jambes parfaitement égales, mais parce qu’à mesure que cette épaule grossit, il n’y eut plus, des deux hanches jusqu’aux deux pieds, la même distance, et au lieu d’être à plomb, il pencha d’un côté. Il n’en marchoit ni moins aisément, ni moins longtemps, ni moins vite, ni moins volontiers, et il n’en aima pas moins la promenade à pied, et à monter à cheval, quoique il y fût très mal. Ce qui doit surprendre, c’est qu’avec des yeux, tant d’esprit si élevé, et parvenu à la vertu la plus extraordinaire et à la plus éminente et la plus solide piété, ce prince ne se vit jamais tel qu’il étoit pour sa taille, ou ne s’y accoutuma jamais: c’étoit une foiblesse qui mettoit en garde contre les distractions et les indiscrétions, et qui donnoit de la peine à ceux de ses gens qui, dans son habillement et dans l’arrangement de ses cheveux, masquoient ce défaut naturel le plus qu’il leur étoit possible, mais bien en garde de lui laisser sentir qu’ils aperçussent ce qui étoit si visible. Il en faut conclure qu’il n’est pas donné à l’homme d’être ici-bas exactement parfait.
Tant d’esprit, et une telle sorte d’esprit, joint à une telle vivacité, à une telle sensibilité, à de telles passions, et toutes si ardentes, n’étoit pas d’une éducation facile. Le duc de Beauvillier, qui en sentoit également les difficultés et les conséquences, s’y surpassa lui-même par son application, sa patience, la variété des remèdes. Peu aidé par les sous-gouverneurs, il se secourut de tout ce qu’il trouva sous sa main. Fénelon, Fleury[225], sous-précepteur, qui a donné une si belle Histoire de l’Église, quelques gentilshommes de la manche, Moreau, premier valet de chambre, fort au-dessus de son état sans se méconnoître, quelques rares valets de l’intérieur, le duc de Chevreuse 168 seul du dehors, tous mis en œuvre, et tous en même esprit, travaillèrent chacun sous la direction du gouverneur, dont l’art, déployé dans un récit, feroit un juste ouvrage, également curieux et instructif. Mais Dieu, qui est le maître des cœurs, et dont le divin esprit souffle où il veut, fit de ce prince un ouvrage de sa droite, et, entre dix-huit et vingt ans il accomplit son œuvre. De cet abîme sortit un prince affable, doux, humain, modéré, patient, modeste, pénitent, et, autant et quelquefois au delà de ce que son état pouvoit comporter, humble et austère pour soi. Tout appliqué à ses devoirs, et les comprenant immenses, il ne pensa plus qu’à allier les devoirs de fils et de sujet avec ceux auxquels il se voyoit destiné. La brèveté des jours faisoit toute sa douleur. Il mit toute sa force et sa consolation dans la prière, et ses préservatifs en de pieuses lectures. Son goût pour les sciences abstraites, sa facilité à les pénétrer lui déroba d’abord un temps qu’il reconnut bientôt devoir à l’instruction des choses de son état, et à la bienséance d’un rang destiné à régner, et à tenir en attendant une cour.
L’apprentissage de la dévotion et l’appréhension de sa foiblesse pour les plaisirs le rendirent d’abord sauvage. La vigilance sur lui-même, à qui il ne passoit rien, et à qui il croyoit devoir ne rien passer, le renferma dans son cabinet, comme dans un asile impénétrable aux occasions. Que le monde est étrange! il l’eût abhorré dans son premier état, et il fut tenté de mépriser le second. Le prince le sentit; il le supporta; il attacha avec joie cette sorte d’opprobre à la croix de son Sauveur pour se confondre soi-même dans l’amer souvenir de son orgueil passé. Ce qui lui fut de plus pénible, il le trouva dans les traits appesantis de sa plus intime famille. Le Roi, avec sa dévotion et sa régularité d’écorce, vit bientôt avec un secret dépit un prince de cet âge censurer, sans le vouloir, sa vie par la sienne, se refuser un bureau neuf pour donner aux pauvres le prix qui y étoit destiné, et le remercier modestement d’une dorure nouvelle dont on vouloit rajeunir son petit appartement. On a vu combien il fut 169 piqué de son refus trop obstiné de se trouver à un bal de Marly le jour des Rois; véritablement ce fut la faute d’un novice; il devoit ce respect, tranchons le mot, cette charitable condescendance, au Roi son grand-père, de ne l’irriter pas par cet étrange contraste; mais au fond et en soi action bien grande, qui l’exposoit à toutes les suites du dégoût de soi qu’il donnoit au Roi, et aux propos d’une cour dont ce roi étoit l’idole, et qui tournoit en ridicule une telle singularité.
Cette grande et sainte maxime, que les rois sont faits pour leurs peuples, et non les peuples pour les rois ni aux rois, étoit si avant imprimée en son âme qu’elle lui avoit rendu le luxe et la guerre odieuse. C’est ce qui le faisoit quelquefois expliquer trop vivement sur la dernière, emporté par une vérité trop dure pour les oreilles du monde, qui a fait quelquefois dire sinistrement qu’il n’aimoit pas la guerre. Sa justice étoit munie de ce bandeau impénétrable qui en fait toute la sûreté. Il se donnoit la peine d’étudier les affaires qui se présentoient à juger devant le Roi aux conseils de finance et des dépêches, et si elles étoient grandes, il y travailloit avec les gens du métier, dont il puisoit des connoissances sans se rendre esclave de leurs opinions. Il communioit au moins tous les quinze jours, avec un recueillement et un abaissement qui frappoit, toujours en collier de l’ordre et en rabat et manteau court. Il voyoit son confesseur jésuite une ou deux fois la semaine, et quelquefois fort longtemps, ce qu’il abrégea beaucoup dans la suite, quoique il approchât plus souvent de la communion.
Sa conversation étoit aimable, tant qu’il pouvoit solide, et par goût; toujours mesurée à ceux avec qui il parloit. Il se délassoit volontiers à la promenade: c’étoit là où elles paroissoient le plus[226]. S’il s’y trouvoit quelqu’un avec qui il pût parler de sciences, c’étoit son plaisir, mais plaisir modeste, et seulement pour s’amuser et s’instruire, en dissertant quelque peu et en écoutant davantage. Mais 170 ce qu’il y cherchoit le plus, c’étoit l’utile, des gens à faire parler sur la guerre et les places, sur la marine et le commerce, sur les pays et les cours étrangères, quelquefois sur des faits particuliers, mais publics, et sur des points d’histoire ou des guerres passées depuis longtemps. Ces promenades, qui l’instruisoient beaucoup, lui concilioient les esprits, les cœurs, l’admiration, les plus grandes espérances. Il avoit mis à la place des spectacles, qu’il s’étoit retranchés depuis fort longtemps, un petit jeu où les plus médiocres bourses pouvoient atteindre, pour pouvoir varier et partager l’honneur de jouer avec lui, et se rendre cependant visible à tout le monde. Il fut toujours sensible au plaisir de la table et de la chasse: il se laissoit aller à la dernière avec moins de scrupule, mais il craignoit son foible pour l’autre, et il y étoit d’excellente compagnie quand il s’y laissoit aller.
Il connoissoit le Roi parfaitement; il le respectoit, et sur la fin il l’aimoit en fils, et lui faisoit une cour attentive de sujet, mais qui sentoit quel il étoit. Il cultivoit Mme de Maintenon avec les égards que leur situation demandoit. Tant que Monseigneur vécut, il lui rendoit tout ce qu’il devoit avec soin; on y sentoit la contrainte, encore plus avec Mlle Choin, et le malaise avec tout cet intérieur de Meudon. On en a tant expliqué les causes, qu’on n’y reviendra pas ici. Le prince admiroit, autant pour le moins que tout le monde, que Monseigneur, qui, tout matériel qu’il étoit, avoit beaucoup de gloire, n’avoit jamais pu s’accoutumer à Mme de Maintenon, ne la voyoit que par bienséance, et le moins encore qu’il pouvoit, et toutefois avoit aussi en Mlle Choin sa Maintenon autant que le Roi avoit la sienne, et ne lui asservissoit pas moins ses enfants que le Roi les siens à Mme de Maintenon. Il aimoit les princes ses frères avec tendresse, et son épouse avec la plus grande passion. La douleur de sa perte pénétra ses plus intimes moëlles. La piété y surnagea par les plus prodigieux efforts. Le sacrifice fut entier; mais il fut sanglant. Dans cette terrible affliction, rien de bas, rien de petit, rien d’indécent. On voyoit un homme hors 171 de soi, qui s’extorquoit une surface unie, et qui y succomboit. Les jours en furent tôt abrégés. Il fut le même dans sa maladie: il ne crut point en relever; il en raisonnoit avec ses médecins dans cette opinion; il ne cacha pas sur quoi elle étoit fondée; on l’a dit il n’y a pas longtemps, et tout ce qu’il sentit depuis le premier jour jusqu’au dernier l’y confirma de plus en plus. Quelle épouvantable conviction de la fin de son épouse et de la sienne! Mais, grand Dieu! quel spectacle vous donnâtes en lui, et que n’est-il permis encore d’en révéler des parties également secrètes, et si sublimes qu’il n’y a que vous qui les puissiez donner et en connoître tout le prix! quelle imitation de Jésus-Christ sur la croix! on ne dit pas seulement à l’égard de la mort et des souffrances, elle s’éleva bien au-dessus. Quelles tendres, mais tranquilles vues! Quel surcroît de détachement! Quels vifs élans d’actions de grâces d’être préservé du sceptre et du compte qu’il en faut rendre! Quelle soumission, et combien parfaite! Quel ardent amour de Dieu! Quel perçant regard sur son néant et ses péchés! Quelle magnifique idée de l’infinie miséricorde! Quelle religieuse et humble crainte! Quelle tempérée confiance! Quelle sage paix! Quelles lectures! Quelles prières continuelles! Quel ardent desir des derniers sacrements! Quel profond recueillement! Quelle invincible patience! Quelle douceur! Quelle constante bonté pour tout ce qui l’approchoit! Quelle charité pure qui le pressoit d’aller à Dieu! La France tomba enfin sous ce dernier châtiment; Dieu lui montra un prince qu’elle ne méritoit pas. La terre n’en étoit pas digne; il étoit mûr déjà pour la bienheureuse éternité[227].
César, Cardinal d’Estrées (1627-1717), was the third son of François-Annibal Maréchal-Duc d’Estrées, a distinguished soldier and diplomatist, who died in 1670 at the age of ninety-seven, and nephew of the celebrated Gabrielle d’Estrées. His brother, Jean, who lived to be eighty-three, and his nephew, Victor-Marie, who died at seventy-seven, were both Marshals of France. The Cardinal, though he never published a line, was elected to the Académie française at the age of twenty-eight.
Le cardinal d’Estrées mourut à Paris, dans son abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à quatre-vingt-sept ans presque accomplis, ayant toujours joui d’une santé parfaite de corps et d’esprit, jusqu’à cette maladie qui fut fort courte, et qui lui laissa sa tête entière jusqu’à la fin. Il est juste et curieux de s’arrêter un peu sur un personnage toute sa vie considérable, et qui à sa mort étoit cardinal-évêque d’Albano, abbé de Longpont, du Mont-Saint-Éloi, de Saint-Nicolas-aux-Bois, de la Staffarde en Piémont, où Catinat[228] gagna une célèbre bataille avant d’être maréchal de France, de Saint-Claude en Franche-Comté, dont l’abbé d’Estrées son neveu étoit coadjuteur, et dont on a fait un évêché depuis quelques années, d’Anchin en Flandres, et de Saint-Germain-des-Prés dans Paris. Il étoit aussi commandeur de l’Ordre[229], de la promotion de 1688.
Né en 1627, il avoit vécu quarante ans avec son père, et su profiter de ses leçons et de sa considération. La liaison la plus intime fut toute sa vie constante entre ses 173 neveux et petits-neveux de Vendôme et lui, dont il fut le conseil toute sa vie, et le cardinal y participa dès sa jeunesse. C’étoit l’homme du monde le mieux et le plus noblement fait de corps et d’âme, d’esprit et de visage, qu’on voyoit avoir été beau en jeunesse, et qui étoit vénérable en vieillesse, l’air prévenant mais majestueux, de grande taille, des cheveux presque blancs, une physionomie qui montroit beaucoup d’esprit, et qui tenoit parole, un esprit supérieur et un bel esprit, une érudition rare, vaste, profonde, exacte, nette, précise, beaucoup de vraie et de sage théologie, attachement constant aux libertés de l’Église gallicane et aux maximes du royaume, une éloquence naturelle, beaucoup de grâce et de facilité à s’énoncer, nulle envie d’en abuser, ni de montrer de l’esprit et du savoir, extrêmement noble, désintéressé, magnifique, libéral, beaucoup d’honneur et de probité, grande sagacité, grande pénétration, bon et juste discernement, souvent trop de feu en traitant les affaires. Il avoit été galant dans sa jeunesse, et il l’étoit demeuré sans blesser aucune bienséance. Parmi un courant d’affaires, la plupart de sa vie continuelles, réglé en tout, aumônier, et très homme de bien. C’étoit l’homme du monde de la meilleure compagnie, la plus instructive, la plus agréable, et dont la mémoire toujours présente n’avoit jamais rien oublié ni confondu de tout ce qu’il avoit su, vu et lu; toujours gai, égal, et sans la moindre humeur, mais souvent singulièrement distrait; qui aimoit à faire essentiellement plaisir, à servir, à obliger, qui s’y présentoit aisément, et qui ne s’en prévaloit jamais. Il savoit haïr aussi et le faire sentir: mais il savoit encore mieux aimer. C’étoit un homme très généreux: il étoit aussi fort courtisan et fort attentif aux ministres et à la faveur, mais avec dignité, un désinvolte qui lui étoit naturel, et incapable de rien de ce qu’il ne croyoit pas devoir faire. Jamais les jésuites ne purent l’entamer sur rien, ni le Roi sur eux, ni sur ce qu’on lui faisoit passer pour jansénisme, ni en dernier lieu, comme on l’a vu sur la constitution, ni de l’empêcher d’agir, et même de parler sur toutes ces matières avec la plus grande 174 liberté, sans que sa considération en ait baissé auprès du Roi.
Tant de grandes et d’aimables qualités le firent généralement aimer et respecter; sa science, son esprit, sa fermeté, sa liberté, le perçant de ses expressions quand il lui plaisoit, une plaisanterie fine et quelquefois poignante, un tour charmant, le faisoient craindre et ménager, et cela jusqu’à sa mort, par ceux qui étoient devenus la terreur de tout le monde. Avec beaucoup de politesse mais distinguée, il savoit se sentir; il étoit quelquefois haut, quelquefois colère; ce n’étoit pas un homme qu’il fît bon tâtonner sur rien. Ce tout ensemble faisoit un homme extrêmement aimable et sûr, et lui donna toujours un grand nombre d’amis.
Il fut évêque-duc de Laon à vingt-cinq ans, sacré à vingt-sept, et brilla fort cinq ans après en l’assemblée du clergé de 1660. Il eut la principale part à finir l’affaire fameuse des quatre évêques par ce qu’on a nommé la paix de Clément IX[230].
Il fut cardinal de Clément X en 1671, mais in petto, déclaré enfin l’année suivante, protecteur des affaires de Portugal, et se trouva en 1676 au conclave où Innocent XI fut élu; six mois après il fut à Munich pour le mariage de Monseigneur. Il se démit en 1681 en faveur de son neveu, fils du duc d’Estrées, de son évêché; et, tout cardinal qu’il étoit depuis dix ans, il demanda et obtint un brevet de conservation du rang et honneurs de duc et pair.
Devenu abbé de Saint-Germain-des-Prés, il vécut avec ses religieux comme un père, et tous les soirs il avoit deux, trois ou quatre moines savants qui venoient l’entretenir 175 de leurs ouvrages jusqu’à son coucher, qui avouoient qu’ils apprenoient beaucoup de lui[231].
Il ne pouvoit ouïr parler de ses affaires domestiques. Pressé et tourmenté par son intendant et son maître d’hôtel de voir enfin ses comptes, qu’il n’avoit point vus depuis grand nombre d’années, il leur donna un jour. Ils exigèrent qu’il fermeroit sa porte pour n’être pas interrompus; il y consentit avec peine, puis se ravisa, et leur dit que, pour le cardinal Bonsy[232] au moins, qui étoit à Paris, son ami et son confrère, il ne pouvoit s’empêcher de le voir, mais que ce seroit merveilles si ce seul homme, qu’il ne pouvoit refuser, venoit précisément ce jour-là. Tout de suite il envoya un domestique affidé au cardinal Bonsy, le prier avec instance de venir chez lui un tel jour entre trois et quatre heures, qu’il le conjuroit de n’y pas manquer, et qu’il lui en diroit la raison, mais, sur toutes choses, qu’il parût venir de lui-même. Il fit monter son suisse dès le matin du jour donné, à qui il défendit de laisser entrer qui que ce fût de toute l’après-dînée, excepté le seul cardinal Bonsy, qui sûrement ne viendrait pas; mais, s’il s’en avisoit, de ne le pas renvoyer. Ses gens, ravis d’avoir à le tenir toute la journée sur ses affaires sans y être interrompus, arrivent sur les trois heures; le cardinal laisse sa famille et le peu de gens qui pour ce jour-là avoient dîné chez lui, et passe dans un cabinet où ses gens d’affaires étalèrent leurs papiers. Il leur disoit mille choses ineptes sur sa dépense, où il n’entendoit rien, et regardoit sans cesse vers la fenêtre, sans en faire semblant, soupirant en secret après une prompte délivrance. Un peu avant quatre heures, arrive un carrosse dans la cour; ses gens d’affaires se fâchent contre le suisse, et crient qu’il n’y aura donc pas moyen de travailler. Le cardinal ravi s’excuse sur les ordres qu’il a donnés. "Vous verrez, 176 ajouta-t-il, que ce sera ce cardinal Bonsy, le seul homme que j’aie excepté, et qui tout juste s’avise de venir aujourd’hui." Tout aussitôt on le lui annonce; lui à hausser les épaules, mais à faire ôter les papiers et la table, et les gens d’affaires à s’en aller en pestant. Dès qu’il fut seul avec Bonsy, il lui conta pourquoi il lui avoit demandé cette visite, et à en bien rire tous deux. Oncques depuis ses gens d’affaires ne l’y rattrapèrent, et, de sa vie, n’en voulut ouïr parler.
Il falloit bien qu’ils fussent honnêtes gens et entendus: sa table étoit tous les jours magnifique, et remplie à Paris et à la cour de la meilleure compagnie; ses équipages l’étoient aussi; il avoit un nombreux domestique, beaucoup de gentilshommes, d’aumôniers, de secrétaires; il donnoit beaucoup aux pauvres, à pleines mains à son frère le maréchal et à ses enfants, qui lors n’étoient pas à leur aise, et il mourut sans devoir un seul écu à qui que ce fût.
Sa mort, à laquelle il se préparoit depuis longtemps, fut ferme, mais édifiante et fort chrétienne; la maladie fut courte, et il n’en avoit jamais eue, la tête entière jusqu’à la fin. Il fut universellement regretté, tendrement de sa famille, de ses amis, dont il avoit beaucoup, des pauvres, de son domestique, et de ses religieux qui sentirent tout ce qu’ils perdoient en lui, et qui trouvèrent bientôt après qu’ils avoient changé un père pour un loup et pour un tyran.
Un mot de lui au Roi dure encore. Il étoit à son dîner, toujours fort distingué du Roi dès qu’il paroissoit devant lui. Le Roi, lui adressant la parole, se plaignit de l’incommodité de n’avoir plus de dents. “Des dents, Sire, reprit le cardinal, eh! qui est-ce qui en a?” Le rare de cette réponse est qu’à son âge il les avoit encore blanches et fort belles, et que sa bouche, fort grande mais agréable, étoit faite de façon qu’il les montrait beaucoup en parlant; aussi le Roi se prit-il à rire de la réponse, et toute l’assistance, et lui-même, qui ne s’en embarrassa point du tout[233].
Paul, Duc de Beauvillier (1648-1714), who filled the offices of Governor of the Duc de Bourgogne, Chef du conseil des finances, and Minister of State, was regarded by Saint-Simon with deep and reverent affection. He and the Duc de Chevreuse had married daughters of Colbert, and the close friendship of the two brothers-in-law and their families is frequently referred to in Saint-Simon’s memoirs. The well-known intimacy between both Dukes and Fénelon is charmingly expressed in the latter’s correspondence.
Il étoit grand, fort maigre, le visage long et coloré, un fort grand nez aquilin, la bouche enfoncée, des yeux d’esprit et perçants, le sourire agréable, l’air fort doux, mais ordinairement fort sérieux et concentré. Il étoit né vif, bouillant, emporté, aimant tous les plaisirs. Beaucoup d’esprit naturel, le sens extrêmement droit, une grande justesse, souvent trop de précision; l’énonciation aisée, agréable, exacte, naturelle, l’appréhension vive, le discernement bon, une sagesse singulière, une prévoyance qui s’étendoit vastement, mais sans s’égarer; une simplicité et une sagacité extrêmes et qui ne se nuisoient point l’une à l’autre; et depuis que Dieu l’eut touché, ce qui arriva de très bonne heure, je crois pouvoir avancer qu’il ne perdit jamais sa présence, d’où on peut juger, éclairé comme il étoit, jusqu’à quel point il porta la piété. Doux, modeste, égal, poli avec distinction, assez prévenant, d’un accès facile et honnête jusqu’aux plus petites gens, ne montrant point sa dévotion, sans la cacher aussi, et n’en incommodant personne, mais veillant toutefois ses domestiques, peut-être de trop près; sincèrement humble, sans préjudice de ce qu’il devoit à ce qu’il étoit, et si détaché de tout, comme on l’a vu sur plusieurs occasions qui ont été racontées, que je ne crois pas que les plus saints moines l’aient été davantage. L’extrême dérangement des affaires de son père lui avoit néanmoins donné une grande attention aux siennes, ce qu’il croyoit un devoir, qui ne l’empêchoit pas d’être vraiment magnifique en tout, parce qu’il estimoit que cela étoit de son état.
178 Sa charité pour le prochain le resserroit dans des entraves qui le raccourcissoient par la contrainte de ses lèvres, de ses oreilles, de ses pensées, dont on a vu les inconvénients en plusieurs endroits. Le ministère, la politique, la crainte trop grande du Roi, augmentèrent encore cette attention continuelle sur lui-même, d’où naissoit un contraint, un concentré, dirois-je même un pincé, qui éloignoit de lui, et un goût de particulier très resserré, et de solitude qui convenoit peu à ses emplois, qui l’isoloit, qui, excepté ses fonctions, parmi lesquelles je range sa table ouverte le matin, lui faisoit un désert de la cour, et lui laissoit ignorer tout ce qui n’étoit pas les affaires où ses emplois l’engageoient nécessairement. On a vu où cela pensa le précipiter plus d’une fois, sans la moindre altération de la paix de son âme, ni la plus légère tentation de s’élargir là-dessus. Son cœur [étoit] droit, bon, tendre, peu étendu; mais ce qu’il aimoit, il l’aimoit bien, pourvu qu’il pût aussi l’estimer.
Sa crainte du Roi, celle de se commettre, ses précisions, engourdissoient trop son desir sincère de servir ses amis. Il fut tout autre, comme on l’a vu, sur cela comme sur tout le reste, après la mort de Monseigneur, et on ne put douter alors qu’il se plaisoit à servir ses amis en petites et en grandes choses.
Il épousa Mme de Beauvillier en 1671; le triste état des affaires de sa maison, que son père avoit ruinées, les engagea à faire cette alliance de la troisième fille de M. Colbert avec de grands biens. L’aînée avoit épousé quatre ans auparavant le duc de Chevreuse, et huit ans après la dernière fut mariée au duc de Mortemart. Les ducs de Chevreuse[234] et de Beauvillier et leurs femmes se trouvèrent 179 si parfaitement faits l’un pour l’autre, que ce ne fut qu’un cœur, qu’une âme, qu’une même pensée, un même sentiment toute leur vie, une amitié, une considération, une complaisance, une déférence, une confiance réciproque. Elle étoit pareille entre les deux sœurs, et la devint bientôt entre les deux beaux-frères. Vivant tous deux à la cour, attachés par leurs charges, et par la place de dame du palais de leurs femmes, ils se voyoient sans cesse, et mangeoient par semaine l’un chez l’autre, ce qui dura jusqu’à ce que les grands emplois du duc de Beauvillier l’obligèrent à tenir une table publique; ils ne s’en voyoient guère moins, rarement une seule fois par jour tant qu’ils vécurent. Il étoit rare aussi d’être ami de l’un à un certain point sans l’être aussi de l’autre et de leurs épouses.
La piété du duc de Beauvillier, qui commença de fort bonne heure, le sépara assez de ceux de son âge. Étant à l’armée, à une promenade du Roi, dans laquelle il servoit, il marchoit seul un jour un peu en avant; quelqu’un, le remarquant, se prit à dire qu’il faisoit là sa méditation. Le Roi, qui l’entendit, se tourna vers celui qui parloit, et le regardant: “Oui, dit-il, voilà M. de Beauvillier, qui est un des plus sages hommes de la cour et de mon royaume.” Cette subite et courte apologie fit taire et donna fort à penser, en sorte que les gloseurs demeurèrent en respect devant son mérite.
M. de Beauvillier voyoit les choses comme elles étoient: il étoit ennemi des chimères, il pesoit tout avec exactitude, comparoit les partis avec justesse, demeuroit inébranlable dans son choix sur des fondements certains. M. de Chevreuse, avec plus d’esprit, et sans comparaison plus de savoir en tout genre, voyoit tout en blanc et en pleine espérance, jusqu’à ce qui en offrait le moins, n’avoit pas la justesse de l’autre, ni le sens si droit. Son trop de lumières point assez ramassées l’éblouissoit par de faux jours, et sa facilité prodigieuse de concevoir et de raisonner lui ouvroit tant de routes qu’il étoit sujet à l’égarement, sans s’en apercevoir et de la meilleure foi du monde. Ces 180 inconvénients n’étoient jamais en M. de Beauvillier, qui étoit préférable dans un conseil, et M. de Chevreuse dans toutes les académies. Il avoit aussi une élocution plus naturellement diserte, entraînante, et dangereuse aussi, par les grâces qui y naissoient d’elles-mêmes, à entraîner dans le faux à force de chaînons, quand on lui avoit passé une fois ses premières propositions en entier faute d’attention assez vigilante, et de donner par cet entraînement dans un faux qu’à la fin on apercevoit tout entier, mais déjà dans le branle forcé de s’y sentir précipité. Enfin, pour achever ce contraste de deux hommes si unis jusqu’à n’être qu’un, le duc de Chevreuse ne pouvoit se lever ni se coucher; M. de Beauvillier, réglé en tout, se levoit fort matin, et se couchoit de bonne heure, c’est-à-dire qu’il sortoit de table au commencement du fruit, et qu’il étoit couché avant que le souper fût fini[235].
François de Salignac de la Mothe-Fénelon was born in his ancestral château of Périgord in 1651. He was appointed tutor to the Duc de Bourgogne in 1689 and Archbishop of Cambrai in 1695. In the following year his championship of Mme Guyon and the doctrine of Quietism brought him into disgrace with Louis XIV, and his residence at Cambrai became virtually an exile. He administered his see with the dignity of a grand seigneur, the capacity of a man of affairs, and the piety of a true Christian. His death in 1715 was the occasion for the following portrait, of which the earlier one in vol. VIII. (pp. 419-423) may be regarded as a first sketch. For a still earlier and a less favourable one, written when Fénelon was appointed to the see of Cambrai, see I. 271-275.
Ce prélat étoit un grand homme maigre, bien fait, pâle, avec un grand nez, des yeux dont le feu et l’esprit sortoient comme un torrent, et une physionomie telle que je n’en ai point vu qui y ressemblât, et qui ne se pouvoit oublier, quand on ne l’auroit vu qu’une fois. Elle rassembloit tout, et les contraires ne s’y combattoient pas. Elle avoit de la gravité et de la galanterie, du sérieux et de la gaieté; 181 elle sentoit également le docteur, l’évêque et le grand seigneur; ce qui y surnageoit, ainsi que dans toute sa personne, c’étoit la finesse, l’esprit, les grâces, la décence, et surtout la noblesse. Il falloit effort pour cesser de le regarder. Tous ses portraits sont parlants, sans toutefois avoir pu attraper la justesse de l’harmonie qui frappoit dans l’original, et la délicatesse de chaque caractère que ce visage rassembloit. Ses manières y répondoient dans la même proportion, avec une aisance qui en donnoit aux autres, et cet air et ce bon goût qu’on ne tient que de l’usage de la meilleure compagnie et du grand monde, qui se trouvoit répandu de soi-même dans toutes ses conversations; avec cela une éloquence naturelle, douce, fleurie, une politesse insinuante, mais noble et proportionnée, une élocution facile, nette, agréable, un air de clarté et de netteté pour se faire entendre dans les matières les plus embarrassées et les plus dures; avec cela un homme qui ne vouloit jamais avoir plus d’esprit que ceux à qui il parloit, qui se mettoit à la portée de chacun sans le faire jamais sentir, qui les mettoit à l’aise et qui sembloit enchanter, de façon qu’on ne pouvoit le quitter, ni s’en défendre, ni ne pas chercher à le retrouver. C’est ce talent si rare, et qu’il avoit au dernier degré, qui lui tint tous ses amis si entièrement attachés toute sa vie, malgré sa chute, et qui, dans leur dispersion, les réunissoit pour se parler de lui, pour le regretter, pour le desirer, pour se tenir de plus en plus à lui, comme les Juifs pour Jérusalem, et soupirer après son retour, et l’espérer toujours, comme ce malheureux peuple attend encore et soupire après le Messie. C’est aussi par cette autorité de prophète, qu’il s’étoit acquise sur les siens, qu’il s’étoit accoutumé à une domination qui, dans sa douceur, ne vouloit point de résistance. Aussi n’auroit-il pas longtemps souffert de compagnon s’il fût revenu à la cour et entré dans le Conseil, qui fut toujours son grand but; et une fois ancré et hors des besoins des autres, il eût été bien dangereux non-seulement de lui résister, mais de n’être pas toujours pour lui dans la souplesse et dans l’admiration.
182 Retiré dans son diocèse, il y vécut avec la piété et l’application d’un pasteur, avec l’art et la magnificence d’un homme qui n’a renoncé à rien, qui se ménage tout le monde et toutes choses[236]. Jamais homme n’a eu plus que lui la passion de plaire, et au valet autant qu’au maître; jamais homme ne l’a portée plus loin, avec une application plus suivie, plus constante, plus universelle; jamais homme n’y a plus entièrement réussi. Cambray est un lieu de grand abord et de grand passage; rien d’égal à la politesse, au discernement, à l’agrément avec lequel il recevoit tout le monde. Dans les premières années on l’évitoit, il ne couroit après personne; peu à peu les charmes de ses manières lui rapprochèrent un certain gros. A la faveur de cette petite multitude, plusieurs de ceux que la crainte avoit écartés, mais qui desiroient aussi de jeter des semences pour d’autres temps, furent bien aises des occasions de passer à Cambray. De l’un à l’autre tous y coururent. A mesure que Mgr le duc de Bourgogne parut figurer, la cour du prélat grossit, et elle en devint une effective aussitôt que son disciple fut devenu Dauphin. Le nombre de gens qu’il avoit accueillis, la quantité de ceux qu’il avoit logés chez lui passants par Cambray, les soins qu’il avoit pris des malades et des blessés qu’en diverses occasions on avoit portés dans sa ville, lui avoient acquis le cœur des troupes. Assidu aux hôpitaux et chez les moindres officiers, attentif aux principaux, en ayant chez lui en nombre et plusieurs mois de suite jusqu’à leur parfait rétablissement, vigilant en vrai pasteur au salut de leurs âmes, avec cette connoissance du monde qui les savoit gagner et qui en engageoit beaucoup à s’adresser à lui-même, et il ne se refusoit pas au moindre des hôpitaux qui vouloit aller à lui, et qu’il suivoit comme s’il n’eût point eu d’autres soins à prendre, il n’étoit pas moins actif au soulagement corporel. Les bouillons, les nourritures, les consolations des dégoûts, souvent encore les remèdes, sortoient en abondance de chez lui, et dans ce grand nombre un ordre et un soin que chaque chose fût du 183 meilleur en sa sorte qui ne se peut comprendre. Il présidoit aux consultations les plus importantes; aussi est-il incroyable jusqu’à quel point il devint l’idole des gens de guerre, et combien son nom retentit jusqu’au milieu de la cour.
Ses aumônes, ses visites épiscopales réitérées plusieurs fois l’année, et qui lui firent connoître par lui-même à fond toutes les parties de son diocèse, la sagesse et la douceur de son gouvernement, ses prédications fréquentes dans la ville et dans les villages, la facilité de son accès, son humanité avec les petits, sa politesse avec les autres, ses grâces naturelles qui rehaussoient le prix de tout ce qu’il disoit et faisoit, le firent adorer de son peuple, et les prêtres dont il se déclaroit le père et le frère, et qu’il traitoit tous ainsi, le portoient tous dans leurs cœurs. Parmi tant d’art et d’ardeur de plaire, et si générale, rien de bas, de commun, d’affecté, de déplacé, toujours en convenance à l’égard de chacun; chez lui abord facile, expédition prompte et désintéressée; un même esprit, inspiré par le sien, en tous ceux qui travailloient sous lui dans ce grand diocèse; jamais de scandale ni rien de violent contre personne; tout en lui et chez lui dans la plus grande décence. Ses matinées se passoient en affaires du diocèse. Comme il avoit le génie élevé et pénétrant, qu’il y résidoit toujours, qu’il ne se passoit point de jour qu’il ne réglât ce qui se présentoit, c’étoit chaque jour une occupation courte et légère. Il recevoit après qui le vouloit voir, puis alloit dire la messe, et il y étoit prompt; c’étoit toujours dans sa chapelle, hors les jours qu’il officioit, ou que quelque raison particulière l’engageoit à l’aller dire ailleurs. Revenu chez lui, il dînoit avec la compagnie, toujours nombreuse, mangeoit peu et peu solidement, mais demeuroit longtemps à table pour les autres, et les charmoit par l’aisance, la variété, le naturel, la gaieté de sa conversation, sans jamais descendre à rien qui ne fût digne et d’un évêque et d’un grand seigneur; sortant de table il demeuroit peu avec la compagnie. Il l’avoit accoutumée à vivre chez lui sans contrainte, et à n’en pas prendre pour elle. Il entroit dans son cabinet et y travailloit quelques heures, qu’il 184 prolongeoit s’il faisoit mauvais temps et qu’il n’eût rien à faire hors de chez lui.
Au sortir de son cabinet il alloit faire des visites ou se promener à pied hors la ville. Il aimoit fort cet exercice et l’allongeoit volontiers, et, s’il n’y avoit personne de ceux qu’il logeoit, ou quelque personne distinguée, il prenoit quelque grand vicaire et quelque autre ecclésiastique, et s’entretenoit avec eux du diocèse, de matières de piété ou de savoir; souvent il y mêloit des parenthèses agréables. Les soirs, il les passoit avec ce qui logeoit chez lui, soupoit avec les principaux de ces passages d’armées quand il en arrivoit, et alors sa table étoit servie comme le matin. Il mangeoit encore moins qu’à dîner, et se couchoit toujours avant minuit. Quoique sa table fût magnifique et délicate, et que tout chez lui répondît à l’état d’un grand seigneur, il n’y avoit rien néanmoins qui ne sentît l’odeur de l’épiscopat et de la règle la plus exacte, parmi la plus honnête et la plus douce liberté. Lui-même étoit un exemple toujours présent, mais auquel on ne pouvoit atteindre; partout un vrai prélat, partout aussi un grand seigneur, partout encore l’auteur de Télémaque. Jamais un mot sur la cour, sur les affaires, quoi que ce soit qui pût être repris, ni qui sentît le moins du monde bassesse, regrets, flatterie; jamais rien qui pût seulement laisser soupçonner ni ce qu’il avoit été, ni ce qu’il pouvoit encore être. Parmi tant de grandes parties, un grand ordre dans ses affaires domestiques, et une grande règle dans son diocèse; mais sans petitesse, sans pédanterie, sans avoir jamais importuné personne d’aucun état sur la doctrine.
Les jansénistes étoient en paix profonde dans le diocèse de Cambray, et il y en avoit grand nombre; ils s’y taisoient, et l’archevêque aussi à leur égard. Il auroit été à desirer pour lui qu’il eût laissé ceux de dehors dans le même repos; mais il tenoit trop intimement aux jésuites, et il espéroit trop d’eux, pour ne leur pas donner ce qui ne troubloit pas le sien. Il étoit aussi trop attentif à son petit troupeau choisi, dont il étoit le cœur, l’âme, la vie et l’oracle, pour ne lui pas donner de temps en temps la 185 pâture de quelques ouvrages qui couroient entre leurs mains avec la dernière avidité, et dont les éloges retentissoient. Il fut rudement réfuté par les jansénistes, et il est vrai de plus que le silence en matière de doctrine auroit convenu à l’auteur si solennellement condamné du livre des Maximes des saints[237]; mais l’ambition n’étoit rien moins que morte; les coups qu’il recevoit des réponses des jansénistes lui devenoient de nouveaux mérites auprès de ses amis, et de nouvelles raisons aux jésuites de tout faire et de tout entreprendre pour lui procurer le rang et les places d’autorité dans l’Église et dans l’État. A mesure que les temps orageux s’éloignoient, que ceux de son Dauphin s’approchoient, cette ambition se réveilloit fortement, quoique cachée sous une mesure qui certainement lui devoit coûter. Le célèbre Bossuet, évêque de Meaux, n’étoit plus, ni Godet, évêque de Chartres[238]; la Constitution avoit perdu le cardinal de Noailles[239]; le P. Tellier[240] étoit devenu tout-puissant. Ce confesseur du Roi étoit totalement à lui ainsi que l’élixir du gouvernement des jésuites, et la Société entière faisoit profession de lui être attachée depuis la mort du P. Bourdaloue[241], du P. Gaillard et de quelques autres principaux qui lui étoient opposés, qui en retenoient d’autres, et que la politique des supérieurs laissoit agir, pour ne pas choquer le Roi ni Mme de Maintenon contre tout le corps; mais ces temps étoient passés, et tout ce formidable corps lui étoit enfin réuni. Le Roi, en deux ou trois occasions depuis peu, n’avoit pu s’empêcher de le louer. Il avoit ouvert ses greniers aux troupes dans un temps de cherté et où les munitionnaires étoient à bout, et il s’étoit bien gardé d’en rien recevoir, quoique il en eût tiré de grosses sommes en le vendant à l’ordinaire. On peut juger que ce service ne demeura pas enfoui, et ce fut aussi ce qui fit hasarder pour la première fois de nommer son nom au Roi. Le duc de 186 Chevreuse avoit enfin osé l’aller voir, et le recevoir une autre fois à Chaulnes[242], et on peut juger que ce ne fut pas sans s’être assuré que le Roi le trouvoit bon.
Fénelon, rendu enfin aux plus flatteuses et aux plus hautes espérances, laissa germer cette semence d’elle-même; mais elle ne put venir à maturité. La mort si peu attendue du Dauphin l’accabla, et celle du duc de Chevreuse, qui ne tarda guère après, aigrit cette profonde plaie; la mort du duc de Beauvillier la rendit incurable, et l’atterra. Ils n’étoient qu’un cœur et qu’une âme, et, quoique ils ne se fussent jamais vus depuis l’exil, Fénelon le dirigeoit de Cambray jusque dans les plus petits détails. Malgré sa profonde douleur de la mort du Dauphin, il n’avoit pas laissé d’embrasser une planche dans ce naufrage. L’ambition surnageoit à tout, se prenoit à tout[243]. Son esprit avoit toujours plu à M. le duc d’Orléans. M. de Chevreuse avoit cultivé et entretenu entre eux l’estime et l’amitié, et j’y avois aussi contribué par attachement pour le duc de Beauvillier, qui pouvoit tout sur moi. Après tant de pertes et d’épreuves les plus dures, ce prélat étoit encore homme d’espérances; il ne les avoit pas mal placées. On a vu les mesures que les ducs de Chevreuse et de Beauvillier m’avoient engagé de prendre pour lui auprès de ce prince, et qu’elles avoient réussi de façon que les premières places lui étoient destinées, et que je lui en avois fait passer l’assurance par ces deux ducs dont la piété s’intéressoit si vivement en lui, et qui étoient persuadés que rien ne pouvoit être si utile à l’Église, ni 187 si important à l’État, que de le placer au timon du gouvernement; mais il étoit arrêté qu’il n’auroit que des espérances. On a vu que rien ne le pouvoit rassurer sur moi, et que les ducs de Chevreuse et de Beauvillier me l’avouoient. Je ne sais si cette frayeur s’augmenta par leur perte, et s’il crut que, ne les ayant plus pour me tenir, je ne serois plus le même pour lui, avec qui je n’avois jamais eu aucun commerce, trop jeune avant son exil, et sans nulle occasion depuis. Quoi qu’il en soit, sa foible complexion ne put résister à tant de soins et de traverses. La mort du duc de Beauvillier lui donna le dernier coup. Il se soutint quelque temps par effort de courage, mais ses forces étoient à bout. Les eaux, ainsi qu’à Tantale, s’étoient trop persévéramment retirées du bord de ses lèvres toutes les fois qu’il croyoit y toucher pour y éteindre l’ardeur de sa soif.
Il fit un court voyage de visite épiscopale, il versa dans un endroit dangereux, personne ne fut blessé, mais il vit tout le péril, et eut dans sa foible machine toute la commotion de cet accident. Il arriva incommodé à Cambray, la fièvre survint, et les accidents tellement coup sur coup qu’il n’y eut plus de remède; mais sa tête fut toujours libre et saine. Il mourut à Cambray le 7 janvier de cette année, au milieu des regrets intérieurs, et à la porte du comble de ses desirs. Il savoit l’état tombant du Roi; il savoit ce qui le regardoit après lui. Il étoit déjà consulté du dedans et recourtisé du dehors, parce que le goût du soleil levant avoit déjà percé. Il étoit porté par le zèle infatigablement actif de son petit troupeau, devenu la portion d’élite du grand parti de la constitution par la haine des anciens ennemis de l’archevêque de Cambray, qui ne l’étoient pas moins de la doctrine des jésuites, qu’il s’agissoit, de tolérée à grand peine qu’elle avoit été depuis son père Molina, de rendre triomphante, maîtresse et unique. Que de puissants motifs de regretter la vie, et que la mort est amère dans des circonstances si parfaites et si à souhait de tous côtés! Toutefois il n’y parut pas. Soit amour de la réputation, qui fut toujours un objet auquel il donna toute préférence, soit grandeur d’âme, qui méprise enfin ce qu’elle ne peut atteindre, soit dégoût du 188 monde si continuellement trompeur pour lui, et de sa figure qui passe, et qui alloit lui échapper, soit piété ranimée par un long usage, et ranimée peut-être par ces tristes mais puissantes considérations, il parut insensible à tout ce qu’il quittoit, et uniquement occupé de ce qu’il alloit trouver, avec une tranquillité, une paix, qui n’excluoit que le trouble, et qui embrassoit la pénitence, le détachement, le soin unique des choses spirituelles et de son diocèse, enfin une confiance qui ne faisoit que surnager à l’humilité et à la crainte.
Dans cet état, il écrivit au Roi une lettre sur le spirituel de son diocèse, qui ne disoit pas un mot sur lui-même, qui n’avoit rien que de touchant et qui ne convînt au lit de la mort à un grand évêque. La sienne, à moins de soixante-cinq ans, munie des sacrements de l’Église, au milieu des siens et de son clergé, put passer pour une grande leçon à ceux qui survivoient, et pour laisser de grandes espérances de celui qui étoit appelé. La consternation dans tous les Pays-Bas fut extrême. Il y avoit apprivoisé jusqu’aux armées ennemies, qui avoient autant et même plus de soin de conserver ses biens que les nôtres. Leurs généraux et la cour de Bruxelles se piquoient de le combler d’honnêtetés et des plus grandes marques de considération, et les protestants pour le moins autant que les catholiques. Les regrets furent donc sincères et universels dans toute l’étendue des Pays-Bas. Ses amis, sur tous son petit troupeau, tombèrent dans l’abîme de l’affliction la plus amère. A tout prendre, c’étoit un bel esprit et un grand homme. L’humanité rougit pour lui de Mme Guyon, dans l’admiration de laquelle, vraie ou feinte, il a toujours vécu, sans que ses mœurs aient jamais été le moins du monde soupçonnées, et est mort après en avoir été le martyr, sans qu’il ait été jamais possible de l’en séparer. Malgré la fausseté notoire de toutes ses prophéties, elle fut toujours le centre où tout aboutit dans ce petit troupeau, et l’oracle suivant lequel Fénelon vécut et conduisit les autres[244].
François de Neufville, Maréchal-Duc de Villeroy (1644-1730), was great-grandson of Nicolas de Neufville, Seigneur de Villeroy, minister to Henry III and Henry IV, grandson of the first Marquis de Villeroy, and son of the Maréchal-Duc de Villeroy, governor of Louis XIV. He was brought up with the king, who in consequence always regarded him with favour. “Prince Charming” in society, he served with distinction in the earlier wars of the reign. But as a Commander-in-chief he was a failure, and his signal defeat by Marlborough at Ramillies in 1706 was largely due to his incapacity. La Bruyère’s Ménippe (Du mérite personnel) is generally regarded as a portrait of him.
Le maréchal de Villeroy a tant figuré, devant et depuis, qu’il est nécessaire de le faire connoître. C’étoit un grand homme bien fait, avec un visage fort agréable, fort vigoureux, sain, qui sans s’incommoder faisoit tout ce qu’il vouloit de son corps. Quinze et seize heures à cheval ne lui étoient rien, les veilles pas davantage. Toute sa vie nourri et vivant dans le plus grand monde; fils du gouverneur du Roi, élevé avec lui, dans sa familiarité dès leur première jeunesse, galant de profession, parfaitement au fait des intrigues galantes de la cour et de la ville, dont il savoit amuser le Roi, qu’il connoissoit à fond, et des foiblesses duquel il sut profiter, et se maintenir en osier de cour dans les contre-temps qu’il essuya avant que je fusse dans le monde. Il étoit magnifique en tout, fort noble dans toutes ses manières, grand et beau joueur sans se soucier du jeu, point méchant gratuitement, tout le langage et les façons d’un grand seigneur et d’un homme pétri de la cour; glorieux à l’excès par nature, bas aussi à l’excès pour peu qu’il en eût besoin, et à l’égard du Roi et de Mme de Maintenon valet à tout faire.
Il avoit cet esprit de cour et du monde que le grand usage donne, et que les intrigues et les vues aiguisent, avec ce jargon qu’on y apprend, qui n’a que le tuf[245], mais qui éblouit les sots, et que l’habitude de la familiarité du Roi, de la faveur, des distinctions, du commandement 190 rendoit plus brillant, et dont la fatuité suprême faisoit tout le fond. C’étoit un homme fait exprès pour présider à un bal, pour être le juge d’un carrousel, et, s’il avoit eu de la voix, pour chanter à l’Opéra les rôles de roi et de héros; fort propre encore à donner les modes, et à rien du tout au delà. Il ne se connoissoit ni en gens ni en choses, pas même en celles de plaisir, et parloit et agissoit sur parole; grand admirateur de qui lui imposoit, et conséquemment dupe parfaite, comme il le fut toute sa vie, de Vaudemont[246], de Mme des Ursins[247] et des personnages éclatants; incapable de bon conseil, incapable encore de toute affaire, même d’en rien comprendre par delà l’écorce, au point que, lorsqu’il fut dans le conseil, le Roi étoit peiné de cette ineptie, au point d’en baisser la tête, d’en rougir et de perdre sa peine à le redresser, et à tâcher de lui faire comprendre le point dont il s’agissoit. C’est ce que j’ai su longtemps après de Torcy[248], qui étoit étonné au dernier point de la sottise en affaires d’un homme de cet âge, si rompu à la cour. Il y étoit en effet si rompu qu’il en étoit corrompu. Il se piquoit néanmoins d’être fort honnête homme; mais comme il n’avoit point de sens, il montroit la corde fort aisément, aux occasions mêmes peu délicates, où son peu de cervelle le trahissoit, peu retenu d’ailleurs quand ses vues, ses espérances et son intérêt, même l’envie de plaire et de flatter, ne s’accordoient pas avec la probité. C’étoit toujours, hors des choses communes, un embarras et une confiance dont le mélange devenoit ridicule. On distinguoit l’un d’avec l’autre, on voyoit qu’il ne savoit où il en étoit; quelque sproposito prononcé avec autorité, étayé de ses grands airs, étoit ordinairement sa ressource. Il étoit brave de sa personne; pour la capacité militaire on en [a] vu les funestes fruits. Sa politesse avoit 191 une hauteur qui repoussoit, et ses manières étoient par elles-mêmes insultantes quand il se croyoit affranchi de la politesse par le caractère des gens. Aussi étoit-ce l’homme du monde le moins aimé, et dont le commerce étoit le plus insupportable, parce qu’on [n’]y trouvoit qu’un tissu de fatuité, de recherche et d’applaudissement de soi, de montre de faveur et de grandeur de fortune, un tissu de questions qui en interrompoient les réponses, qui souvent ne les attendoient pas, et qui toujours étoient sans aucun rapport ensemble. D’ailleurs nulle chose que des contes de cour, d’aventures, de galanteries; nulle lecture, nulle instruction, ignorance crasse sur tout, plates plaisanteries, force vent et parfait vide. Il traitoit avec l’empire le plus dur les personnes de sa dépendance. Il est incroyable les traitements continuels que jusqu’à sa mort il a faits continuellement à son fils qui lui rendoit des soins infinis et une soumission sans réplique, et j’ai su par des amis de Tallart[249], dont il étoit fort proche, et l’a toujours protégé, qu’il le mettoit sans cesse au désespoir, même parvenu à la tête de l’armée. Enfin la fausseté, et la plus grande, et la plus pleine opinion de soi en tout genre mettent la dernière main à la perfection de ce trop véritable tableau[250].
Philippe, Duc d’Orléans (1674-1723), Regent of France after the death of Louis XIV, was the only son of Monsieur, the brother of Louis XIV, by his second wife, Charlotte Elizabeth, daughter of the Elector Palatine. Till his father’s death in 1701 he was called the Duc de Chartres.
M. le duc d’Orléans étoit de taille médiocre au plus, fort plein, sans être gros, l’air et le port aisé et fort noble, le visage large, agréable, fort haut en couleur, le poil noir 192 et la perruque de même. Quoique il eût fort mal dansé, et médiocrement réussi à l’académie, il avoit dans le visage, dans le geste, dans toutes ses manières une grâce infinie, et si naturelle qu’elle ornoit jusqu’à ses moindres actions, et les plus communes. Avec beaucoup d’aisance quand rien ne le contraignoit, il étoit doux, accueillant, ouvert, d’un accès facile et charmant, le son de la voix agréable, et un don de la parole qui lui étoit tout particulier en quelque genre que ce pût être, avec une facilité et une netteté que rien ne surprenoit, et qui surprenoit toujours. Son éloquence étoit naturelle jusque dans les discours les plus communs et les plus journaliers, dont la justesse étoit égale sur les sciences les plus abstraites, qu’il rendoit claires, sur les affaires de gouvernement, de politique, de finance, de justice, de guerre, de cour, de conversation ordinaire, et de toutes sortes d’arts et de mécanique. Il ne se servoit pas moins utilement des Histoires et des Mémoires, et connoissoit fort les maisons. Les personnages de tous les temps et leurs vies lui étoient présentes, et les intrigues des anciennes cours comme celles de son temps. A l’entendre, on lui auroit cru une vaste lecture. Rien moins. Il parcourait légèrement, mais sa mémoire étoit si singulière qu’il n’oublioit ni choses, ni noms, ni dates, qu’il rendoit avec précision, et son appréhension étoit si forte qu’en parcourant ainsi, c’étoit en lui comme s’il eût tout lu fort exactement. Il excelloit à parler sur-le-champ, et en justesse et en vivacité, soit de bons mots, soit de reparties. Il m’a souvent reproché, et d’autres plus que lui, que je ne le gâtois pas; mais je lui ai souvent aussi donné une louange qui est méritée par bien peu de gens, et qui n’appartenoit à personne si justement qu’à lui: c’est qu’outre qu’il avoit infiniment d’esprit et de plusieurs sortes, la perspicacité singulière du sien se trouvoit jointe à une si grande justesse, qu’il ne se serait jamais trompé en aucune affaire s’il avoit suivi la première appréhension de son esprit sur chacune. Il prenoit quelquefois cette louange de moi pour un reproche, et il n’avoit pas toujours tort; mais elle n’en 193 étoit pas moins vraie. Avec cela nulle présomption, nulle trace de supériorité d’esprit ni de connoissance, raisonnant comme d’égal à égal avec tous, et donnant toujours de la surprise aux plus habiles. Rien de contraignant ni d’imposant dans la société, et quoique il sentît bien ce qu’il étoit, et de façon même de ne le pouvoir oublier en sa présence, il mettoit tout le monde à l’aise, et lui-même comme au niveau des autres.
Il gardoit fort son rang en tout genre avec les princes du sang, et personne n’avoit l’air, le discours, ni les manières plus respectueuses que lui, ni plus noble avec le Roi et avec les fils de France. Monsieur avoit hérité en plein de la valeur des rois ses père et grand-père, et l’avoit transmise toute entière à son fils. Quoique il n’eût aucun penchant à la médisance, beaucoup moins à ce qu’on appelle être méchant, il étoit dangereux sur la valeur des autres. Il ne cherchoit jamais à en parler, modeste et silencieux même à cet égard sur ce qui lui étoit personnel, et racontoit toujours les choses de cette nature où il avoit eu le plus de part, donnant avec équité toute louange aux autres et ne parlant jamais de soi; mais il se passoit difficilement de pincer ceux qu’il ne trouvoit pas ce qu’il appeloit francs du collier, et on lui sentoit un mépris et une répugnance naturelle à l’égard de ceux qu’il avoit lieu de croire tels. Aussi avoit-il le foible de croire ressembler en tout à Henri IV, de l’affecter dans ses façons, dans ses reparties, de se le persuader jusque dans sa taille et la forme de son visage, et de n’être touché d’aucune autre louange ni flatterie comme de celle-là qui lui alloit au cœur. C’est une complaisance à laquelle je n’ai jamais pu me ployer. Je sentois trop qu’il ne recherchoit pas moins cette ressemblance dans les vices de ce grand prince que dans ses vertus, et que les uns ne faisoient pas moins son admiration que les autres. Comme Henri IV, il étoit naturellement bon, humain, compatissant, et cet homme si cruellement accusé du crime le plus noir et le plus inhumain, je n’en ai point connu de plus naturellement opposé au crime de la destruction des 194 autres, ni plus singulièrement éloigné de faire peine même à personne, jusque-là qu’il se peut dire que sa douceur, son humanité, sa facilité avoient tourné en défaut, et je ne craindrai pas de dire qu’il tourna en vice la suprême vertu du pardon des ennemis, dont la prodigalité sans cause ni choix tenoit trop près de l’insensible, et lui a causé bien des inconvénients fâcheux et des maux dont la suite fournira des exemples et des preuves.
Je me souviens qu’un an peut-être avant la mort du Roi, étant monté de bonne heure après dîné chez Mme la duchesse d’Orléans à Marly, je la trouvai au lit pour quelque migraine, et M. le duc d’Orléans seul dans la chambre, assis dans le fauteuil du chevet du lit. A peine fus-je assis que Mme la duchesse d’Orléans se mit à me raconter un fait du prince et du cardinal de Rohan[251], arrivé depuis peu de jours, et prouvé avec la plus claire évidence. Il rouloit sur des mesures contre M. le duc d’Orléans pour le présent et l’avenir, et sur le fondement de ces exécrables imputations si à la mode par le crédit et le cours que Mme de Maintenon et M. du Maine s’appliquoient sans cesse à leur donner. Je me récriai d’autant plus que M. le duc d’Orléans avoit toujours distingué et recherché, je ne sais pourquoi, ces deux frères, et qu’il croyoit pouvoir compter sur eux: “Et que dites-vous de M. le duc d’Orléans, ajouta-t-elle ensuite, qui, depuis qu’il le sait, qu’il n’en doute pas, et qu’il n’en peut douter, leur fait tout aussi bien qu’à l’ordinaire?” A l’instant je regardai M. le duc d’Orléans qui n’avoit dit que quelques mots pour confirmer le récit de la chose à mesure qu’il se faisoit, et qui étoit couché négligemment dans sa chaise, et je lui dis avec feu: “Pour cela, Monsieur, il faut dire la vérité, c’est que depuis Louis le Débonnaire il n’y en eut jamais un si débonnaire que vous.” A ces mots, il se releva dans sa chaise, rouge de colère jusqu’au blanc des yeux, balbutiant de dépit contre moi qui lui disois, prétendoit-il, des choses fâcheuses, et contre Mme la duchesse d’Orléans qui les lui 195 avoit procurées, et qui rioit. “Courage, Monsieur, ajoutai-je, traitez bien vos ennemis, et fâchez-vous contre vos serviteurs. Je suis ravi de vous voir en colère, c’est signe que j’ai mis le doigt sur l’apostume; quand on la presse, le malade crie. Je voudrois en faire sortir tout le pus, et après cela vous seriez tout un autre homme et tout autrement compté.” Il grommela encore un peu et puis s’apaisa. C’est là une des deux occasions seules où il se soit jamais mis en vraie colère contre moi. Je rapporterai l’autre en son temps.
Deux ou trois ans après la mort du Roi, je causois à un coin de la longue et grande pièce de l’appartement des Tuileries, comme le conseil de régence alloit commencer dans cette même pièce où il se tenoit toujours, tandis que M. le duc d’Orléans étoit tout à l’autre bout, parlant à quelqu’un dans une fenêtre. Je m’entendis appeler comme de main en main; on me dit que M. le duc d’Orléans me vouloit parler. Cela arrivoit souvent en se mettant au Conseil. J’allai donc à cette fenêtre où il étoit demeuré. Je trouvai un maintien sérieux, un air concentré, un visage fâché qui me surprit beaucoup. “Monsieur, me dit-il d’abordée, j’ai fort à me plaindre de vous que j’ai toute ma vie compté pour le meilleur de mes amis.—Moi, Monsieur! plus étonné encore, qu’y a-t-il donc, lui dis-je, s’il vous plaît?—Ce qu’il y a, répondit-il avec une mine encore plus colère, chose que vous ne sauriez nier, des vers que vous avez faits contre moi.—Moi, des vers! répliquai-je; hé! qui diable vous conte de ces sottises-là? et depuis près de quarante ans que vous me connoissez, est-ce que vous ne savez pas que de ma vie je n’ai pu faire, non pas deux vers, mais un seul?—Hon, par...! reprit-il, vous ne pouvez nier ceux-là, et tout de suite me chante un pont-neuf à sa louange dont le refrain étoit: Notre régent est débonnaire, la la, il est débonnaire, avec un grand éclat de rire.—Comment! lui dis-je, vous vous en souvenez encore? et en riant aussi, pour la vengeance que vous en prenez, souvenez-vous-en du moins à bon escient.” Il demeura à rire longtemps, à ne s’en pouvoir empêcher 196 avant de se mettre au Conseil. Je n’ai pas craint d’écrire cette bagatelle, parce qu’il me semble qu’elle peint.
Il aimoit fort la liberté, et autant pour les autres que pour lui-même. Il me vantoit un jour l’Angleterre sur ce point, où il n’y a point d’exils ni de lettres de cachet, et où le Roi ne peut défendre que l’entrée de son palais ni tenir personne en prison, et sur cela me conta en se délectant, car tous nos princes vivoient lors, qu’outre la duchesse de Portsmouth, Charles II avoit bien eu de petites maîtresses; que le grand prieur[252], jeune et aimable en ce temps-là, qui s’étoit fait chasser pour quelque sottise, étoit allé passer son exil en Angleterre, où il avoit été fort bien reçu du roi. Pour le remerciement, il lui débaucha une de ces petites maîtresses dont le roi étoit si passionné alors qu’il lui fit demander grâces, lui offrit de l’argent, et s’engagea de le raccommoder en France. Le grand prieur tint bon. Charles lui fit défendre le palais. Il s’en moqua, et alloit tous les jours à la comédie avec sa conquête, et s’y plaçoit vis-à-vis du roi. Enfin le roi d’Angleterre, ne sachant plus que faire pour s’en délivrer, pria tellement le Roi de le rappeler en France qu’il le fut. Mais le grand prieur tint bon, dit qu’il se trouvoit bien en Angleterre, et continua son manège. Charles outré en vint jusqu’à faire confidence au Roi de l’état où le mettoit le grand prieur, et obtint un commandement si absolu et si prompt qu’il le fit repasser incontinent en France. M. le duc d’Orléans admirait cela, et je ne sais s’il n’aurait pas voulu être le grand prieur. Je lui répondis que j’admirais moi-même que le petit-fils d’un roi de France se pût complaire dans un si insolent procédé, que moi sujet, et qui, comme lui, n’avois aucun trait au trône, je 197 trouvois plus que scandaleux et extrêmement punissable. Il n’en relâcha rien, et faisoit toujours cette histoire avec volupté. Aussi d’ambition de régner ni de gouverner, n’en avoit-il aucune. S’il fit une pointe tout à fait insensée pour l’Espagne, c’est qu’on la lui avoit mise dans la tête. Il ne songea même, comme on le verra, tout de bon à gouverner que lorsque force fut d’être perdu et déshonoré, ou d’exercer les droits de sa naissance, et, quant à régner je ne craindrai pas de répondre que jamais il ne le desira, et que, le cas forcé arrivé, il s’en seroit trouvé également importuné et embarrassé. Que vouloit-il donc? me demandera-t-on; commander les armées tant que la guerre auroit duré, et se divertir le reste du temps sans contrainte ni à lui ni à autrui.
C’étoit en effet à quoi il étoit extrêmement propre. Une valeur naturelle, tranquille, qui lui laissoit tout voir, tout prévoir, et porter les remèdes, une grande étendue d’esprit pour les échecs d’une campagne, pour les projets, pour se munir de tout ce qui convenoit à l’exécution, pour s’en aider à point nommé, pour s’établir d’avance des ressources et savoir en profiter bout à bout, et user aussi avec une sage diligence et vigueur de tous les avantages que lui pouvoit présenter le sort des armes. On peut dire qu’il étoit capitaine, ingénieur, intendant d’armée, qu’il connoissoit la force des troupes, le nom et la capacité des officiers, et les plus distingués de chaque corps, s’en faire adorer, les tenir néanmoins en discipline, exécuter, en manquant de tout, les choses les plus difficiles. C’est ce qui a été admiré en Espagne, et pleuré en Italie, quand il y prévit tout, et que Marsin lui arrêta les bras sur tout. Ses combinaisons étoient justes et solides tant sur les matières de guerre que sur celles d’État; il est étonnant jusqu’à quel détail il en embrassoit toutes les parties sans confusion, les avantages et les désavantages des partis qui se présentoient à prendre, la netteté avec laquelle il les comprenoit et savoit les exposer, enfin la variété infinie et la justesse de toutes ses connoissances sans en montrer jamais, ni en avoir en effet meilleure opinion de soi.
198 L’abbé du Bois[253] étoit un petit homme maigre, effilé, chafouin, à perruque blonde, à mine de fouine, à physionomie d’esprit, qui étoit en plein ce qu’un mauvais françois appelle un sacre mais que ne se peut guère exprimer autrement. Tous les vices combattoient en lui à qui en demeureroit le maître. Ils y faisoient un bruit et un combat continuel entre eux. L’avarice, la débauche, l’ambition étoient ses dieux; la perfidie, la flatterie, les servages, ses moyens; l’impiété parfaite, son repos; et l’opinion que la probité et l’honnêteté sont des chimères dont on se pare, et qui n’ont de réalité dans personne, son principe, en conséquence duquel tous moyens lui étoient bons. Il excelloit en basses intrigues, il en vivoit, il ne pouvoit s’en passer, mais toujours avec un but où toutes ses démarches tendoient, avec une patience qui n’avoit de terme que le succès, ou la démonstration réitérée de n’y pouvoir arriver, à moins que, cheminant ainsi dans la profondeur et les ténèbres, il ne vît jour à mieux en ouvrant un autre boyau. Il passoit ainsi sa vie dans les sapes. Le mensonge le plus hardi lui étoit tourné en nature avec un air simple, droit, sincère, souvent honteux. Il auroit parlé avec grâce et facilité, si, dans le dessein de pénétrer les autres en parlant, et la crainte de s’avancer plus qu’il ne vouloit, ne l’avoit accoutumé à un bégayement factice qui le déparoit, et qui, redoublé quand il fut arrivé à se mêler de choses importantes, devint insupportable, et quelquefois inintelligible. Sans ses contours et le peu de naturel qui perçoit malgré ses soins, sa 199 conversation auroit été aimable. Il avoit de l’esprit, assez de lettres, d’histoire et de lecture, beaucoup de monde, force envie de plaire et de s’insinuer, mais tout cela gâté par une fumée de fausseté qui sortoit malgré lui de tous ses pores, et jusque de sa gaieté, qui attristoit par là. Méchant d’ailleurs avec réflexion, et par nature et par raisonnement, traître et ingrat, maître expert aux compositions des plus grandes noirceurs, effronté à faire peur étant pris sur le fait, desirant tout, enviant tout, et voulant toutes les dépouilles. On connut après, dès qu’il osa ne se plus contraindre, à quel point il étoit intéressé, débauché, inconséquent, ignorant en toute affaire, passionné toujours, emporté blasphémateur et fou, et jusqu’à quel point il méprisa publiquement son maître et l’État, le monde sans exception et les affaires, pour les sacrifier à soi tous et toutes, à son crédit, à sa puissance, à son autorité absolue, à sa grandeur, à son avarice, à ses frayeurs, à ses vengeances. Tel fut le sage à qui Monsieur confia les mœurs de son fils unique à former, par le conseil de deux hommes qui ne les avoient pas meilleures, et qui en avoient bien fait leurs preuves.
Un si bon maître ne perdit pas son temps auprès d’un disciple tout neuf encore, et en qui les excellents principes de Saint-Laurent[254] n’avoient pas eu le temps de prendre de fortes racines, quelque estime et quelque affection qu’il ait conservée toute sa vie pour cet excellent homme. Je l’avouerai ici avec amertume, parce que tout doit être sacrifié à la vérité: M. le duc d’Orléans apporta au monde une facilité, appelons les choses par leur nom, une foiblesse qui gâta sans cesse tous ses talents, et qui fut à son précepteur d’un merveilleux usage toute sa vie. Hors de toute espérance du côté du Roi depuis la folie d’avoir osé lui demander sa nomination au cardinalat, il ne songea plus qu’à posséder son jeune maître par la conformité à soi. Il le flatta du côté des mœurs pour le jeter dans la débauche, et lui en faire un principe pour se bien mettre dans le monde, jusqu’à mépriser tous devoirs et toutes 200 bienséances, ce qui le feroit bien plus ménager par le Roi qu’une conduite mesurée; il le flatta du côté de l’esprit, dont il le persuada [qu’]il en avoit trop et trop bon pour être la dupe de la religion, qui n’étoit, à son avis, qu’une invention de politique, et de tous les temps, pour faire peur aux esprits ordinaires et retenir les peuples dans la soumission. Il l’infatua encore de son principe favori que la probité dans les hommes et la vertu dans les femmes ne sont que des chimères sans réalité dans personne, sinon dans quelques sots en plus grand nombre qui se sont laissé imposer ces entraves comme celle de la religion, qui en sont des dépendances, et qui pour la politique sont du même usage, et fort peu d’autres qui ayant de l’esprit et de la capacité se sont laissé raccourcir l’un et l’autre par les préjugés de l’éducation. Voilà le fonds de la doctrine de ce bon ecclésiastique, d’où suivoit la licence de la fausseté, du mensonge, des artifices, de l’infidélité, de la perfidie, de toute espèce de moyens, en un mot, tout crime et toute scélératesse tournés en habileté, en capacité, en grandeur, liberté et profondeur d’esprit, de lumière et de conduite, pourvu qu’[on] sût se cacher et marcher à couvert des soupçons et des préjugés communs.
Malheureusement tout concourut en M. le duc d’Orléans à lui ouvrir le cœur et l’esprit à cet exécrable poison; une neuve et première jeunesse, beaucoup de force et de santé, les élans de la première sortie du joug et du dépit de son mariage et de son oisiveté, l’ennui qui suit la dernière, cet amour, si fatal en ce premier âge, de ce bel air qu’on admire aveuglément dans les autres, et qu’on veut imiter et surpasser, l’entraînement des passions, des exemples et des jeunes gens qui y trouvoient leur vanité et leur commodité, quelques-uns leurs vues à le faire vivre comme eux et avec eux. Ainsi il s’accoutuma à la débauche, plus encore au bruit de la débauche jusqu’à n’avoir pu s’en passer, et qu’il ne s’y divertissoit qu’à force de bruit, de tumulte et d’excès. C’est ce qui le jeta à en faire souvent de si étranges et de si scandaleuses, et comme il vouloit l’emporter sur tous les débauchés, à mêler dans ses parties 201 les discours les plus impies et à trouver un raffinement précieux à faire les débauches les plus outrées aux jours les plus saints, comme il lui arriva pendant sa régence plusieurs fois le vendredi saint de choix et les jours les plus respectables. Plus on étoit suivi, ancien, outré en impiété et en débauche, plus il considérait cette sorte de débauchés, et je l’ai vu sans cesse dans l’admiration poussée jusqu’à la vénération pour le grand prieur, parce qu’il y avoit quarante ans qu’il ne s’étoit couché qu’ivre, et qu’il n’avoit cessé d’entretenir publiquement des maîtresses et de tenir des propos continuels d’impiété et d’irréligion. Avec de tels principes et la conduite en conséquence, il n’est pas surprenant qu’il ait été faux jusqu’à l’indiscrétion de se vanter de l’être, et de se piquer d’être le plus raffiné trompeur.
Lui et Mme la duchesse de Berry disputoient quelquefois qui des deux en savoit là-dessus davantage, et quelquefois à sa toilette devant Mme de Saint-Simon, et ce qui y étoit avant le public, et M. le duc de Berry même, qui étoit fort vrai et qui en avoit horreur, et sans que M[me] de Saint-Simon, qui n’en souffrait pas moins et pour la chose et pour l’effet, pût la tourner en plaisanterie, ni leur faire sentir la porte pour sortir d’une telle indiscrétion. M. le duc d’Orléans en avoit une infinie dans tout ce qui regardoit la vie ordinaire et sur ce qui le regardoit lui-même. Ce n’étoit pas injustement qu’il étoit accusé de n’avoir point de secret. La vérité est qu’élevé dans les tracasseries du Palais-Royal, dans les rapports, dans les redits dont Monsieur vivoit et dont sa cour étoit remplie, M. le duc d’Orléans en avoit pris le détestable goût et l’habitude, jusqu’à s’en être fait une sorte de maxime de brouiller tout le monde ensemble, et d’en profiter pour n’avoir rien à craindre des liaisons, soit pour apprendre par les aveux, les délations et les piques, et par la facilité encore de faire parler les uns contre les autres. Ce fut une de ses principales occupations pendant tout le temps qu’il fut à la tête des affaires, et dont il se sut le plus de gré, mais qui, tôt découverte, le rendit odieux et le jeta en 202 mille fâcheux inconvénients. Comme il n’étoit pas méchant, qu’il étoit même fort éloigné de l’être, il demeura dans l’impiété et la débauche où du Bois l’avoit premièrement jeté, et que tout confirma toujours en lui par l’habitude, dans la fausseté, dans la tracasserie des uns aux autres, dont qui que ce soit ne fut exempt, et dans la plus singulière défiance qui n’excluoit pas en même temps et pour les mêmes personnes de la plus grande confiance; mais il en demeura là sans avoir rien pris du surplus des crimes familiers à son précepteur.
Revenu plus assidûment à la cour, à la mort de Monsieur, l’ennui l’y gagna et le jeta dans les curiosités de chimie dont j’ai parlé ailleurs, et dont on sut faire contre lui un si cruel usage. On a peine à comprendre à quel point ce prince étoit incapable de se rassembler du monde, je dis avant que l’art infernal de Mme de Maintenon et du duc du Maine l’en eût totalement séparé; combien peu il étoit en lui de tenir une cour; combien avec un air désinvolte il se trouvoit embarrassé et importuné du grand monde, et combien dans son particulier, et depuis dans sa solitude au milieu de la cour quand tout le monde l’eut déserté, il se trouva destitué de toute espèce de ressource avec tant de talents, qui en devoient être une inépuisable d’amusements pour lui. Il étoit né ennuyé, et il étoit si accoutumé à vivre hors de lui-même, qu’il lui étoit insupportable d’y rentrer, sans être capable de chercher même à s’occuper. Il ne pouvoit vivre que dans le mouvement et le torrent des affaires, comme à la tête d’une armée, ou dans les soins d’y avoir tout ce dont il auroit besoin pour les exécutions de la campagne, ou dans le bruit et la vivacité de la débauche. Il y languissoit dès qu’elle étoit sans bruit et sans une sorte d’excès et de tumulte, tellement que son temps lui étoit pénible à passer. Il se jeta dans la peinture après que le grand goût de la chimie fut passé ou amorti par tout ce qui s’en étoit si cruellement publié. Il peignoit presque toute l’après-dînée à Versailles et à Marly. Il se connoissoit fort en tableaux; il les aimoit; il en ramassoit et il en fit une 203 collection qui en nombre et en perfection ne le cédoit pas aux tableaux de la couronne. Il s’amusa après à faire des compositions de pierres et de cachets à la merci du charbon, qui me chassoit souvent d’avec lui, et des compositions de parfums les plus forts, qu’il aima toute sa vie, et dont je le détournois, parce que le Roi les craignoit fort, et qu’il sentoit presque toujours. Enfin jamais homme né avec tant de talents de toutes les sortes, tant d’ouverture et de facilité pour s’en servir, et jamais vie de particulier si désœuvrée ni si livrée au néant et à l’ennui. Aussi Madame ne le peignit-elle pas moins heureusement qu’avoit fait le Roi par l’apophthegme qu’il répondit sur lui à Maréchal, et que j’ai rapporté.
Madame étoit pleine de contes et de petits romans de fées: elle disoit qu’elles avoient toutes été conviées à ses couches, que toutes y étoient venues, et que chacune avoit doué son fils d’un talent, de sorte qu’il les avoit tous; mais que par malheur on avoit oublié une vieille fée disparue depuis si longtemps qu’on ne se souvenoit plus d’elle, qui, piquée de l’oubli, vint appuyée sur son petit bâton, et n’arriva qu’après que toutes les fées eurent fait chacune leur don à l’enfant; que, dépitée de plus en plus, elle se vengea en le douant de rendre absolument inutiles tous les talents qu’il avoit reçus de toutes les autres fées, d’aucun desquels, en les conservant tous, il n’avoit jamais pu se servir. Il faut avouer qu’à prendre la chose en gros le portrait est parlant[255].
Un des malheurs de ce prince étoit d’être incapable de suite dans rien, jusqu’à ne pouvoir comprendre qu’on en pût avoir. Un autre, dont j’ai déjà parlé, fut une espèce d’insensibilité qui le rendoit sans fiel dans les plus mortelles offenses et les plus dangereuses; et comme le nerf et le principe de la haine et de l’amitié, de la reconnoissance et de la vengeance est le même, et qu’il manquoit de ce ressort, les suites en étoient infinies et pernicieuses. Il étoit timide à l’excès, il le sentoit et il en avoit tant de honte qu’il affectoit tout le contraire, jusqu’à s’en piquer. 204 Mais la vérité étoit, comme on le sentit enfin dans son autorité par une expérience plus développée, qu’on n’obtenoit rien de lui, ni grâce ni justice, qu’en l’arrachant par crainte, dont il étoit infiniment susceptible, ou par une extrême importunité. Il tâchoit de s’en délivrer par des paroles, puis par des promesses, dont sa facilité le rendoit prodigue, mais que qui avoit de meilleures serres lui faisoit tenir. De là tant de manquements de paroles qu’on ne comptoit plus les plus positives pour rien, et tant de paroles encore données à tant de gens pour la même chose qui ne pouvoit s’accorder qu’à un seul, ce qui étoit une source féconde de discrédit et de mécontents. Rien ne le trompa et ne lui nuisit davantage que cette opinion qu’il s’étoit faite de savoir tromper tout le monde. On ne le croyoit plus, lors même qu’il parloit de la meilleure foi, et sa facilité diminua fort en lui le prix de toutes choses. Enfin la compagnie obscure, et pour la plupart scélérate, dont il avoit fait sa société ordinaire de débauche, et que lui-même ne feignoit pas de nommer publiquement ses roués, chassa la bonne, jusque dans sa puissance, et lui fit un tort infini.
Sa défiance sans exception étoit encore une chose infiniment dégoûtante avec lui, surtout lorsqu’il fut à la tête des affaires, et le monstrueux unisson à ceux de sa familiarité hors de débauche. Ce défaut, qui le mena loin, venoit tout à la fois de sa timidité, qui lui faisoit craindre ses ennemis les plus certains, et les traiter avec plus de distinctions que ses amis, de sa facilité naturelle, d’une fausse imitation d’Henri IV, dont cela même n’est ni le plus beau ni le meilleur endroit, et de cette opinion malheureuse que la probité étoit une parure fausse, sans réalité, d’où lui venoit cette défiance universelle. Il étoit néanmoins très persuadé de la mienne, jusque-là qu’il me l’a souvent reprochée comme un défaut et un préjugé d’éducation qui m’avoit resserré l’esprit et accourci les lumières, et il m’en a dit autant de Mme de Saint-Simon, parce qu’il la croyoit vertueuse. Je lui avois aussi donné des preuves d’attachement trop fortes, trop fréquentes, 205 trop continuelles dans les temps les plus dangereux, pour qu’il en pût douter, et néanmoins voici ce qui m’arriva dans la seconde ou troisième année de la régence, et je le rapporte comme un des plus forts coups de pinceau, et si dès lors mon désintéressement lui avoit été mis en évidence par les plus fortes coupelles, comme on le verra par la suite.
On étoit en automne. M. le duc d’Orléans avoit congédié les Conseils pour une quinzaine. J’en profitois pour aller passer ce temps à la Ferté; je venois de passer une heure seul avec lui, j’en avois pris congé et j’étois revenu chez moi, où, pour être en repos, j’avois fermé ma porte. Au bout d’une heure au plus, on me vint dire que Biron[256] étoit à la porte, qu’il ne se vouloit point laisser renvoyer, et qu’il disoit qu’il avoit ordre de M. le duc d’Orléans, qui l’envoyoit, de me parler de sa part. Il faut ajouter que mes deux fils avoient chacun un régiment de cavalerie, et que tous les colonels étoient lors par ordre à leurs corps. Je fis entrer Biron avec d’autant plus de surprise, que je ne faisois que de quitter M. le duc d’Orléans. Je demandai donc avec empressement ce qu’il y avoit de si nouveau. Biron fut embarrassé, et à son tour s’informa où étoit le marquis de Ruffec. Ma surprise fut encore plus grande; je lui demandai ce que cela vouloit dire. Biron, de plus en plus empêtré, m’avoua que M. le duc d’Orléans en étoit inquiet, et l’envoyoit à moi pour le savoir. Je lui dis qu’il étoit à son régiment comme tous les autres, et logé dans Besançon chez M. de Levis[257], qui commandoit en Franche-Comté. “Mais, me dit Biron, je le sais bien; n’auriez-vous point quelque lettre de lui?—Pourquoi faire? répondis-je.—C’est que franchement, puisqu’il vous faut tout dire, M. le duc d’Orléans, me répondit-il, voudroit voir de son écriture.” Il m’ajouta que peu après que je l’eus quitté, il étoit descendu dans le petit jardin de Mme la duchesse d’Orléans, laquelle étoit à Montmartre; que la compagnie ordinaire, c’est-à-dire les roués et les p...., s’y promenoient avec lui; qu’il étoit venu un commis de 206 la poste avec des lettres, à qui il avoit parlé quelque temps en particulier; qu’après cela il avoit appelé lui Biron, lui avoit montré une lettre datée de Madrid du marquis de Ruffec à sa mère, et que là-dessus il lui avoit donné sa commission de me venir trouver.
A ce récit je sentis un mélange de colère et de compassion, et je ne m’en contraignis pas avec Biron. Je n’avois point de lettres de mon fils, parce que je les brûlois à mesure comme tous papiers inutiles. Je chargeai Biron de dire à M. le duc d’Orléans une partie de ce que je sentois; que je n’avois pas la plus légère connoissance avec qui que ce fût en Espagne, et le lieu où mon fils étoit; que je le priois instamment de dépêcher sur-le-champ un courrier à Besançon, pour le mettre en repos par ce qu’il lui rapporteroit. Biron, haussant les épaules, me dit que tout cela étoit bel et bon, mais que si je retrouvois quelque lettre du marquis de Ruffec, il me prioit de la lui envoyer sur-le-champ, et qu’il mettrait ordre qu’elle lui parvînt même à table, malgré l’exacte clôture de leurs soupers. Je ne voulus pas retourner au Palais-Royal pour y faire une scène, et je renvoyai Biron. Heureusement Mme de Saint-Simon rentra quelque temps après; je lui contai l’aventure. Elle trouva une dernière lettre du marquis de Ruffec, que nous envoyâmes à Biron. Elle perça jusqu’à table, comme il me l’avoit dit. M. le duc d’Orléans se jeta dessus avec empressement. L’admirable est qu’il ne connoissoit point son écriture. Non-seulement il la regarda, mais il la lut; et comme il la trouva plaisante, il en régala tout haut sa compagnie, dont elle devint l’entretien, et lui tout à coup affranchi de ses soupçons. A mon retour de la Ferté, je le trouvai honteux avec moi, et je le rendis encore davantage par ce que je lui dis là-dessus.
Il revint encore d’autres lettres de ce prétendu marquis de Ruffec. Il fut arrêté longtemps après à Bayonne, à table chez Dadoncourt, qui y commandoit, et qui en prit tout à coup la résolution sur ce qu’il lui vit prendre des olives avec une fourchette. Il avoua au cachot qui il étoit, et ses papiers décelèrent le libertinage du jeune homme 207 qui court le pays, et qui, pour être bien reçu et avoir de l’argent, prit le nom de marquis de Ruffec, se disoit brouillé avec moi, écrivoit à Mme de Saint-Simon pour se raccommoder par elle et la prier de payer ce qu’on lui prêtoit, le tout pour qu’on vît ses lettres, et que cela, joint à ce qu’il disoit de la famille, le fît croire mon fils et lui en procurât les avantages. C’étoit un grand garçon bien fait, avec de l’esprit, de l’adresse et de l’effronterie, qui étoit fils d’un huissier de Madame, qui connoissoit toute la cour, et qui, dans le dessein qu’il avoit pris de passer pour mon fils, s’étoit bien informé de la famille pour en parler juste et n’être point surpris. On le fit enfermer pour quelque temps. Il avoit auparavant couru le monde sous d’autres noms; il crut que celui de mon fils, de l’âge duquel il se trouvoit à peu près, lui rendroit davantage.
La curiosité d’esprit de M. le duc d’Orléans, jointe à une fausse idée de fermeté et de courage, l’avoit occupé de bonne heure à chercher à voir le diable, et à pouvoir le faire parler. Il n’oublioit rien, jusqu’aux plus folles lectures, pour se persuader qu’il n’y a point de Dieu, et il croyoit le diable jusqu’à espérer de le voir et de l’entretenir. Ce contraste ne se peut comprendre, et cependant il est extrêmement commun. Il y travailla avec toutes sortes de gens obscurs, et beaucoup avec Mirepoix, mort en 1699, sous-lieutenant des mousquetaires noirs, frère aîné du père de Mirepoix, aujourd’hui lieutenant général et chevalier de l’ordre. Ils passoient les nuits dans les carrières de Vanves et de Vaugirard à faire des invocations. M. le duc d’Orléans m’a avoué qu’il n’avoit jamais pu venir à bout de rien voir ni entendre, et se déprit enfin de cette folie. Ce ne fut d’abord que par complaisance pour Mme d’Argenton, mais après par un réveil de curiosité, qu’il s’adonna à faire regarder dans un verre d’eau le présent et le futur, dont j’ai rapporté sur son récit des choses singulières, et il n’étoit pas menteur. Faux et menteur, quoique fort voisins, ne sont pas même chose, et quand il lui arrivoit de mentir, ce n’étoit jamais que, 208 lorsque pressé sur quelque promesse ou sur quelque affaire, il y avoit recours malgré lui pour sortir d’un mauvais pas.
Quoique nous nous soyons souvent parlé sur la religion, où, tant que j’ai pu me flatter de quelque espérance de le ramener, je me tournois de tout sens avec lui pour traiter cet important chapitre sans le rebuter, je n’ai jamais pu démêler le système qu’il pouvoit s’être forgé, et j’ai fini par demeurer persuadé qu’il flottoit sans cesse sans s’en être jamais pu former. Son desir passionné, comme celui de ses pareils en mœurs, étoit qu’il n’y eût point de Dieu; mais il avoit trop de lumière pour être athée, qui sont une espèce particulière d’insensés bien plus rare qu’on ne croit. Cette lumière l’importunoit, il cherchoit à l’éteindre et n’en put venir à bout. Une âme mortelle lui eût été une ressource; il ne réussit pas mieux dans les longs efforts qu’il fit pour se la persuader. Un Dieu existant et une âme immortelle le jetoient en un fâcheux détroit, et il ne se pouvoit aveugler sur la vérité de l’un et de l’autre. Le déisme lui parut un refuge, mais ce déisme trouva en lui tant de combats, que je ne trouvai pas grand peine à le ramener dans le bon chemin, après que je l’eus fait rompre avec Mme d’Argenton. On a vu avec quelle bonne foi de sa part par ce qui en a été raconté. Elle s’accordoit avec ses lumières dans cet intervalle de suspension de débauche. Mais le malheur de son retour vers elle le rejeta d’où il étoit parti. Il n’entendit plus que le bruit des passions qui s’accompagna pour l’étourdir encore des mêmes propos d’impiété, et de la folle affectation de l’impiété. Je ne puis donc savoir que ce qu’il n’étoit pas, sans pouvoir dire ce qu’il étoit sur la religion. Mais je ne puis ignorer son extrême malaise sur ce grand point, et n’être pas persuadé qu’il ne se fût jeté de lui-même entre les mains de tous les prêtres et de tous les capucins de la ville, qu’il faisoit trophée de tant mépriser, s’il étoit tombé dans une maladie périlleuse qui lui en auroit donné le temps. Son grand foible en ce genre étoit de se piquer d’impiété et d’y vouloir surpasser les plus hardis.
209 Je me souviens qu’une nuit de Noël à Versailles, où il accompagna le Roi à matines et aux trois messes de minuit, il surprit la cour par sa continuelle application à lire dans le livre qu’il avoit apporté, et qui parut un livre de prière. La première femme de chambre de Mme la duchesse d’Orléans, ancienne dans la maison, fort attachée et fort libre, comme le sont tous les vieux bons domestiques, transportée de joie de cette lecture, lui en fit compliment chez Mme la duchesse d’Orléans le lendemain, où il y avoit du monde. M. le duc d’Orléans se plut quelque temps à la faire danser, puis lui dit: “Vous êtes bien sotte, Mme Imbert; savez-vous donc ce que je lisois? C’étoit Rabelais, que j’avois porté de peur de m’ennuyer.” On peut juger de l’effet de cette réponse. La chose n’étoit que trop vraie, et c’étoit pure fanfaronnade. Sans comparaison des lieux ni des choses, la musique de la chapelle étoit fort au-dessus de celle de l’Opéra et de toutes les musiques de l’Europe; et comme les matines, laudes et les trois messes basses de la nuit de Noël duraient longtemps, cette musique s’y surpassoit encore. Il n’y avoit rien de si magnifique que l’ornement de la chapelle et que la manière dont elle étoit éclairée. Tout y étoit plein; les travées de la tribune remplies de toutes les dames de la cour en déshabillé, mais sous les armes. Il n’y avoit donc rien de si surprenant que la beauté du spectacle, et les oreilles y étoient charmées. M. le duc d’Orléans aimoit extrêmement la musique; il la savoit jusqu’à composer, et il s’est même amusé à faire lui-même une espèce de petit opéra, dont la Fare[258] fit les vers, et qui fut chanté devant le Roi; cette musique de la chapelle étoit donc de quoi l’occuper le plus agréablement du monde, indépendamment de l’accompagnement d’un spectacle si éclatant, sans avoir recours à Rabelais; mais il falloit faire l’impie et le bon compagnon[259].
Cambray vaquoit, comme on l’a vu naguère, par la mort à Rome du cardinal de la Trémoïlle[261], c’est-à-dire le plus riche archevêché[262] et un des plus grands postes de l’Église. L’abbé du Bois n’étoit que tonsuré; cent cinquante mille livres de rente le tentèrent, et peut-être bien autant ce degré pour s’élever moins difficilement au cardinalat. Quelque impudent qu’il fût, quel que fût l’empire qu’il avoit pris sur son maître, il se trouva fort embarrassé et masqua son effronterie de ruse; il dit à M. le duc d’Orléans qu’il avoit fait un plaisant rêve, et lui conta qu’il avoit rêvé qu’il étoit archevêque de Cambray. Le Régent, qui sentit où cela alloit, fit la pirouette et ne répondit rien. Du Bois, de plus en plus embarrassé, bégaya et paraphrasa son rêve; puis, se rassurant d’effort, demanda brusquement pourquoi il ne l’obtiendroit pas, Son Altesse Royale, de sa seule volonté, pouvant faire ainsi sa fortune. M. le duc d’Orléans fut indigné, même effrayé, quelque peu scrupuleux qu’il fût au choix des évêques, et d’un ton de mépris, lui répondit: “Qui? toi, archevêque de Cambray?” en lui faisant sentir sa bassesse et plus encore le débordement et le scandale de sa vie. Du Bois s’étoit trop avancé pour demeurer en si beau chemin; lui cita des exemples. Malheureusement il n’y 211 en avoit que trop, et en bassesse et en étranges mœurs, grâces, comme on l’a vu ailleurs, à Godet, évêque de Chartres, avec ses séminaristes de néant et ignorants dont il remplit les évêchés, au P. Tellier et à la constitution, pour bassesse, ignorance, et mauvaises mœurs tout à la fois, et à ceux qui l’ont suivi.
M. le duc d’Orléans, moins touché de raisons si mauvaises qu’embarrassé de résister à l’ardeur de la poursuite d’un homme qu’il n’avoit plus accoutumé à contredire sur rien, chercha à se tirer d’affaire, et lui dit: “Mais tu es un sacre, et qui est l’autre sacre qui voudra te sacrer?—Ah! s’il ne tient qu’à cela, reprit vivement l’abbé, l’affaire est faite; je sais bien qui me sacrera, il n’est pas loin d’ici.—Et qui diable est celui-là, répondit le Régent, qui osera te sacrer?—Voulez-vous le savoir? répliqua l’abbé; et ne tient-il qu’à cela encore une fois?—Hé bien! qui? dit le Régent.—Votre premier aumônier, reprit du Bois, qui est là dehors; il ne demandera pas mieux; je m’en vais le lui dire”; embrasse les jambes de M. le duc d’Orléans, qui demeure court et pris sans avoir la force du refus, sort, tire l’évêque de Nantes à part, lui dit qu’il a Cambray, le prie de le sacrer, qui le lui promet à l’instant; rentre, caracole, dit à M. le duc d’Orléans qu’il vient de parler à son premier aumônier, qui lui a promis de le sacrer, remercie, loue, admire, scelle de plus en plus son affaire, en la comptant faite et en persuadant le Régent, qui n’osa jamais dire que non. C’est de la sorte que du Bois se fit archevêque de Cambray.
Du Bois, sous prétexte des affaires dont il étoit chargé, obtint un bref pour recevoir à la fois tous les ordres, et se dispensa lui-même de toute retraite pour s’y préparer. Il alla donc un matin à quatre ou cinq lieues de Paris, où dans une église paroissiale du diocèse de Rouen, du grand vicariat de Pontoise, Tressan[263], évêque de Nantes, premier aumônier de M. le duc d’Orléans, donna dans la même messe basse, qu’il célébra extra tempora, le sous-diaconat, 212 le diaconat et la prêtrise à l’abbé du Bois, et en fut après récompensé de l’archevêché de Rouen et des économats à la mort de Besons, qui avoit l’un et l’autre, et qui ne le fit pas longtemps attendre.
J’achèverai tout de suite ce qui regarde cette matière pour ne la pas séparer, et n’avoir pas à y revenir. On y trouvera une anecdote curieuse sur l’autorité de l’abbé du Bois sur son maître, et sur la frayeur et le danger de lui déplaire. Il eut ses bulles au commencement de mai, et fut sacré le dimanche 9 juin. Tout Paris et toute la cour y fut conviée. Je ne le fus point; j’étois lors mal avec lui, parce que je ne le ménageois guère avec M. le duc d’Orléans, sur ses vues du cardinalat et sur son abandon dans les affaires à ce qui convenoit aux Anglois et à l’Empereur, par lesquels il comptoit d’arriver à la pourpre romaine. Comme il redoutoit ma liberté, ma franchise, ma façon de parler à M. le duc d’Orléans qui lui faisoit de fréquentes impressions, quoique je m’en donnasse assez rarement la peine, et qu’il avoit celle de les effacer, il revenoit à moi de temps en temps, me ménageoit, me courtisoit, toujours pourtant détournant tant qu’il pouvoit la confiance de M. le duc d’Orléans en moi, qu’il resserroit sans cesse, mais qu’il ne pouvoit arrêter totalement ni même longtemps, quoique, comme je l’ai dit, je me retirasse beaucoup par le dégoût de tout ce que je voyois. Ainsi nous étions bien en apparence quelquefois, et souvent mal.
Ce sacre devoit être magnifique, et M. le duc d’Orléans y devoit assister. J’en dirai quelques mots dans la suite. Plus la nomination et l’ordination de l’abbé du Bois avoit fait de bruit, de scandale et d’horreur, plus les préparatifs superbes de son sacre les augmentoient, et plus l’indignation en éclatoit contre M. le duc d’Orléans. Je fus donc le trouver la veille de cet étrange sacre, et d’abordée je lui dis ce qui m’amenoit. Je le fis souvenir que je ne lui avois jamais parlé de la nomination de l’abbé du Bois à Cambray, parce qu’il savoit bien que je ne lui parlois jamais des 213 choses faites; que je ne lui en parlerois pas encore, si je n’avois appris qu’il devoit aller le lendemain à son sacre; que je me tairois avec lui de la façon dont il se faisoit, telle qu’il ne pourroit mieux, si l’usage étoit encore de faire des princes du sang évêques, et qu’il fût question de son second fils, parce [que] je regardois cela comme chose déjà faite, mais que mon attachement pour lui ne me permettoit pas de lui cacher l’épouvantable effet que faisoit universellement une nomination de tous points si scandaleuse, une ordination si sacrilège, des préparatifs de sacre si inouïs pour un homme de l’extraction, de l’état, des mœurs et de la vie de l’abbé du Bois, non pour lui reprocher ce qui n’étoit plus réparable, mais pour qu’il sût à quel point en étoit la générale indignation contre lui, et que de là il conclût ce que ce seroit pour lui d’y mettre le comble en allant lui-même à ce sacre; je le conjurai de sentir quel seroit ce contraste avec l’usage, non-seulement des fils de France, mais des princes du sang, de n’aller jamais à aucun sacre, parce que je n’appelois pas y aller la curiosité d’en voir un une fois en leur vie, que les rois et les personnes royales avoient eue quelquefois; j’ajoutai qu’à l’opinion que sa vie et ses discours ne donnoient que trop continuellement de son défaut de toute religion, on ne manqueroit pas de dire, de croire et de répandre qu’il alloit à ce sacre pour se moquer de Dieu et insulter son Église; que l’effet de cela étoit horrible et toujours fort à craindre, et qu’on y ajouteroit avec raison que l’orgueil de l’abbé du Bois abusoit de lui en tout, et que ce trait public de dépendance, par une démarche si étrangement nouvelle et déplacée, lui attireroit une haine, un mépris, une honte dont les suites étoient à redouter, que je ne lui en parlois qu’en serviteur entièrement désintéressé; que son absence ou sa présence à ce sacre ne changeroit rien à la fortune de l’abbé du Bois, qui ne seroit ni plus ni moins archevêque de Cambray, et n’obscurciroit en rien la splendeur préparée pour ce sacre, telle qu’elle ne pourroit être plus grande, si on avoit un fils de France à sacrer; qu’en vérité c’en étoit bien assez 214 pour un du Bois, sans prostituer son maître aux yeux de toute la France, et bientôt après de toute l’Europe, par la bassesse inouïe d’une démarche où on verroit bien que l’extrême pouvoir de du Bois sur lui l’auroit entraîné de force. Je finis par le conjurer de n’y point aller, et par lui dire qu’il savoit en quels termes actuels l’abbé du Bois et moi étions ensemble; que j’étois le seul homme de marque qu’il n’eût point convié; que nonobstant tout cela, s’il me vouloit promettre et me tenir sa parole de n’aller point à ce sacre, je lui donnois la mienne d’y aller, moi, et d’y demeurer tout du long, quelque horreur que j’en eusse et quelque blessé que je fusse de ce que cela feroit sûrement débiter que ce trait de courtisan étoit pour me raccommoder avec lui, moi si éloigné d’une pareille misère et qui osai me vanter, puisqu’il le falloit aujourd’hui, d’avoir jusqu’à ce moment conservé chèrement toute ma vie mon pucelage entier sur les bassesses.
Ce propos, vivement prononcé et encore plus librement et plus énergiquement étendu, fut écouté d’un bout à l’autre. Je fus surpris qu’il me dit que j’avois raison, que je lui ouvrais les yeux, plus encore qu’il m’embrassa, me dit que je lui parlois en véritable ami, et qu’il me donnoit sa parole et me la tiendrait de n’y point aller. Nous nous séparâmes là-dessus, moi le confirmant encore, lui promettant de nouveau que j’irois, et lui me remerciant de cet effort. Il n’eut nulle impatience, nulle envie que je m’en allasse, car je le connoissois bien, et je l’examinois jusqu’au fond de l’âme, et ce fut moi qui le quittai, bien content de l’avoir détourné d’une si honteuse démarche et si extraordinaire. Qui n’eût dit qu’il ne m’eût tenu parole? car on va voir qu’il le vouloit; mais voici ce qui arriva[264].
[Note: these two pages do not appear in the printed book.]
In the reign of Louis XIV there were four chief councils, the Conseil d’État known unofficially as the Conseil d’en haut, the Conseil des dépêches, the Conseil des finances, and the Conseil des parties.
Of these the Conseil d’État was by far the most important. It consisted of not less than four and not more than five members, nominated by the King at his pleasure without any formality. They were chosen from the Secretaries of State, the Controller-General and the Chef du Conseil des finances, but no office carried with it a seat in the council. They had the title of Ministre d’État, or briefly Ministre. The appointment was for life, but might be terminated by dismissal or resignation.
The following are the names of those who sat in the Conseil d’État from the death of Mazarin to the death of Louis XIV: Fouquet, Le Tellier, Lionne, Colbert, Villeroy père, Pomponne, Louvois, Croissy, Le Peletier, Seignelay, Pontchartrain, Beauvillier, Torcy, Chamillart, Desmaretz, Voysin, Villeroy fils. Of these seventeen, eight were fathers and sons, viz. the two Villeroys, Le Tellier and Louvois, Colbert and Seignelay, Croissy and Torcy. Only three, the Villeroys and Beauvillier, were ducs et pairs, or even belonged to the old nobility.
The Council met in the presence of the King every Sunday, Wednesday and Thursday, and every other Monday.
The Conseil des dépêches, also presided over by the King, met once a fortnight. It was composed of the Chancellor, the Ministers, and the Secretaries of State.
The Conseil royal des finances, also presided over by the King, consisted of the Chancellor, the Chef du Conseil des finances, the Controller-General, and two councillors.
216 The Conseil des parties, also called the Conseil privé, sat, not in the royal apartments, but in the Palais de justice. It was usually presided over, not by the King, but by the Chancellor, and was composed of thirty conseillers d’État and over eighty masters of requests. It was the supreme judicial and administrative body of the kingdom.
(See A. de Boislisle, Les Conseils sous Louis XIV, Appendices to vols. IV.-VII. of his edition of Saint-Simon’s Memoirs, and separately, 1901.)
The four Secretaries of State divided between them the administration of the Provinces. In addition each had his special department. These were four—Foreign Affairs, War, the King’s Household and the Navy, and the Protestants (La Religion prétendue réformée), of which the last became less and less important.
Par toutes les recherches que j’ai pu faire, depuis plusieurs années que je m’y applique, j’ai fort bien remarqué que dans ces derniers temps, près de la dixième partie du peuple est réduite à la mendicité, et mendie effectivement; que des neuf autres parties, il y en a cinq qui ne sont pas en état de faire l’aumône à celle-là, parce qu’eux-mêmes sont réduits, à très-peu de chose près, à cette malheureuse condition; que des quatre autres parties qui restent, les trois sont fort malaisées, et embarrassées de dettes et de procès; et que, dans la dixième, où je mets tous les gens d’épée, de robe, ecclésiastiques et laïques, toute la noblesse haute, la noblesse distinguée, et les gens en charge militaire et civile, les bons marchands, les bourgeois rentés et les plus accommodés, on ne peut pas compter sur cent mille familles; et je ne croirais pas mentir quand je dirais qu’il n’y en a pas dix mille, petites ou grandes, qu’on puisse dire être fort à leur aise; et qui en ôterait les gens d’affaires, leurs alliés et adhérents couverts et découverts, et ceux que le roi soutient par ses bienfaits, quelques marchands, etc., je m’assure que le reste serait en petit nombre[265].
Je me sens encore obligé d’honneur et de conscience de représenter à Sa Majesté qu’il m’a paru que de tout temps on n’avait pas eu assez d’égard en France pour le menu peuple, et qu’on en avait fait trop peu de cas; aussi c’est la partie la plus ruinée et la plus misérable du royaume; c’est elle, cependant, qui est la plus considérable par son nombre et par les services réels et effectifs qu’elle lui rend; car c’est elle qui porte toutes les charges, qui a toujours le plus souffert, et qui souffre encore le plus; et c’est sur elle aussi que tombe toute la diminution des hommes qui arrive dans le royaume.
FOOTNOTES.
[1] Journal du Marquis de Dangeau, ed. Soulié, Dussieux, De Chennevières, Mantz, De Montaiglon, 19 vols. 1854; Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, XI.
[2] XVII. 142. The account of Dangeau and his memoirs which Saint-Simon here gives on the occasion of his death (pp. 134-144) is fuller than the earlier portrait in vol. I. 343-346. La Bruyère’s Pamphile (Des Grands) is evidently meant for Dangeau, and Saint-Simon so accepts it.
[3] See Mémoires, IV. 222-224; XIII. 90-97.
[4] Mémoires, VII. 19. The page and a half which precedes this throws considerable light on Saint-Simon’s sources of information.
[5] Madame changed her opinion later. See below, p. 198, n. 253.
[6] IV. 143.
[7] Mémoires, ed. Chéruel, XI. 198-204.
[8] Mémoires, III, 346-351.
[9] Mémoires, IV. 42-52.
[10] Mémoires, XI. 1-54.
[11] XV. 336-473; XVI. 1-96.
[12] VIII. 32-34.
[13] ib. 214-217.
[14] Ed. Chéruel, XII. cc. I and IV; ed. Boislisle, XXVIII. 1-53, 126-175. This digression on the character and reign of Louis XIV was written in September, 1745, but it reproduces almost textually the long note which Saint-Simon added to the Memoirs of Dangeau ten years earlier. It should be compared with his Parallèle des trois premiers rois Bourbon (Écrits inédits, I.) and with the Relation de la Cour de France en 1690 of Ezekiel Spanheim (ed. E. Bourgeois, 1900), the envoy of the Great Elector of Brandenburg.
[15] This is a mistake. Louis XIV had common sense, prudence, and sagacity, and, if he lacked initiative and originality, he could understand what was explained to him.
[16] Olympe Mancini, who married the Comte de Soissons of the royal house of Savoy. She was the mother of Prince Eugène.
[17] Nicolas Fouquet (1615-1680), the well-known surintendant des finances, aspired to succeed Mazarin, but his ambitions were thwarted by Louis announcing his intention to be his own chief minister. He was arrested on September 5, 1661, and his trial for malversation of the finances began in the following November. The verdict was not given till December, 1664, when the majority of the judges condemned him to perpetual banishment with confiscation of his property. This was changed by Louis with extrême dureté to imprisonment for life. (See J. Lair, Nicolas Fouquet, 2 vols. 1890, and Mme de Sévigné’s letters.)
[18] This episode, in which the Spanish ambassador was clearly in the wrong, took place in 1661. The last act of the Maréchal d’Estrades’s long and successful diplomatic career was the Treaty of Nymegen (1678). He died in 1685, leaving memoirs (9 vols. 1743) which Saint-Simon qualifies as “excellent.”
[19] On this occasion (August, 1662) the provocation came from the French side, but Louis XIV loudly demanded reparation for the insults offered to his ambassador by the Pope’s Corsican guards. By the treaty of Pisa (February, 1664) he obtained it in a form which was thoroughly humiliating to Alexander VII.
[20] The War of Devolution began in May, 1667, and the peace of Aix-la-Chapelle was signed in the May following. The famous passage of the Rhine did not take place till 1672.
[21] The farm of Urtebise, as it should be written.
[22] Frederick Hermann, Duke of Schomberg or Schönberg (1618-1690), was by birth a German, but he served in the French army for more than thirty years. After the revocation of the Edict of Nantes he was allowed to retire to Portugal. In 1688 he accompanied William of Orange to England, was created a Duke, was made Commander-in-chief of the forces in Ireland, and was killed at the battle of the Boyne. He is buried in St Patrick’s Cathedral, Dublin.
[23] Louis de Crevant, Marquis and afterwards Duc d’Humières. For a short portrait of him see I. 196-7. He died in 1694.
[24] François d’Aubusson, Duc de La Feuillade, was a devoted courtier of Louis XIV. He gave a proof of his devotion by making the Place des Victoires and adorning it with a statue of his master in gilded bronze.
[25] Guy de Durfort, Duc de Lorges, was a nephew of Turenne and father-in-law to Saint-Simon. For his portrait see II. 329-342.
[26] About 12 miles N.E. of Saint-Omer.
[27] Ghent capitulated after a six days’ siege on March 9, 1678.
[28] Peace with Holland was signed at Nymegen on August 10, 1678, with Spain on September 17, and with the Empire on February 5, 1679.
[29] This anecdote has already been related by Saint-Simon in an earlier volume. That it was the origin of the war of 1688 has been disproved by C. Rousset in his Histoire de Louvois.
[30] See below for a portrait of Le Nostre.
[31] Charles-Henri, Prince de Vaudemont, a legitimatised son of Charles IV, Duke of Lorraine. See I. 494-497.
[32] This accusation is untrue.
[33] For this battle, called Landen by English writers (July 29, 1693), see I. 87, and Macaulay, Hist. of England, c. XX.
[34] The Duke of Savoy.
[35] William Bentinck, Earl of Portland (1649-1709), a Dutchman by birth, was greatly trusted by William of Orange. For his conferences with Boufflers, which resulted in the Peace of Ryswick, see I. 461-462; Macaulay, c. XXII. For his embassy to France in 1698, the magnificence of which made a great impression on the French people, see II. 19-23. It is described at great length by Macaulay, c. XXIII.
[36] This account of Louis XIV’s éducation has been shewn by modern historians to be incorrect. Cp. Primi Visconti, Mémoires, 191-192. But it is true that he hated reading. “La seule vue d’un livre le fatigue” (ib.). “Il avait la lecture en horreur,” says Madame (Corr. III. 36).
[37] Relating to the years 1635-1660.
[38] Louis, Comte de Cheverny, filled the posts of ambassador to Germany and to Denmark, and of governor to the Duc de Chartres. He married a niece of Colbert.
[39] The château (eight miles E. of Blois), built about 1634, is a stately but not very interesting example of the architecture of the period. Saint-Simon stayed there (VI. 41).
[40] François-Gaspard de Montmorin, Marquis Saint-Hérem. Chateaubriand’s friend, Mme de Beaumont, was a Montmorin.
[41] Son of the author of the Maximes; an assiduous but thoroughly honest courtier.
[42] On the contrary Louis had a good ear, sang well, and had considerable musical taste.
[43] This reflection on the king’s courage is undeserved, though it is true that he took part in numerous sieges and not in a single battle.
[44] M. de Boislisle cites in support of this Fénelon’s celebrated Lettre à Louis XIV (Correspondance, II. 329 ff.).
[45] The right to sit on a stool in the presence of royalty. See Saint-Simon, Mém. II. 76-77; 238-240.
[46] See Appendix A.
[47] See below for his portrait.
[48] This is a mistake. The first Maréchal de Villeroy was appointed a minister in 1661.
[49] This habitual answer of Louis is referred to by several contemporary writers. Madame tells a good story about it (Corr. I. 169).
[50] Emmanuel-Théodore de La Tour d’Auvergne (1644-1715). See for his biography and portrait XI. 94-102. He was a nephew of Turenne.
[51] Louis-François, Marquis and afterwards Duc de Boufflers (1644-1711), distinguished himself at Fleurus and Steinkirk. His defence of Lille against the allied troops (1708) was the admiration of all Europe. His brilliant charge at Malplaquet (1709) saved the retreat of the French army from becoming a rout. He was a friend of Saint-Simon, who had a great admiration for him. See his portrait, IX. 92-94.
[52] Louis-Hector, Marquis and then Duc de Villars (1653-1734), was the best French general in the War of the Spanish Succession. In 1712 he gained a notable victory over the allies at Denain. Saint-Simon’s portrait of him (III. 322-327) shews strong prejudice. It should be corrected by the judicial estimate of Sainte-Beuve, who devoted five causeries to him (Caus. du Lundi, XIII).
[53] See above, p. 6, n. 24. The statue which represented Louis XIV trampling on a three-headed Cerberus (symbolical of the triple alliance) was made by the Dutch sculptor Martin Desjardins (Van den Bogaart). The “pagan” ceremony of dedication took place on March 28, 1686.
[54] During the last twenty-seven years of his reign (1688-1715) Louis only visited Paris five times.
[55] Anne of Austria died January 19, 1666.
[56] For Versailles see L. Dussieux, Le château de Versailles, vol. I. 1881; P. de Nolhac, La création de Versailles, 1901; A. Pératé, Versailles (Les villes d’art célèbres).
[57] See Appendix A.
[58] Jérôme Phélypeaux, Comte de Pontchartrain (1674-1747), was associated with his father in the ministry of La Marine et la Maison du Roi in his nineteenth year, succeeding him when he became Chancellor in 1699. His administration was deplorable. Saint-Simon’s portrait of him is as life-like as it is unflattering (Mém. IV. 194-5; IX. 10-13).
[59] For this system of espionnage see Mém. IV. 318.
[60] The first Lieutenant-general of police was La Reynie who was appointed in 1667. He was succeeded in 1697 by Marc-René, Marquis d’Argenson, who raised his department to the highest pitch of efficiency. See P. Clément La police sous Louis XIV, 2nd ed. 1866, and P. Cottin, Rapports de police de René d’Argenson, 1866.
[61] The postal service was in the hands of several generations of the Pajot and Rouillé families from 1665 to 1760. See Boislisle, XXVIII. 139, nn. 1 and 2.
[62] IV. 317-319. Michel-François Le Tellier, Marquis de Courtenvaux, was the eldest son of Louvois, “un fort petit homme, obscurément débauché, avec une voix ridicule... avare et taquin, et quoique modeste et respectueux, fort colère, et peu maître de soi quand il se capriçoit: en tout un fort sot homme.” Le Nôtre told Dr Lister that he had never seen Louis XIV in a passion. Saint-Simon gives another instance, when he broke his cane over a valet’s back (I. 263-264).
[63] “Personne au monde n’est aussi poli que notre roi,” writes Madame in 1706.
[64] Avec un almanach et une montre, on pouvait à cent lieues de lui dire à justesse ce qu’il faisoit. Il vouloit une grande exactitude dans son service; mais il y étoit exact le premier (Parallèle des trois premiers rois Bourbon). And cp. Primi Visconti, Mém. pp. 31-33.
[65] Hercule de Rohan, Duc de Montbazon (1568-1654), father of the celebrated Duchesse de Chevreuse.
[66] A small four-wheeled carriage with a folding hood.
[67] The court was installed at Versailles in 1682, but the palace was not completed till 1688.
[68] Jules Hardouin, nephew and pupil of François Mansart or Mansard, whose name he took.
[69] Clagny was one of Mansard’s first works and won him the favour of Louis XIV. It no longer exists.
[70] The mortality among the workmen was very high.
[71] Nothing now remains but fourteen arches of the aqueduct.
[72] This hydraulic machine, so much admired at the time, was really a clumsy affair.
[73] Ed. Chéruel, XII. c. vii; ed. Boislisle, XXVIII. 242-281.
[74] Wife of Henri de Mornay, Marquis de Montchevreuil, the governor of the Duc du Maine. Mme de Caylus describes her as “une femme froide et sèche dans le commerce, d’une figure triste, d’un esprit au-dessous du médiocre, et d’un zèle capable de dégoûter les plus dévots de la piété.” Saint-Simon’s portrait is equally unflattering: “Une grande créature maigre, jaune, qui rioit niais, et montroit de longues vilaines dents, dévote à l’outrance” (IV. 35), and Madame on hearing of her death writes: “ça fait une méchante femme de moins en ce monde” (Corr. I. 214).
[75] Armand-Jean Du Plessis, great-nephew of the Cardinal.
[76] Mme de Caylus (Marthe-Marguerite de Valois) was the daughter of the Marquis de Villette, Mme de Maintenon’s first cousin, and was thus her nièce à la mode de Bretagne. In her father’s absence in America Mme de Maintenon carried her off and made her a Catholic, and in 1686, when she was in her thirteenth year, married her to the Comte de Caylus, a confirmed drunkard. She was one of the most attractive women of her day, and her memoirs are a lively source of information for Mme de Maintenon and the Court generally. Her stepmother, the Marquise de Villette, married, as his second wife, Henry St John, Viscount Bolingbroke.
[77] Wife of Henri de Daillon, Comte and afterwards Duc du Lude, Grand-Master of the Artillery. In 1696 she was made principal lady-in-waiting (dame d’honneur) to the future Duchess of Burgundy. She was a Béthune by birth, the great-granddaughter of Sully.
[78] Bonne de Pons, Marquise d’Heudicourt. Mme de Caylus speaks of her as “bizarre, naturelle, sans jugement, pleine d’imagination, toujours nouvelle et divertissante.” Saint-Simon in reporting her death in 1709 calls her a “démon domestique” and a “mauvaise fée,” but he adds: “On ne pouvoit avoir plus d’esprit ni plus agréable, ni savoir plus de choses, ni être plus plaisante, plus amusante, plus divertissante, sans vouloir l’être” (IV. 345).
[79] See below for his portrait.
[80] Henri, Marquis and afterwards Duc d’Harcourt (1654-1718), of the branch of Beuvron-Harcourt. As a lieutenant-general he had a large share in the victory of Neerwinden. He was appointed Ambassador to Spain in 1697, and it was in a great measure due to him that the Duc d’Anjou was nominated heir to Charles II. After the new king’s accession his influence increased, and as a reward for his services he was created a Duke and a Marshal of France. For portraits of him see III. 210-212, 391-3.
[81] Anne-Marie de La Trémoïlle (circ. 1646-1722) married as her second husband Flavio Orsini, Duca di Bracciano (1675), and on his death in 1698 took the title of Princesse des Ursins (Orsini). Appointed Camarera mayor to the Queen of Spain in 1701 in order to support the French influence, she dominated the King, till December, 1714, when she was summarily dismissed by his second wife, Elizabeth Farnese. “La princesse des Ursins gouverne le roi d’Espagne comme moi mon chien Titi,” says Madame. See Saint-Simon, III. 78-81, and XI. 116, where he records a tête-à-tête with her which lasted eight hours. “Ces huit heures de conversation avec une personne qui y fournissoit tant de choses me parurent huit moments.” Part of her correspondence with Mme de Maintenon is preserved in a copy in the British Museum. It has been printed under the title of Lettres inédites de Mme de Maintenon et Mme des Ursins, 4 vols. 1826, but the editing is careless and inaccurate. Sainte-Beuve has two good articles on her (Caus. du Lundi, V. 401 ff.).
[82] The Duc de Noailles, as Comte d’Ayen, married Mlle d’Aubigné, Mme de Maintenon’s niece.
[83] Rarely.
[84] Archbishop of Paris from 1695 to 1729 and uncle of the Duc de Noailles. He favoured the Jansenists, and when in answer to the King’s demand for a Constitution against the Réflexions morales of Père Quesnel the Pope (Clement XI) issued the Bull Unigenitus, he opposed its reception. His nomination as Archbishop had been warmly supported by Mme de Maintenon, but his attitude to the Constitution made a breach between them in ecclesiastical matters. Saint-Simon’s estimate of him (XII. 138-140) is a fair one.
[85] Henri de Thiard, Cardinal de Bissy, Bishop de Toul and afterwards of Meaux, succeeded to the influence in ecclesiastical matters which the Cardinal de Noailles and Godet Des Marais, Bishop of Chartres, had had with Mme de Maintenon.
[86] He and Cardinal de Bissy were the leaders of the Jesuit party. His high birth, great wealth, and charm of looks and manner gave him great influence. Saint-Simon has a most interesting portrait of him (Mém. X. 28-32).
[87] Charles, Comte d’Aubigné, was a hopeless spendthrift, and in spite of the numerous appointments which Mme de Maintenon obtained for him was always out at elbows. On his death (1703) she wrote: “J’ai pleuré M. d’Aubigné; il étoit mon frère, et il m’aimoit fort; il étoit bon dans le fond, mais il avoit vécu dans de si grandes désordres que je puis dire qu’il ne m’a donné de joie que dans la manière dont il est mort.” See Saint-Simon, Mém. I. 478-480. “C’étoit un panier percé, fou à enfermer, mais plaisant, avec de l’esprit et des saillies;... avec cela bon homme et honnête homme, poli.” He habitually referred to the king as his brother-in-law.
[88] Godet Des Marais was a Sulpician, a disciple of Père Olier. See Saint-Simon, Mém. VII. 123-126.
[89] Claude-Maur d’Aubigny or d’Aubigné was of an old family of Anjou the connexion of which with that of Mme de Maintenon was very doubtful, but they were now glad to claim cousinship with the powerful favourite, whose nobility did not go back beyond her grandfather.
[90] The Maréchal-comte de Tessé was a skilful general, but he lacked decision, and he was more successful as a diplomatist. It was he who under orders from Louvois sacked Heidelberg and blew up the château. Saint-Simon’s portrait of him (III. 388-9) is less than fair. His Mémoires et Lettres were published in 2 vols. in 1806.
[92] See below for his portrait.
[93] Saint-Simon, I. 274, says that Mme de Maintenon dined regularly once, and sometimes twice a week, either at the Hôtel de Beauvillier or the Hôtel de Chevreuse at Versailles with the two Dukes and their wives. But the affair of Quietism put an end to their intimate meetings, for both Dukes were close allies of Fénelon.
[94] For Mme de Maintenon and Saint-Cyr see Sainte-Beuve, Caus. du Lundi, VIII. 473, an article inspired by T. Lavallée, Mme de Maintenon et la maison royale de Saint-Cyr.
[95] The Marquise de Dangeau, née Löwenstein, was of the family of the Electors of Bavaria. She was an excellent woman, of great charm and beauty, and was a close friend of Mme de Maintenon, with whom she frequently corresponded. “Elle est la favorite de la pantocrate... on dit qu’elle a sur celle-ci un pouvoir aussi absolu que celui de la dame sur le Roi.” (Corr. de Madame, I. 237.)
[96] Marie-Anne-Christine, sister of Maximilian II, Elector of Bavaria, married the Dauphin in 1686 and died in 1690.
[97] See later, p. 65, for a passage from vol. VI. in which Saint-Simon describes the “mécanique de chez Mme de Maintenon” at greater length.
[98] The extent of Mme de Maintenon’s influence on the government has been much discussed. See A. de Boislisle’s note on this passage (XXVII. 254, n. 5), and Lavisse, Hist. de France, VIII. Pt I. 282-5, 431-6. The opinion of both these authorities is that Saint-Simon’s account of her share in affairs is not exaggerated. She was certainly much concerned with Spanish politics, she corresponded regularly with Villars during all his campaigns from 1703, and she took a large part in all religious questions.
[99] Michel de Chamillart succeeded Pontchartrain as Controller-general in 1699, and on the death of Barbezieux in 1701 was appointed Secretary of State for War. He was conciliatory, industrious, and honest, but his lack of intelligence and his obstinacy made him a thoroughly incompetent minister. He was dismissed in 1709. See II. 420-421, VI. 439.
[100] Louis Phélypeaux, grandson of a Secretary of State under Louis XIII, was appointed Controller-general in 1689 and Chancellor ten years later. See II. 226.
[101] Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Torcy, son of Charles Colbert, Marquis de Croissy (brother of the great Colbert), succeeded his father as Secretary of State for Foreign Affairs in 1696. He married a daughter of Simon Arnauld, Marquis de Pomponne, who was Foreign Minister from 1671 to 1679. His Mémoires are an important source of information for the period 1697-1713.
[102] Advantage, a metaphor from tennis.
[103] Guy Fagon succeeded Daquin, a converted Jew, in 1693, through the influence of Mme de Maintenon. His great talent was combined with fearless honesty and much charm of manner. Saint-Simon did not like him, but he recognised his merits and attainments. See I. 105-6. Like William III, who once consulted him, he was an “asthmatic skeleton,” and like William’s opponent, Luxembourg, he was hunch-backed.
[104] Monseigneur is the Dauphin, and Monsieur the king’s brother. The latter’s son, the Duc d’Orléans, afterwards Régent, had the title of Duc de Chartres till his father’s death in 1701.
[105] Ed. Chéruel, VI. 203-204; ed. Boislisle, XVI. 470-473. The plan on page 66 is reproduced from Dussieux, Le château de Versailles, 2 vols. Versailles, 1881, I. plan 7. It will be seen that the two antechambers are there represented as nearly square. The appartement de jour of the Duc de Bourgogne is apparently the same as the hall of the Queen’s Guard (H). The salon de marbre is marked I on the plan.
[106] Ed. Chéruel, XII. c. ix; ed. Boislisle, XXVIII. 330-381.
[107] Saint-Simon began to write his memoirs in 1694.
[108] First almoner to Monsieur, “médiocre prêtre, mais fort brave et fort bon homme.” He was killed at the battle of Turin in 1706.
[109] Universally beloved for his piety, humanity, and devotion to his see. See for his portrait IV. 366-369.
[110] Joseph-Marie de Lascaris, a gentleman of Monseigneur’s household.
[111] See above, p. 43, n. 74.
[112] Claude-Gabriel, Marquis d’O, governor of the Comte de Toulouse. He was originally called Villers, but he took the name and arms of the family of D’O, whose château in Normandy dates from about 1505. A considerable portion of the original structure still remains.
[113] See above, p. 38, n. 68.
[114] The Duc d’Antin, son of Mme de Montespan by her husband, was the type of a perfect courtier. He succeeded Mansart as director-general of the royal buildings. Sainte-Beuve has an excellent article on him (Caus. du Lundi, V. 378 ff.).
[115] For the various Councils see Appendix A.
[116] Bernard-François Potier, Marquis de Gesvres and afterwards Duc de Tresmes, first gentleman of the royal household.
[117] Louise de Prie, wife of Philippe, Maréchal de La Mothe. See for her portrait VI. 222-224. She was beautiful and virtuous, “la meilleure femme du monde.”
[118] He was not, however, so devoted to the game as some of his predecessors, e.g. Francis I, Henry II, and Henry IV. The best player of this time was a certain Jourdan, who was paid a yearly salary of 800 livres for coaching the royal princes. But tennis was on the decline in the reign of Louis XIV. In 1596 there were 250 courts (tripots) in Paris alone, in 1657 114, in 1780 only 10 (J.-J. Jusserand, Les Sports dans l’ancienne France, 1901, pp. 240-265).
[119] The game of mail was universally popular in France in the 16th and 17th centuries. It was a form of golf, played with a long-handled mallet and a wooden ball, and was sometimes called palemail (cp. our Pall Mall) from pila and malleus. It is still played at Montpellier (see Jusserand, pp. 304-314).
[120] Marie-Françoise d’Albert, a daughter of the Duc de Chevreuse, and wife of the Marquis, afterwards Duc de Levis.
[121] See Introduction.
[122] The Marquise d’O, née Guilleragues, dame du palais to the Duchesse de Bourgogne. “Elle avoit beaucoup d’esprit, plaisante, complaisante, toute à tous et amusante.” For her husband see above, p. 73, n. 112.
[123] A light meal which took the place of supper on fast-days. Readers of Pascal will recollect how in the fifth Provincial Letter the friendly Jesuit relieves the writer of the duty of fasting, if he could not sleep without a proper supper.
[124] Apparently a provincial form of gésier = gizzard.
[125] At one time lady-in-waiting to Madame, who calls her “la pauvre Doudon,” and her husband “a monster.” He was, says Saint-Simon (XIV. 123), “un homme fort laid et fort contrefait, qui avec beaucoup d’esprit et de valeur, avoit toujours mené la vie la plus obscure et la plus débauchée.” She was a daughter of the Maréchale de La Mothe (see above, p. 77, n. 117).
[126] See Introduction
[127] The Marquis de Cavoye, without birth or intelligence, rose to a position of high consideration at the Court. “Without the court,” says Saint-Simon, “he was like a fish out of water.” He fought several duels, in spite of the edicts against duelling, and was known as “le brave Cavoye.” For his career and marriage see I. 299-302.
[128] Ed. Chéruel, III. 37-40; ed. Boislisle, VIII. 349-355.
[129] See above, p. 87, n. 125.
[130] The interview really took place on the previous Saturday.
[131] The Electress Sophia, mother of George I.
[132] M. de Boislisle says that Saint-Simon’s informant was probably not Mme de Ventadour, with whom he was on bad terms, but Mme de Clérembault, widow of the Maréchal de Clérembault, who was one of Madame’s ladies-in-waiting, and whom Saint-Simon frequently met at her cousins’, the Pontchartrains. For an amusing portrait of her see III. 243-245, and for some additional touches, XIX. 84-85. Out of doors and in the galleries at Versailles she always wore a black velvet mask to preserve her complexion. She was passionately fond of cards, but being very miserly did not like high play. She had a wide knowledge of history, was well informed on other subjects, and had more esprit than any woman of her day.
With Saint-Simon’s account of this interview may be compared Madame’s, which is given in a letter to the Electress Sophia (Corr. I. 241-242).
[133] Ed. Chéruel, II. c. viii; ed. Boislisle, V. 348-375. The review took place in September, 1698.
[134] Fifty-two miles N.E. of Paris. Jeanne d’Arc was taken prisoner before its walls.
[135] For the merest nobody.
[136] Saint-Simon frequently uses this expression in the sense of compelling a person to do something against his will.
[137] Wife of the Duc du Lude (see above, p. 44, n. 77).
[138] Louis, Duc de Rohan-Chabot, brother of Mme de Soubise.
[139] Charles, Duc de La Trémoïlle, “un fort grand homme, le plus noblement, et le plus mieux fait de la cour; et qui, avec un fort vilain visage, sentait le mieux son grand seigneur” (VI. 396). He was a great friend of Saint-Simon.
[140] Son-in-law of the Duc de La Trémoïlle and son of the Duc de Bouillon, with whom he was in litigation.
[141] Quarter-Master-General of the Royal Household (see above, p. 88, n. 127).
[142] See above, p. 44, n. 81.
[143] See above, p. 22, n. 51. He was Commander-in-chief of the camp under the Duc de Bourgogne.
[144] First maître-d’hôtel to the king.
[145] Antoine IV, son of Antoine III, Maréchal de Gramont, and younger brother of the Comte de Guiche, who predeceased his father.
[146] The Duchesse de Bourbon, daughter of Louis XIV and Mme de Montespan.
[147] Daughter of Louis XIV and Mlle de La Vallière, and widow of Louis-Armand, Prince de Conti.
[148] See above, p. 46, n. 90.
[149] The order of Premonstratensian Canons was founded by St Norbert about 1120. The original house was at Prémontré in the forest of Coucy.
[150] This incorrect phrase is as Saint-Simon wrote it.
[151] Marquis de Canillac, Colonel of the Rouergue regiment. For his portrait see XI. 233-235. He was one of the roués of the Regency.
[152] Conrad, Marquis de Rosen, “un grand homme sec, qui sentoit son reître, et qui auroit fait peur du coin d’un bois” (III. 381).
[153] Ed. Chéruel, VIII. cc. xii and part of xiii; ed. Boislisle, XXI. 5-57 and 85-89.
[154] The château of Meudon was built for the Dauphin by J.-H. Mansard in 1698.
[155] See above, p. 57, n. 103.
[156] Governor of Meudon and a friend of Saint-Simon’s.
[157] See above, p. 98, n. 146.
[158] See above, p. 98, n. 147.
[159] Mlle de Lislebonne and Mme d’Espinoy were daughters of Anne, Comtesse de Lislebonne, a legitimatised daughter of Charles IV, Duke of Lorraine, and widow of a younger brother of the Duc d’Elbeuf. They were both tall and had good figures; the elder, Mlle de Lislebonne, was plain, and the younger, wife of Louis de Melun, Prince d’Espinoy, was handsome. Mlle de Melun was her sister-in-law.
[160] Godefroi-Maurice, Duc de Bouillon, was a nephew of Turenne.
[161] Saint-Simon called Mlle Choin the Maintenon of Monseigneur, but he twice says that they were never married, and this view is confirmed by other evidence.
[162] For Saint-Simon’s enmity with the “Cabale de Meudon,” see the Introduction.
[163] Saint-Simon spent Easter in every year at his country-seat of La Ferté-Vidame.
[164] The first Sunday after Easter or Low Sunday, so called because the Introit of the Mass for that day begins with Quasi modo geniti (as new-born babes) from 1 Pet. ii. 2.
[165] See Introduction.
[166] See above, p. 44, n. 76.
[167] See below for his portrait.
[168] Michel Le Tellier, the Jesuit confessor of Louis XIV. See VI. 241-243 for a highly unfavourable portrait of him. “Il eût fait peur au coin d’un bois; sa physionomie étoit ténébreuse, fausse, terrible; les yeux, ardents, méchants, extrêmement de travers: on étoit frappé en le voyant.... Grossier et ignorant à surprendre, insolent, impudent, impétueux, ne connoissant ni monde, ni mesure, ni degrés, ni ménagements, ni qui que ce fût, et à qui tous les moyens étoient bons pour arriver à ses fins.”
[169] Mme de Montespan, the mother of the Duchess, was the daughter of Gabriel de Rochechouart, Duc de Mortemart.
[170] A form of coach invented at Berlin, much used for travelling, being lighter and better hung than an ordinary post-chaise.
[171] Marguerite Le Tellier, daughter of Louvois. For her portrait see VIII. 310 f.
[172] Marie de Laval, widow of the Maréchal-Marquis de Rochefort, formerly Bedchamber-woman to the Dauphine.
[173] Niece of Mme de Montespan and widow of the Duke of Sforza.
[174] See below, p. 142, for her portrait.
[175] Daughter of the Duc d’Arpajou and wife of the Comte de Roucy, who was a nephew of the Maréchal de Lorges. “C’étoit une personne extrêmement laide, qui avoit de l’esprit, fort glorieuse, pleine d’ambition, folle des moindres distinctions, engouée à l’excès de la cour... qui vivoit noyée de biens, d’affaires et de créanciers, envieuse, haineuse, par conséquent peu aimée, et qui, pour couronner tout cela, ne manquoit point de grand messes à la paroisse et rarement à communier tous les huit jours. Son mari n’avoit qu’une belle, mais forte figure: glorieux et bas plus qu’elle, panier percé qui jouoit tout et perdoit tout... Il étoit de tout avec Monseigneur.” (I. 346.)
[176] See above, p. 80, n. 120.
[177] See above, p. 73, n. 112.
[178] See above, p. 44, n. 77.
[179] Daniel-François Voysin succeeded Chamillart as Secretary of State for War in 1709. For his portrait see VI. 444-446.
[180] Henri de Lorraine, Comte de Brionne, son of the Comte d’Armagnac, grand écuyer, known as M. le Grand. He was the best dancer of his day, “un assez honnête homme, mais si court et si plat que rien n’étoit au-dessous... d’un mérite qui se servit borné aux jambons s’il fût né d’un père qui en eût vendu” (IX. 286-287).
[181] Charles-François de La Baume le Blanc, Marquis afterwards Duc de La Vallière. He was the great-nephew of Louise de La Vallière.
[182] The best-known is that by Mignard in the Louvre, painted in 1689. It represents the Dauphin with his wife and his three children.
[183] Parvulo (= en petit comité) was the name given to the gatherings of Monseigneur’s little circle of intimates.
[184] The Duc de Montausier frequently administered personal chastisement to the Dauphin, often for very minor offences.
[185] The sisters of the Congrégation des Filles de la Charité, organised by St Vincent de Paul in 1633.
[186] =pall (from pallium).
[187] See above, p. 95, n. 139.
[188] Henri-Charles Du Cambout, Duc de Coislin and Bishop of Metz. He was nephew of Cardinal de Coislin, and had succeeded to the dukedom on the death of his elder brother in 1710.
[189] Marquis de Dreux, son-in-law of Chamillart. “Son ignorance et sa brutalité étoient égales, et au comble” (XII. 318).
[190] Henri-Ignace de Brancas.
[191] For the Maréchal-Marquis de Brancas see XII. 240-241. He was a friend of Saint-Simon’s.
[192] See for other accounts of the Dauphin’s death Correspondance de Madame, II. 143 ff. and Mme de Maintenon d’après sa correspondance, II. 275 ff. Cp. also Massillon’s Oraison funèbre, in which he dwells on the Dauphin’s bonté or good-nature, and on his complete submission to Louis XIV, “Toujours entre les mains du roi, et toujours charmé d’y être.”
[193] Ed. Chéruel, I. 136-137; ed. Boislisle, II. 53-55.
[194] Ed. Chéruel, I. 390-391 (see also XII. 419, and XIV. 391); ed. Boislisle, III. 332-333.
[195] A journey to Paris in the year 1698. London, 1699.
[196] “No man talks with more freedom to him [Louis XIV],” says Lister.
[197] Ed. Chéruel, II. 344-345; ed. Boislisle, VII. 190-194.
[198] Ed. Chéruel, IV. 383 ff.; Boislisle, XIII. 280 ff.
[199] Ed. Chéruel, III. 379-380; ed. Boislisle, XI. 27-30.
[200] Détail de la France sous le règne de Louis XIV, the chief work of Boisguilbert or Boisguillebert, was first published at Rouen in 1695.
[201] Chamillart succeeded Pontchartrain as Controller-general in 1699.
[202] The Projet d’une Dîme royale was published anonymously at Rouen in 1707, and steps were immediately taken to suppress it. See Appendix B.
[203] Beauvillier and Chevreuse.
[204] Nicolas Desmaretz succeeded Chamillart as Controller-general in 1708. His father married Colbert’s sister. “C’étoit un grand homme très bien fait, d’un visage et d’une physionomie agréable, qui annonçoit la sagesse et la douceur, qui étoient les deux choses du monde qu’il tenoit le moins” (II. 324).
[205] Vauban presented his book in manuscript to the king at the end of 1699. It was modified and completed in 1704.
[206] Ed. Chéruel, V. 149-154; ed. Boislisle, XIV. 323-339.
[207] Menin = a gentleman of the household.
[208] Emmanuel II de Crussol, senior duc et pair, the creation being of 1572. The finest part of his château, which is half-way between Alais and Avignon, was built in the sixteenth century.
[209] The Duc de Bourbon, La Bruyère’s pupil.
[211] Louis d’Aubusson, Duc de La Feuillade (1673-1725), was son of the Maréchal-Duc who built the place des Victoires for his statue of Louis XIV (see above, p. 6, n. 24). He married a daughter of Chamillart. Saint-Simon has a striking portrait of him. “Son commerce, à qui ne vouloit s’amuser, étoit charmant; il étoit magnifique en tout, libéral, poli, fort brave et fort galant, gros et beau joueur.... Son ambition étoit sans bornes.... C’étoit un cœur corrompu à fond, une âme de boue, un impie de bel air et de profession; pour tout dire, le plus solidement malhonnête homme qui ait paru de longtemps” (III. 196). He was an incapable commander and was badly defeated before Turin in 1706.
[212] Ed. Chéruel, V. 269-273; ed. Boislisle, XV. 108 ff.
[213] Oui, Messieurs, quelle étendue de connoissances dans le prince de Conti! On eût dit qu’il étoit de toutes sortes de professions: guerre, belles-lettres, histoire, politique, jurisprudence, physique, théologie même. (Massillon, Oraison funèbre.)
[214] Fénelon.
[215] His portrait is given below.
[216] Toussaint de Forbin, Cardinal de Janson, Bishop of Beauvais and Grand Almoner, was a particular friend of Saint-Simon’s, and his death in 1709 is the occasion for a noble portrait of him (III. 9-12): “Il étoit plein d’honneur et de vertu, il avoit un grand amour de ses devoirs et de sa piété.... Il avoit l’âme et toutes les manières d’un grand seigneur, doux et modeste, l’esprit d’un grand ministre né pour les affaires, le cœur d’un excellent évêque, point cardinal, au-dessus de sa dignité, tout françois sur nos libertés et nos maximes du royaume sur les entreprises de Rome.”
[217] In 1683 the Prince de Conti and his brother had taken part, without the king’s permission, in the campaign against the Turks.
[218] Ed. Chéruel, VI. 271-275; ed. Boislisle, XVII. 121 ff. Cp. with this full-length portrait the following in miniature by Mme de Caylus. “Avec toutes les connoissances et l’esprit qu’on peut avoir il n’en montroit qu’autant qu’il convenoit à ceux qu’il parloit: simple et naturel, profond et solide, frivole même quand il falloit le paroître, il plaisoit à tout le monde” (Souvenirs, p. 118). Cp. also Massillon’s Oraison funèbre. He dwells on Conti’s wide knowledge, and his affability towards high and low alike. “Un héros et un prince humain.” But, as is inevitable in a funeral oration, he omits the contre-partie.
[219] See above, p. 14, n. 38.
[220] See above, p. 73, n. 112.
[221] Claude Rouault, Marquis des Gamaches.
[222] Cheverny, D’O, and Gamaches.
[223] First valet to the Duke.
[224] Ed. Chéruel, IX. 195 ff.; ed. Boislisle, XXII. 279 ff.
[225] The Abbé Claude Fleury (1640-1723) was sous-précepteur to the Dauphin under Bossuet, and to the Duc de Bourgogne under Fénelon. The first volume of his great Histoire ecclésiastique appeared in 1691, and in 1696 he succeeded La Bruyère in the Académie Française.
[226] This is the text of the manuscript.
[227] Ed. Chéruel, IX. 209 ff.; ed. Boislisle, XXII. 305 ff. Sainte-Beuve (Caus. du Lundi, X. 42 ff.) notes that Saint-Simon gives one a more favourable impression of the Duc de Bourgogne than we get from Fénelon’s letters.
[228] Nicolas de Catinat commanded with success the French army in Piedmont in the campaigns of 1690-1696 against Victor-Amédée of Savoy. His most important victory was gained at Staffarde in 1690. He was created a Marshal in the following year. In the War of the Spanish Succession he was less successful. In a short portrait (IX. 188-189) Saint-Simon does full justice to his character, “to his wisdom, his modesty, his disinterestedness, his great ability as a commander,” and he compares him in his simplicity, his frugality, his contempt for the world, his peace of soul, to the great Roman generals who after their well-merited triumphs returned to their plough, faithful lovers of their country, which they had served so well, and heedless of its ingratitude.
[229] The order of the Saint-Esprit.
[230] Four bishops, of whom the chief was Nicolas Pavillon, the devout Bishop of Alet, had formally protested against the persecution of the nuns of Port-Royal in order to force them to sign the “formulary” declaring that the Augustinus had been rightly condemned. At last in 1668 they were induced to make an ambiguous submission, with which Clement IX declared himself satisfied. A medal was struck to celebrate the “Peace of the Church,” but the peace was a sham one, as the Jesuits well knew.
[231] Mabillon and Montfaucon, perhaps the two most learned of the Bénédictines of St Maur, were both at Saint-Germain-des-Prés when the Cardinal was abbot.
[232] For a charming portrait of this Cardinal see III. 426-429. He was Archbishop of Narbonne and grand almoner to the Queen. He died in 1703. The Marquis de Castries (see above, p. 142) was his nephew.
[233] Ed. Chéruel. X. 344 ff.; ed. Boislisle, XXV. 163 ff.
[234] Charles-Honoré d’Albert, Duc de Luynes et de Chevreuse, was the grandson of the Constable de Luynes, the minister of Louis XIII, and the son of the Duc de Luynes who retired to Port-Royal and was the friend of Pascal. The Dukedom of Chevreuse came from his grandmother, who after the Constable’s death married the Duc de Chevreuse, the youngest son of Henri de Guise (Le Balafré), and in the days of the Fronde was conspicuous for her intrigues. He died in 1712, nearly two years before his brother-in-law. See IX. 378-387 for a charming portrait.
[235] Ed. Chéruel, X. 276 ff.; ed. Boislisle, XXV. 42 ff.
[236] See E. de Broglie, Fénelon à Cambrai, 1884.
[237] Les Maximes des saints was published in 1697 and was condemned by the Court of Rome in 1699.
[238] See above, p. 46, n. 88.
[239] See above, p. 45, n. 84.
[240] See above, p. 111, n. 168.
[241] 1704.
[242] The meeting between Chevreuse and Fénelon at Chaulnes, where the Duke had a château, took place in November, 1711. As the result of their long political conversations Fénelon drew up a document entitled Plans de gouvernement concertés avec le Duc de Chevreuse pour être proposés au Duc de Bourgogne. It consisted of mere heads of chapters arranged under seven sections which Fénelon called tables. Hence the name, Tables de Chaulnes, which the document usually bears.
[243] It will be seen that Saint-Simon insists strongly on Fénelon’s ambition. He certainly had the spirit of domination, but that he aspired to be the Richelieu of the future monarch is very doubtful, and there is no evidence to bear out Saint-Simon’s insinuation that on the Duc de Bourgogne’s death he turned his attention to the Duc d’Orléans.
[244] Ed. Chéruel, XI. 58-66; ed. Boislisle, XXVI. 74-85. It must be remembered that Saint-Simon expressly says of Fénelon: “Je ne le connoissois que de visage, trop jeune quand il fut exilé; je ne l’avois pas vu depuis” (X. 287).
[245] Which has no solidity.
[246] See above, p. 10, n. 31.
[247] See above, p. 44, n. 81.
[248] Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Torcy (1665-1746), was the son of the Marquis de Croissy, Colbert’s brother. After filling the post of Ambassador to England, he became Secretary of State for Foreign Affairs in 1696. His Memoirs are an important source for the diplomatic history of the War of the Spanish Succession. Saint-Simon became intimate with him during the Regency and obtained from him much information.
[249] Camille d’Hostun, Comte de Tallart (1652-1728), received his Marshal’s bâton in 1703. A good strategist but a poor tactician, he was defeated and taken prisoner at Blenheim in 1704 and remained in England till 1711. For his portrait see III. 390-391.
[250] Ed. Chéruel, XI. 218-220; Boislisle, XXVI. 341-345. Cp. the short but even more severe estimate under the year 1722 (XIX. 12-13).
[251] See above, p. 46, n. 86.
[252] Philippe, brother of the Duc de Vendôme, Grand Prior of France and Chevalier of the Order of Malta. He was very good-looking (in his youth), a brilliant conversationalist, extremely rich—he enjoyed the revenues of six abbeys—and a finished blackguard. For his portrait see Saint-Simon, III. 392: “Menteur, escroc, fripon, voleur, malhonnête homme jusque dans la moelle des os... le plus désordonné et le plus grand dissipateur du monde.” His supper parties at the Temple were notorious for their cynical debauchery. According to Saint-Simon he was carried to bed dead-drunk every night for thirty years.
[253] Guillaume Dubois, the son of an apothecary, was born at Brive in 1656. After being tutor in several private families, he was appointed first assistant-tutor and then tutor to the young Duc de Chartres and succeeded in winning his complete confidence. Compare the portrait drawn by Saint-Simon after his death (1723), IV. 138 ff. The Archbishopric of Cambrai, seven abbeys, and his stipends as first minister and head of the postal-service, gave him an income of 574,000 livres. “He had an extraordinarily lucid mind, a surprising power of work, and a determined will. No scruples troubled him.... He was a mixture of Gil Blas and Frontin” (Carré). The same writer points out that Fénelon gave him his friendship and esteem, and that Madame corresponded with him for fifteen years and evidently thought highly of him. But in 1721 she writes: “He has poisoned my whole life.”
[254] The Duke of Orleans’s first tutor.
[255] Cp. Corr. de Madame, II. 169.
[256] Armand-Charles de Gontaut, Marquis afterwards Duc de Biron.
[257] Charles-Eugène, Marquis afterwards Duc de Levis.
[258] Charles-Auguste, Marquis de La Fare (1644-1712), a writer of light verse, whose life was wasted in indolence and ignoble pleasures. He was a constant guest at the Temple. See Sainte-Beuve, Caus. du Lundi, X.
[259] Ed. Chéruel, XI. 165 ff.; ed. Boislisle, XXVI. 266 ff.
[260] Ed. Chéruel, XVII. 20 ff.
[261] Saint-Simon in relating his death at Rome speaks of his ignorance, his indecent and disorderly life, his queer figure, and his ill-timed jokes. Though besides the rich see of Cambrai he held five abbeys, he died nearly bankrupt. He was brother to the Princesse des Ursins, to whom he owed his promotion (see XVI. 444 f.).
[262] The income of the see was 120,000 livres.
[263] Louis de La Vergne de Tressan.
[264] How the Regent was persuaded after all to be present at the consecration and how Saint-Simon got his information on this point may be read in the two pages which follow. The whole story is too characteristic of the Regent, Dubois, and Saint-Simon to be omitted.
[265] Vauban estimated the population of France in 1707 at 18½ millions.
INDEX OF PERSONS MENTIONED IN THE NOTES
CAMBRIDGE: PRINTED BY J. B. PEACE, M.A., AT THE UNIVERSITY PRESS
Transcriber’s Note.
Original spelling and grammar have been generally retained, but a few obvious typographical were silently corrected. Missing or unclear punctuation was also silently corrected. Footnotes were renumbered consecutively, and references to the footnotes added in the Index.
A cover was created for this eBook and placed in the public domain.
[Fin de Selections from Saint-Simon par Arthur Tilley]